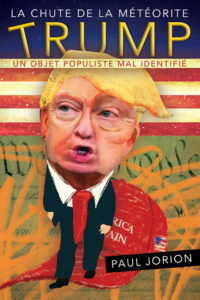
Le second portrait de Trump en monstre, c’est sa nièce Mary Lea Trump, fille de son frère aîné Fred Jr., qui nous l’offre.
Dans son livre paru en juillet en dépit des efforts de son oncle d’en faire interdire la publication, Too Much and Never Enough. How my family created the world’s most dangerous man (London : Simon & Schuster), trop et jamais assez, comment ma famille a créé l’homme le plus dangereux du monde, Mary Lea Trump entend atteindre deux objectifs : réhabiliter la mémoire de son père mort à l’âge de 42 ans, d’alcoolisme, homme généreux et passionné d’aviation, et adresser elle aussi un avertissement en vue de l’élection présidentielle : « Ne réélisez pas ce monstre, il poursuivrait sa tâche de destruction de la nation et de ses citoyens. »
Fred Jr. dit Mary L. Trump était un homme bon, ce qui constituait un vice aux yeux du patriarche Fred Sr., qui souhaita du coup sa mort. Il persécuta son fils jusqu’à parvenir à ses fins. Par la terreur il parvint à faire du cadet, Donald, un monstre à sa propre image. Je rappelle que Fred Sr. était marchand de sommeil sympathisant du Ku Klux Klan, fils de l’immigrant Friedrich Trump, tenancier de maison close.
Voici ce que Mary L. Trump explique sur la manière dont son oncle Donald vit la pandémie du Covid-19 :
La réponse initiale de Donald au Covid-19 a souligné son besoin de minimiser toute négativité, quel qu’en soit le coût. La peur – un équivalent de la faiblesse dans notre famille – lui est inacceptable aujourd’hui, comme c’était déjà le cas pour lui lorsqu’il avait trois ans. Lorsque Donald est en réelle difficulté, il n’y a pas de superlatif qui suffise à la tâche, et la situation, et ses propres réactions, doivent être uniques, même si elles sont absurdes ou relèvent du non-sens. Sous sa direction, jamais un ouragan n’a été aussi humide que l’ouragan Maria. « Personne n’aurait pu prédire ! » une pandémie à propos de laquelle son propre Département de la Santé et des Services Sociaux produisait des simulations plusieurs mois avant que le Covid-19 n’atteigne l’état de Washington. Pourquoi se conduit-il ainsi ? La peur.
Donald n’a pas traîné les pieds en décembre 2019, en janvier, février, mars, du fait de son narcissisme, c’est par peur d’avoir l’air faible ou de ne pas projeter le message que tout est toujours « grand », « splendide », « parfait ».
[…] Il aurait été si simple pour Donald d’apparaître en héros. […] Il aurait suffi qu’il demande à quelqu’un de saisir sur le rayon le manuel de préparation aux pandémies où il se trouvait depuis qu’Obama le lui avait transmis. […] Il aurait pu se contenter de quelques coups de fil, de faire une allocution ou deux, et de déléguer tout le reste. […]
Alors que des milliers d’Américains meurent dans leur coin, il vous vante la hausse de la Bourse. Alors que mon père mourait seul dans son coin, Donald est allé au cinéma. Si votre mort peut lui rapporter d’une manière ou d’une autre, il la facilitera, et oubliera que vous êtes mort.
Pourquoi a-t-il fallu si longtemps à Donald avant qu’il n’agisse ? Pourquoi n’a-t-il pas traité sérieusement ce nouveau coronavirus ? En partie, parce que comme mon grand-père, il n’a aucune imagination. Cette pandémie n’a pas de rapport immédiat avec lui, et la gérer de minute en minute ne l’aide pas à promouvoir son récitatif favori que jamais personne au monde n’a fait son boulot de manière aussi remarquable que lui.
[…] La simple vérité est que Donald est fondamentalement incapable de reconnaître la souffrance d’autrui. Rappeler les vies de ceux qui nous ont quittés susciterait chez lui le plus profond ennui. Reconnaître les victimes du Covid-19 serait établir un lien entre lui et leur faiblesse, un trait que son père lui a appris à mépriser.
[…] Pour Donald, admettre seulement l’existence d’une menace équivaudrait à de la faiblesse. Accepter la moindre responsabilité serait ouvrir la possibilité d’un reproche qui lui serait adressé un jour.
[…] Une réponse efficace aurait supposé un appel à l’union, mais Donald a besoin de la division. C’est la seule stratégie de survie qu’il connaisse – mon grand-père s’en est assuré il y a des dizaines d’années quand il monta ses enfants les uns contre les autres.
J’imagine sans difficulté la jalousie de Donald quand il a pu observer la cruauté désinvolte de Derek Chauvin et son indifférence monstrueuse alors qu’il assassinait George Floyd, les mains dans les poches, son regard insouciant dirigé vers la caméra. J’imagine sans difficulté que Donald aurait souhaité que ç’eut été son propre genou sur la nuque de Floyd.
[…] Quoi qu’il en soit, il n’échappera jamais au fait qu’il est et qu’il ne sera jamais qu’un gamin en proie à la terreur.
La monstruosité de Donald est la manifestation même de sa faiblesse à laquelle il a tenté d’échapper sa vie durant. Pour lui il n’a jamais existé d’autre option que de se montrer positif, de projeter la force, aussi illusoire soit-elle, parce que faire autrement équivaudrait à une condamnation à mort ; la brièveté de la vie de mon père en est la preuve. Le pays souffre maintenant du même « esprit positif » toxique que mon grand-père sut déployer pour noyer sa femme souffrante, pour tourmenter son fils à l’agonie, et endommager par-delà tout espoir de guérison possible le psychisme de son enfant favori : Donald J. Trump » (pp. 209-211).
Interrogée récemment par une journaliste sur le pourquoi de l’insistance embarrassante de Trump qu’il avait réussi un test cognitif apparemment élémentaire : « On vous demande de répéter ‘femme, fenêtre, chameau, homme, vitre’. Vous voyez, rien de compliqué : ‘femme, fenêtre, chameau, homme, vitre’. Évidemment, il faut le dire dans le bon ordre. Il y a sans doute des gens qui n’arrivent pas à faire ça : ’femme, fenêtre, chameau, homme, vitre’, mais moi j’ai été félicité, on m’a dit ‘Bravo !’, etc. », Mary L. Trump répondit sans hésiter à la journaliste : « C’est sa façon à lui de dire que ce test, il y a échoué ».
Autre trait de caractère de son oncle qu’elle tient à souligner : le sadisme que lui permet les relations de pouvoir. Elle raconte ainsi que quand elle fut présentée à Melania qui entrait alors dans la famille, Trump dit devant elle, arborant un immense sourire : « Ma nièce, qui a eu de sérieux problèmes de drogue mais qui s’en est bien sortie ! », alors qu’il savait que c’était faux, dit-elle : « Il jouissait du fait que je n’étais pas en position de rétorquer aussitôt que c’était faux. »
L’anecdote m’en rappelle une, personnelle. J’avais été invité à un événement prestigieux pour avoir prédit la crise des subprimes et en avoir décrit le mécanisme de manière anticipée. Nul parmi les présents n’ignorait qu’il s’agissait là de la justification de mon invitation. Un autre intervenant a alors affirmé dans son allocution que la crise des subprimes était imprévisible et que nul n’aurait été à même de la prévoir. Il était radieux et à la Banque de France, j’étais moi le bénéficiaire de vos généreux dons sur mon blog, toutes les portes m’étant fermées malgré la notoriété que j’avais acquise, (je devrais plutôt écrire « du fait de la notoriété acquise… »). Quand j’ai entendu l’anecdote de Mary L. Trump sur son oncle Donald, j’ai pu imaginer du coup sans difficulté le sourire de triomphe qui devait illuminer son visage, le même que j’avais vu moi : d’avoir compris comment « le monde marche vraiment » : les purs rapports de force, indépendamment de sornettes comme la vérité ou la réalité (ou la décence ordinaire = « gentillesse »).
Laisser un commentaire