À propos de Bernard Lahire, Les structures fondamentales des sociétés humaines, Paris : La Découverte 2023, 971 pp.
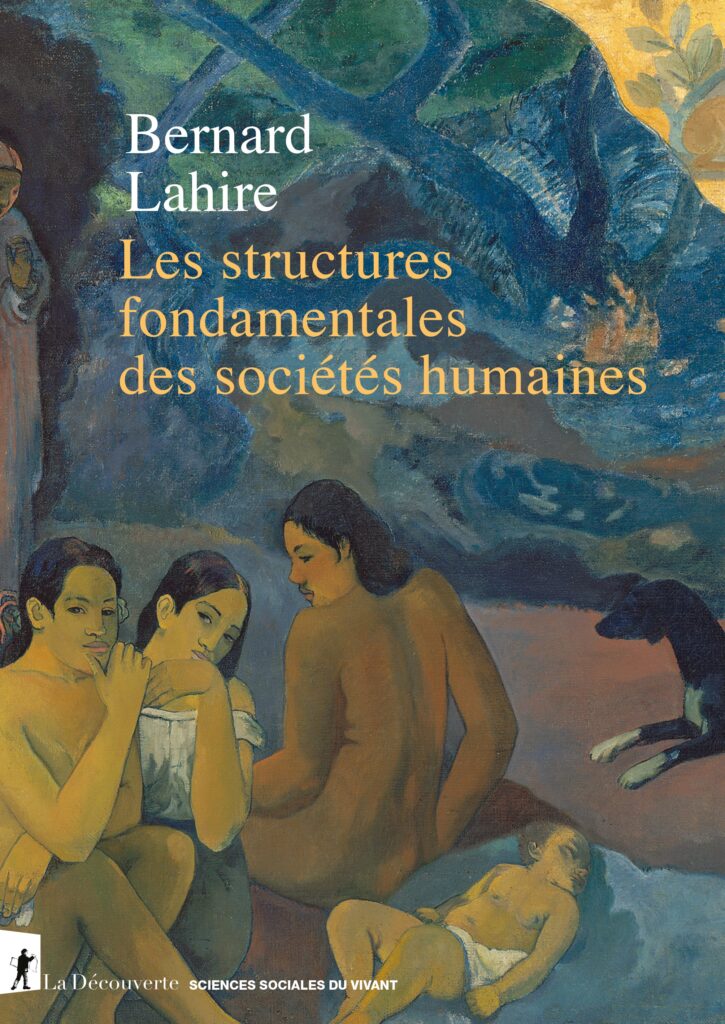
Ce que Bernard Lahire tente dans Les structures fondamentales des sociétés humaines, c’est définir le genre humain à partir d’une série de prédispositions qui seraient les siennes, et seulement les siennes, par opposition à celles des grands singes en général. Une telle caractérisation montrerait que l’humain aura bien été au fil des millénaires ce qu’on aurait pu en dire a priori, c’est-à-dire à partir de ses seules prédispositions en lesquelles seraient inscrites implicitement les lois ayant assuré qu’il serait inéluctablement ce qu’on a pu constater qu’il a bien été au fil des millénaires. Autrement dit, une définition de l’humain qui aurait permis il y a 100.000 ans de répondre à la question : « Lequel parmi les grands singes sera-t-il le premier à poser le pied sur la lune ? ». La question paraît stupide seulement parce que nous la posons a posteriori, si elle avait en effet été posée en ces temps reculés elle aurait été éminemment pertinente et une réponse documentée, éminemment éclairante.
La différence observée sur cette période de 100.000 ans, c’est ce qu’on appelle l’Histoire du genre humain, laquelle est fertile en péripéties, en informations à mentionner impérativement du fait de leur pertinence quand il s’agit de rendre compte de l’évolution constatée sur ces entrefaites. La question posée implicitement par Lahire est : « Aurait-on pu prédire le déroulement de l’Histoire à partir seulement de ce que l’on savait de l’humain en début de période ? ». Mais qu’est-ce que l’humain sans son histoire ? c’est le biologique augmenté d’une sociologie et d’une psychologie commune aux grands singes dans leur ensemble où se dissout tout ce qui distingue le genre humain. Dire des autres grands singes ce que l’on sait d’eux en négligeant de mentionner leur histoire : la différence entre ce qu’ils étaient il y a 100.000 ans et ce qu’ils sont maintenant, importe peu en réalité, alors que parler des humains sans raconter leur histoire, c’est au contraire négliger l’essentiel de ce qui les a faits tels qu’ils sont aujourd’hui. L’observation est banale car elle semble aller de soi, elle interroge toutefois d’emblée quant à la pertinence du projet de Lahire dans Les structures fondamentales des sociétés humaines : rendre compte de l’histoire humaine mais sans avoir à la raconter.
Non pas bien entendu que Lahire ignore tout de l’information que nous procure l’Histoire sur l’humain mais c’est que pour lui, raconter l’Histoire et « formuler des lois ‘historiques’ » sont une seule et même chose. Or l’un ne suppose pas nécessairement l’autre : il peut y avoir de l’histoire sans qu’il soit possible pour autant d’en tirer des « lois historiques » qui en rendraient compte.
Lahire cite ainsi l’éthologiste Frans de Waal : « Tout comme nous, les singes petits et grands luttent pour le pouvoir, jouissent du sexe, veulent la sécurité et l’affection, tuent pour le territoire et valorisent la confiance et la coopération » (48), pour ajouter qu’il convient de mentionner davantage d’éléments, sans quoi – dans la formulation qui est la mienne – l’on ne comprendra jamais pourquoi l’homme a marché sur la lune alors que ses cousins n’en sont toujours pas là : « … je pense qu’il est préférable de mettre au jour des grands faits biologiques et sociaux, des lignes de force et des lois universelles, présents depuis le début de l’humanité, et qui s’observent toujours dans le présent de l’observateur, que de formuler des lois ‘historiques’, au sens de lois qui ne valent que pour un type de société donné » (47). On ne peut qu’acquiescer : il ne s’agirait pas en effet d’attribuer accidentellement, comme propres à l’humain, des traits qui ne caractérisent que l’une des deux grandes options culturelles que l’humanité s’est inventées : d’une part, l’Extrême-Orient, la Chine, et sa pensée intrinsèquement symétrique et d’autre part, l’Occident, le Croissant fertile, et sa pensée au contraire intrinsèquement anti-symétrique (Jorion 1989 : 87-91 ; 2009 : 42-47, 74-79, 178-192), toute généralisation quant à l’humain à partir des particularités de l’une ou de l’autre étant nécessairement invalidée quand il s’agit de rendre compte de l’ensemble.
Ce à quoi vise Lahire, c’est donc la spécificité du genre humain avant même que n’ait débuté son histoire mais permettant toutefois de comprendre les grandes lignes de cette histoire à venir. Mais pour cela, il faut quelque chose à quoi accrocher ce qui deviendrait l’histoire du genre humain : un germe au-delà de le graine encore inerte, un temps où le temps suspendait encore son vol. Il écrit : « On peut faire l’hypothèse que les premières formes de vie sociale humaine, qualifiées dans la littérature anthropologique ou sociologique de ‘formes élémentaires’ ou ‘primitives’, livrent plus clairement l’essentiel de ce que sont les sociétés humaines » (48). Mais ne s’agit-il pas là, dans ces « formes élémentaires » ou « primitives » du mirage qui finit par miner l’école évolutionniste en anthropologie sociale ou culturelle : que les us et coutumes des « Sauvages » et « Barbares » que découvrirent les voyageurs européens des XVe au XVIIIe siècles constituaient des témoignages fiables, véritables survivances des temps passés, et non des formes régressives, repliées en des zones-refuges, de civilisations antiques ayant connu des jours meilleurs ? Les travaux de Joseph Tainter (The Collapse of Complex Societies 1988) et de Jarred Diamond (Guns, Germs, and Steel : The Fates of Human Societies 1997) en particulier ont attiré notre attention sur l’effondrement des civilisations du fait de l’épuisement de leur ressources environnementales, effondrements dans les ruines desquels ont continué de vivre des populations dont le nouveau dénuement ne témoignait en rien de formes « élémentaires » au sens de « premières », proches des origines, mais d’une forme appauvrie, diminuée, de leur gloire d’autrefois.
Un germe, c’est ce que Rousseau avait su proposer quand il parla, non pas du « bon Sauvage », comme on l’imagine souvent, catégorie hétéroclite selon lui, mais d’un « homme de la société naissante » encore appelé par lui « homme de l’âge des Cabanes », quand le genre humain est déjà enceint de son histoire en gestation, mais sans que cette histoire ne se soit déjà déroulée ni même enclenchée : l’homme historique tout entier encore en potentialité. Un âge où, dira Rousseau, il eut mieux valu qu’il restât confiné :
« Voilà précisément le degré où étoient parvenus la plûpart des Peuples Sauvages qui nous sont connus ; et c’est faute d’avoir suffisamment distingué les idées, et remarqué combien ces Peuples étoient déjà loin du premier état de Nature, que plusieurs se sont hâtés de conclure que l’homme est naturellement cruel et qu’il a besoin de police pour l’adoucir, tandis que rien n’est plus doux que lui dans son état primitif, lorsque placé par la nature à des distances égales de la stupidité des brutes et des lumières funestes de l’homme civil, et borné également par l’instinct et par la raison à se garantir du mal qui le menace, il est retenu par la pitié Naturelle de faire lui-même du mal à personne, sans y être porté par rien, même après en avoir reçû » (Rousseau 1964 : 170).
Mais cela, rester cantonné en ces temps bienheureux, l’homme de l’âge d’Or des Cabanes ne le put point. Et s’il ne l’a pas pu, ce n’est nullement en raison d’un trait pervers de sa personnalité : c’est du fait de l’écliptique de la planète Terre, de la légère inclinaison sur son axe, qui fait que dans les climats tempérés, il fait cependant froid l’hiver.
C’est ici que réside le paradoxe apparent selon Rousseau : l’homme n’est pas sociable par nature, mais la nature lui interdit de ne pas le devenir. Si la nature avait voulu perpétuer l’homme naturel, elle n’aurait pas distingué l’équateur de l’écliptique.
Relisons ce qu’il en dit : « Si l’écliptique se fût confondu avec l’équateur, peut-être n’y eût-il jamais eu d’émigration de peuple et chacun, faute de pouvoir supporter un autre climat que celui où il était né, n’en serait jamais sorti. Incliner du doigt l’axe du monde ou dire à l’homme : Couvre la terre et sois sociable, ce fut la même chose pour celui qui n’a besoin ni de main pour agir ni de voix pour parler » (Rousseau 1964 : 531).
Et si l’on entend vivre de manière sédentaire là où il fait froid à la mauvaise saison, il faut apprendre à se couvrir et trouver à se chauffer et se sustenter d’aliments que l’on aura auparavant engrangés, autrement dit, sur ces trois points, se montrer inventif. Une fois la preuve de l’inventivité ayant été faite, la mécanique se met en route : imperceptiblement au départ et à un rythme de plus en plus accéléré par la suite. Si bien que l’homme quitte l’âge des Cabanes sans espoir de retour. Le genre humain émerge du néolithique, même si ce n’est peut-être pas une fois pour toutes du premier coup.
Pourquoi vouloir chercher à définir l’essence de l’homme autrement qu’en rapportant son histoire, et si la tâche apparaît justifiée pourquoi ne pas s’en tenir à une représentation où les critères retenus sont les mêmes que ceux valant pour les autres grands singes ? Des « lois » auraient bien du mal à rendre compte des différences.
L’approche classique de la question que pose Lahire était celle dont Hegel fut le promoteur, à savoir affirmer dans un premier temps que toute logique des prédispositions est condamnée à l’échec en termes de prévisibilité des événements, et préciser dans un second temps que les sociétés humaines sont faites d’histoire, à savoir que dans un monde en devenir et peuplé d’une multitude d’agents, l’intrication des interactions entre eux façonnera ce qui se passera dans les faits, reléguant les prédispositions au rang d’inventaire inerte de potentialités privées de réelle descendance dans un univers où les singularités des individus se noient nécessairement dans le brouet de la marmite collective de l’Histoire. Pensons aux trois « grands hommes » que Hegel invoque dans La Raison dans l’Histoire (1813) : Alexandre, César et Napoléon, qu’aurait pu nous indiquer du cours de l’Histoire telle qu’elle eut lieu, la connaissance que nous aurions pu avoir du QI de ces trois hommes ou du résultat de tout test d’aptitude qu’ils auraient passé ?
Entre prédispositions et histoire, entre l’« en puissance » et l’« en acte », une voie moyenne pour une lecture de l’Histoire serait celle d’un juste milieu : dégager ce qui aurait pu être prévu de l’Histoire par le simple exercice des potentialités et ajouter, pour que le tableau fût complet, ce qui relève des purs aléas, des contingences : le fruit des interactions de processus non-linéaires, ceux où des effets de seuil produisent des sauts, voire des émergences, c’est-à-dire d’entières reconfigurations à un niveau supérieur d’organisation.
Mais il y a sans doute mieux à faire, à savoir distinguer de manière précise les plages du devenir où le monde en puissance déterminera entièrement, et de manière prévisible, ce que sera l’Histoire, et les plages du devenir où le monde en acte n’aura jamais été inscrit dans le monde en puissance ou, plus exactement, là où le monde en puissance n’aura pu dire qu’une seule chose : je suis le départ d’un processus dont la nature précise, bien qu’au déroulement inéluctable, ne sera connue qu’au moment où il aura abouti, la prévisibilité étant nulle d’une étape à la suivante, la seule chose qui soit connue étant la règle présidant à la transformation du monde du moment t au moment t + n. J’ai introduit il y a bien des années pour distinguer ainsi le prévisible à partir des prédispositions et l’imprévisible, le concept de « nervures du chaos » (Jorion 1988).
Cette notion existe, même si elle n’est apparue que très récemment dans la théorie, il s’agit de ce que le mathématicien-physicien Stephen Wolfram appelle l’ « irréductibilité computationnelle » ou « irréductibilité quant au calcul » : le processus connaissable seulement à partir de l’observation de son déroulement complet de son début à sa fin. Dans cette perspective, le comportement des grands singes privés d’histoire est descriptible et prévisible sous la forme de lois, d’équations de fonctions, alors que celui de l’humain l’est seulement en tant que compte-rendu complet de son plein déploiement, à cela près qu’il existerait, comme « nervures du chaos » de l’histoire humaine, la part qui pourrait s’expliquer entièrement en tant que devenir du « grand singe prolongé ».
Or Lahire introduit d’autres éléments, dont la capacité d’apprentissage et la division sociale du travail, mais pas que, en fait une foule d’autres éléments. Voyons plutôt :
« Dans toutes les sociétés humaines connues, il y a des processus de socialisation (apprentissage-mémorisation), des rapports parents-enfants, une différenciation sexuelle et des rapports sexuels, des interactions sociales, du langage, de la fabrication, de l’usage et de l’accumulation d’artefacts, de savoirs et de techniques, et donc de l’histoire, des êtres humains qui dorment et qui rêvent, de la division du travail ou de la différenciation des fonctions (plus ou moins hiérarchisées), des institutions et des groupes eux-mêmes en partie liés à la différenciation sociale des fonctions ou des activités, des relations d’interdépendance plus ou moins équilibrées entre individus ou entre groupes, des tensions entre des ‘nous’ et des ‘eux’, des rapports de domination plus ou moins institutionnalisés, des formes de magico-religieux, etc. » (46).
On aura même noté dans cette liste, où l’on trouve, comme attendu, la biologie des grands singes et les éléments de leur psycho-sociologie rudimentaire, également « de l’histoire », à savoir l’ingrédient qu’il aurait fallu précisément contourner à tout prix si l’on avait fait le choix d’une caractérisation du genre humain à partir de ses prédispositions plutôt que de son histoire. Mais comment aurait-il été possible de faire autrement et de manière sûre, la preuve du fait que c’est bien l’homme qui a marché sur la lune et non le gorille ou l’orang-outang ?
Je pense à mon ami Jean Pouillon (1916-2002), écrivain et anthropologue, secrétaire de Jean-Paul Sartre et de Claude Lévi-Strauss à différentes époques, ayant fait du terrain en Ethiopie et au Tchad et qui entretenait une conception hérétique du genre humain qui le conduisait à être tout particulièrement critique envers l’anthropologie de l’école fonctionnaliste selon laquelle les sociétés constituent un tout intégré. Pour lui, d’après ce qu’il avait pu observer sur le terrain, ce n’était pas le cas.
À ma connaissance, Pouillon n’a jamais théorisé sa conception laxiste des sociétés humaines : je ne l’ai jamais rencontrée dans un de ses textes, mais je peux me tromper. Je la mentionne quelquefois comme hypothèse du « tout est permis ou presque ». Pouillon disait en substance : « À condition d’avoir trouvé comment se préserver des bêtes sauvages, il est en réalité très facile pour une société humaine de survivre dans un environnement comme celui de l’Amazonie ou celui de la forêt tropicale en général : il y suffit en fait de tendre la main pour cueillir des bananes ou d’autres fruits, et cela, quelle que soit la forme de ses institutions ». Il ne s’agissait pas de propos de salon chez Pouillon : il l’avait vu faire sur le terrain. J’ai moi-même pu observer cela effectivement à certains endroits en Afrique où les gens du lieu travaillaient de l’ordre de deux heures par jour et cela suffisait amplement. « Amplement », non pas pour devenir riche en vendant sur des marchés mais en tout cas amplement suffisant pour vivre au jour le jour si l’on n’exige pas davantage de la vie. L’hypothèse du « tout est permis ou presque » suggère que les sociétés humaines ont bénéficié d’une nature environnante extrêmement favorable au grand singe né en Afrique qu’est l’être humain. Bien sûr, quand, piégé par l’écliptique qui fait que des lieux extrêmement accueillants l’été lui sont particulièrement hostiles l’hiver, et qu’il a alors refusé de déguerpir, il s’est sérieusement compliqué la vie et a dû puiser dans son inventivité pour ne pas périr de froid et de disette. Il l’a compliquée à ce point, sa vie, qu’elle est devenue l’Histoire.
J’ai, de mon côté, au fil des années, tenté de résumer la dynamique des sociétés humaines à partir de trois prédispositions : l’homme en tant qu’animal social, colonisateur et opportuniste.
L’exercice de comparaison consisterait alors à évaluer en parallèle la prévisibilité de l’histoire humaine telle qu’elle a effectivement eu lieu à partir d’un modèle fait du plus petit nombre de principes généraux constituant son armature, trois modèles au moins étant alors en compétition : celui de Rousseau, celui de Lahire, et le mien. À moins qu’on ne s’en tienne à la vision de l’évolution du genre humain qu’en eut Hegel : l’Esprit du monde se réalisant à travers son histoire, cachant son but à toutes et à tous, à l’exception d’une poignée de grands hommes capables de déceler la ruse de la Raison ainsi à l’œuvre, de l’identifier et d’en faire leur propre objectif.
Pour Rousseau, je retiendrai comme éléments constitutifs de l’humain à l’« âge des Cabanes » en tant qu’époque de l’« homme de la Société naissante », façonné déjà par la contrainte empirique, objective, qu’est l’écliptique : la langue, la musique, la propriété privée et le contrat social, à savoir l’événement mythique mais néanmoins historique dans les représentations, point de bascule de la condition humaine, quand dans un même mouvement, certains de ses représentants s’accordèrent pour sacrifier une part de leur liberté au bénéfice d’une sécurité accrue pour la communauté dans son ensemble et rédigèrent le contrat social, enfin, et non des moindres parmi les facteurs distinguant l’être humain des autres créatures : la prise de conscience par l’espèce de la mortalité individuelle de ses membres, débouchant sur un foisonnement de spéculations du type : « Comment cela est-il Dieu possible ? », dont Lévi-Strauss établira la cartographie et les principes de transformation des unes dans les autres, l’ensemble constituant une mosaïque kaléidoscopique, tant la variété de ces spéculations au fil des âges a été grande.
Quant à moi, j’ai pris l’habitude d’ajouter au comportement social du genre humain, son comportement colonisateur et son comportement opportuniste à entendre comme sa capacité à développer devant l’obstacle à première vue infranchissable, des stratégies de contournement. Pour expliquer que l’humain s’aventure délibérément en des lieux qui lui sont peu propices, l’hypothèse d’une pulsion exploratrice est indispensable.
À ces trois traits on me permettra d’ajouter un quatrième, dont l’existence m’était jusqu’à récemment largement passée inaperçue et sur laquelle c’est la mise au point des Grands Modèles de Langage qui attira mon attention : la capacité de la langue en tant que telle de faire émerger en son sein, par le simple effet d’une augmentation en taille du corpus de signes et de la complexification du support physique de la mémoire qu’est notre réseau neuronal naturel, une modélisation spontanée du monde de plus en plus sophistiquée : non seulement une émergence de la logique et de la capacité à l’apprentissage, comme j’avais eu autrefois l’occasion de le signaler quand j’avais programmé (1987-1990) le logiciel ANELLA (Associative Network with Emergent Logical and Learning Abilities), aux propriétés émergentes de logique et d’apprentissage (Jorion 1989), mais aussi une séparation spontanée, accompagnée d’une spécialisation, de la syntaxe et de la sémantique avec la montée en taille du corpus, et une scission spontanée là aussi des notions de temps et d’espace pour rendre compte du devenir du monde, sans parler de l’émergence de la conscience à propos de laquelle le débat fait aujourd’hui rage de savoir si elle a déjà eu lieu dans la machine.
Reprenons à partir de ces éléments rappelés, le modèle de Lahire et voyons s’il n’est pas possible de le simplifier et de le recomposer de manière plus économique en en combinant autrement les morceaux.
Voici un paragraphe à intention synthétique rassemblant les éléments de thèse du livre :
« L’essentiel de cet ouvrage est donc consacré à faire état d’une recherche de longue haleine sur les conditions générales de fonctionnement et d’évolution des sociétés humaines. Dans ce retour sur plus de cent cinquante ans de recherches pluridisciplinaires sur les sociétés humaines, je me suis efforcé de revenir aux racines du fait social humain, de toujours repartir de faits biologiques souvent bien connus (altricialité secondaire, partition sexuée, longévité de l’espèce, etc.) et de questions simples mais fondamentales (la nature sociale de l’Homme, sa capacité langagière-symbolique, sa production d’artefacts, la transmission et la cumulativité culturelles, la division du travail, le magico-religieux, la domination, et notamment la domination masculine, les rapports parents-enfants, aînés-cadets, l’ethnocentrisme sous toutes ses formes, la pensée analogique, etc.), la réponse à des questions simples pouvant donner lieu, cela va de soi, à des développements longs et complexes, mais dans lesquels j’ai essayé de ne pas perdre le sens de l’essentiel » (51).
On voit là les éléments communs aux grands singes : partition sexuée, longévité de l’espèce, une nature sociale, les rapports de domination, les rapports parents-enfants, aînés-cadets, l’ethnocentrisme sous toutes ses formes, Également un élément biologique propre à l’homme : l’altricialité secondaire, dont Wikipédia nous apprend (c’est mon cas) qu’il s’agit du fait que « la croissance du cerveau s’effectue essentiellement après la naissance et durant une période relativement longue (presque le dixième de sa durée moyenne globale) », mais on regrettera pour la clarté de l’exposé qu’ils soient mêlés dans la liste à ceux qui sont propre à l’humain comme la capacité langagière-symbolique, la production d’artefacts, la transmission et la cumulativité culturelles, la division du travail, le magico-religieux, la pensée analogique.
Certains traits là relèvent du langage et de ses retombés, comme la pensée analogique, ainsi que de l’opportunisme, à savoir la capacité à contourner l’obstacle : la production d’artefacts. Quant à la transmission et la cumulativité culturelles, elles apparaissent au point de rencontre du langage et de la disposition technologique, fruit de l’inventivité : mise au point de l’écriture, puis de divers types de support pour elle, comme la terre cuite, le roseau déroulé, le papier, la cassette, le CD et la clé-USB, ainsi que les techniques de diffusion du texte écrit : imprimerie, fax, internet. La division du travail résulte d’une optimisation du temps et des moyens et relève donc d’une explication de type « matérialisme vulgaire » : la division du travail est plus économique. Enfin le magico-religieux est né dans le sillage de la peur de la mort individuelle, dans les tentatives de prolonger sa propre vie et celle de ses amis et d’écourter celle de ses ennemis pour la magie et, pour le religieux, d’exorciser par des récits la tragédie du destin humain.
Références :
Diamond, Jarred, Guns, Germs, and Steel : The Fates of Human Societies, New York : W. W. Norton 1997
Hegel, G. W. F., La Raison dans l’Histoire (1813), Paris : UGE 1965
Jorion, Paul « ‘Les nervures du chaos’ ou une physique sociale de Durkheim à Lacan », Synapse, mai 1988, n°44 : 30-40
Jorion, Paul, Principes des systèmes intelligents, Paris : Masson 1989 ; Boisseaux : Le Croquant 2012
Jorion, Paul, Comment la vérité et la réalité furent inventées, Bibliothèque des sciences humaines, Paris : Gallimard 2009
Rousseau, Jean-Jacques, Œuvres complètes III, Bibliothèque de la Pléiade, Paris : Gallimard 1964.
Tainter, Joseph The Collapse of Complex Societies, Cambridge : Cambridge University Press 1988
P.S. Ce compte-rendu devrait paraître dans une revue. Je vous tiendrai au courant.
Laisser un commentaire