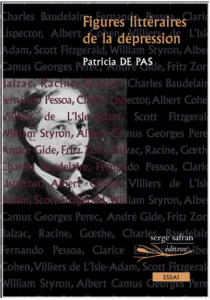 L’homme invisible est nécessairement déprimé
L’homme invisible est nécessairement déprimé
À propos de Patricia De Pas, Figures littéraires de la dépression, Paris : Serge Safran éditeur 2021, 151 pages
Le contrat social, conçu par l’Anglais Thomas Hobbes, et mis au point par le citoyen de la République de Genève qu’était Jean-Jacques Rousseau, suppose qu’un petit groupe de nos aïeux se soient un jour concertés puis mis d’accord pour sacrifier une part de la liberté dont été faite leur périlleuse vie solitaire pour gagner en sécurité dans un pacte commun qui unirait leurs efforts.
Il s’agit d’une légende bien entendu : un tel événement n’a jamais eu lieu. Le mythe est cependant puissant puisqu’un scientiste aussi militant que Sigmund Freud allait encore le répétant. Et pourtant, deux millénaires auparavant, Aristote le Stagirite, disait déjà de l’animal Homo sapiens : « zoon politikon », à entendre comme « animal vivant en société ».
Un animal vivant à ce point en société qu’isolé durant de longues périodes, il perd tout repère. Tout lecteur de Defoe aura compris que s’il n’avait rencontré Vendredi, Robinson Crusoé aurait sombré dans la folie. Le confinement solitaire est d’ailleurs un supplice bien connu.
Et qu’aimons-nous faire ensemble ? Transformer le monde, jouir de la différence entre un monde modifié par nous du fait de nos actes et le monde tel qu’il existerait si nous n’étions pas là. C’est de constater cela qui nous donne pleinement le sens de vivre. Mais l’observer tout seul nous indiffère : c’est la constatation par les autres de l’impact qui nous est dû qui garantit notre satisfaction. Car si nous avons besoin de l’aide des autres pour changer le monde, nous avons besoin plus essentiellement encore qu’ils confirment que, sans nous, il se perpétuerait mornement pareil à lui-même : nous voulons que l’unanimité se soit faite sur cette opinion que le monde serait bien triste si nous n’étions pas là pour bouleverser son ordonnancement selon notre bon vouloir.
Un monde dont toute marque est absente en lui de notre présence, ou bien où le peu que nous modifions passe inaperçu, voilà qui nous tue à petit feu sans aucun doute.
C’est du moins ainsi que se passaient les choses avant l’invention des anti-dépresseurs, avant l’avènement de la grande anesthésie induite par les psychotropes.
Dans Figures littéraires de la dépression, Patricia De Pas nous rappelle en effet que « L’apparition du terme « dépression » dans le langage commun est concomitante à l’invention des antidépresseurs (1957). La commercialisation de ces nouvelles molécules fut l’occasion pour les médecins généralistes de regrouper dans un diagnostic commun des pathologies qui se présentaient comme des variantes « non psychiatriques » de la mélancolie » (139).
On l’aura compris : les déprimés, ce sont les mélancoliques que quelqu’un aura jugé bon de soigner, qu’il s’agisse des intéressés eux-mêmes, ce qui est peu probable, vu précisément la psychasthénie qui les paralyse, ou plus sûrement, des médecins alertés par un entourage ayant échoué à leur offrir la reconnaissance à laquelle ils aspirent, ou qui la leur a retiré délibérément, comme ce fut le cas pour Caroline Baudelaire, la mère de Charles, lorsqu’elle le fit mettre sous tutelle. De Pas écrit à propos du poète : « Sa tentative de suicide (la seule qu’il fît) succède à une décision judiciaire qui le place sous tutelle – Caroline jugeait trop dispendieuse son utilisation de l’héritage paternel » (88). Ce que Charles commente dans une lettre qu’il adresse à sa mère : « Ce maudit conseil judiciaire m’a toujours rendu timide et maladroit » (89) : le monde s’était ligué pour que Baudelaire soit privé du pouvoir de le transformer, si ce n’est par le verbe.
Comment reconnaît-on les mélancoliques, encore appelés « déprimés » ou « dépressifs » au cas où ils sont médicamentés ou, plus joliment dit, « sous traitement » ? (Les mots ne manquent pas en effet : « mélancolie », « dépression », « cafard », « bourdon », « idées noires », spleen !). On les reconnaît à leur manque d’allant, à leur absence d’énergie, ce qu’Albert Camus appelle dans La chute « … de l’abattement si vous voulez » (29) : la léthargie (47).
« Le monde est rebelle à l’empreinte de mon existence, alors à quoi bon ? », clament les mélancoliques. Baudelaire écrit à sa mère : « Ce que je sens, c’est un immense découragement, une sensation d’isolement insupportable, une peur perpétuelle d’un malheur vague » (85) – le syndrome de Robinson Crusoé. Ou encore : « Je me demande sans cesse : à quoi bon ceci ? à quoi bon cela ? C’est là le véritable état du spleen » (87-88).
André Gide parlait de son côté et de la même manière dans Paludes d’une existence où « tous nos actes sont si connus qu’un suppléant pourrait les faire et, répétant nos mots d’hier, former nos phrases de demain » (44) : c’est-à-dire un effacement complet de tout impact auquel notre propre nom pourrait être associé, un substitut programmé pouvant tout aussi bien faire l’affaire.
Même sentiment de l’indifférence aux yeux du monde de l’existence ou non de sa personne chez Clarice Lispector, pour qui c’est pourtant davantage la folie que la mélancolie qui guette à chaque tournant de phrase : « Le monde a échoué pour moi, j’ai échoué pour le monde » (103).
Patricia De Pas a réuni dans son ouvrage une impressionnante brochette de quatorze mélancoliques où, en sus de Baudelaire, Gide et Camus, on trouve aussi quelques suspects habituels tels Goethe ou Scott Fitzgerald (« Sa vie est devenue artificielle : elle se poursuit, il n’y est plus » – 135). On regrettera seulement quelques grands absents, comme le promeneur solitaire genevois susnommé, ou Kafka, le persécuté des administrations tatillonnes décervelantes.
C’est que le spleen se récolte à foison chez les écrivains aussi longtemps que la gloire leur échappe encore, et c’est l’espérance persistante de celle-ci qui les maintient en vie. Ainsi Baudelaire : « … et que le seul sentiment par lequel je me sente encore vivre, est un vague désir de célébrité, de vengeance et de fortune. Mais (…) on m’a si peu rendu justice ! » (90). Et, « Comme j’ai un genre d’esprit impopulaire, je gagnerai peu d’argent, mais je laisserai une grande célébrité, je le sais, – pourvu que j’aie le courage de vivre » (92).
Il en vaut peut-être mieux ainsi, je veux dire de leur psychasthénie, car quand la gloire couronne ces écrivains tourmentés par la « soif de reconnaissance » (91), ils en deviennent parfois proprement insupportables. De Pas déplore ainsi dans Le livre de ma mère d’Albert Cohen, « l’autocritique exacerbée et la pitié envers soi-même » (122).
Y at-il un remède à la mélancolie, à « ces journées où je n’ai jamais eu d’avenir » (99) qu’évoquait Fernando Pessoa dans Le livre de l’intranquillité, et qui le conduisirent à rédiger de manière navrante, une « autobiographie sans événement » (100) ?
Oui, et c’est sans doute Andy Warhol qui en avait donné la recette, qu’il en soit le véritable auteur ou qu’elle lui ait seulement été plausiblement attribuée : ce quart d’heure de gloire qui sera accordé à chacun à l’avenir, et qui permettra à ce chacun de se convaincre d’avoir laissé son empreinte sur un monde qui cessa du fait même d’être tristement identique à lui-même.
Laisser un commentaire