Ouvert aux commentaires. Deux chapitres complémentaires de mon nouveau livre-manifeste.
LE MONDE TEL QU’IL EST
7. L’État de bien-être
Cet État-Providence, dont le deuxième terme de l’expression perd davantage son sens de jour en jour, nous est envié par d’innombrables êtres humains aux quatre coins de la planète, n’hésitant pas malheureusement trop souvent à mettre leur vie en jeu pour être admis au statut de l’un de ses bénéficiaires.
L’État-Providence, qu’il faudrait appeler, plutôt que par ce terme de dérision, « État de bien-être », comme le font les Anglo-Saxons, est l’un des rares modèles de structure sociale à caractère véritablement humaniste. Nous devrions en être très fiers, car il a été construit au fil d’âpres luttes et représente à ce jour le creuset des nécessités propres à l’être humain, indéniables aussi à travers l’Histoire.
Sa construction s’est édifiée sur celle de la solidarité, valeur suprême qui nous a permis de forger notre destin. C’est par elle que nous avons franchi infiniment d’obstacles, tant au niveau de notre survie matérielle qu’au niveau de notre besoin – inhérent à notre condition d’être humain – d’appartenir à un groupe dans lequel nous pouvons reconnaître autrui et en être reconnus.
Cet État transcende l’appartenance laïque ou religieuse, il représente au mieux ce que sont les véritables droits de l’homme, tant critiqués et remis en cause aux temps sombres que nous vivons aujourd’hui. Ce berceau de notre identité s’efface devant les coups de boutoir que lui portent les ennemis de l’humanisme historique.
Nous le constatons d’abord au niveau matériel lorsque, malgré le travail de toute une vie, nous accédons à une retraite nous permettant à peine de subsister, alors que d’autres, habitués à l’oisiveté, jouissent d’une santé et d’un revenu défiant l’éternité.
Nous sommes fragilisés aussi lorsque, vivant dans des régions où des industries d’un autre âge ont disparu, nous sommes mis en demeure de trouver un emploi dont l’occurrence n’a qu’une faible probabilité car cette fonction pourrait de plus en plus souvent être assurée par une machine. Le devenir propre à l’Histoire s’est retourné contre nous, sans que nous puissions répondre, tant est répandu le préjugé que nous sommes, individuellement, responsables et redevables même de notre existence. Notre atomisation est extrême et nous nous demandons à quel titre nous pourrions encore nous rattacher à la société qui exige férocement de nous des comptes tout en nous acculant à l’isolement. Nous en arrivons à nous sentir inutiles et ce sentiment suscite en nous la tentation nihiliste de tout détruire autour de nous ou de disparaître nous-mêmes.
Enfin, si nous devions tomber malades, nous craignons de plus en plus une consultation médicale ou une intervention, même banale, car les soins médicaux nous semblent inaccessibles du fait de leur coût. À l’opposé, nous nous voyons abreuvés d’images ou d’informations concernant un certain transhumanisme, un paradis au sein duquel nous pourrions récupérer quelques forces, mais nous comprenons d’emblée qu’il est destiné à une classe qui nous est étrangère, son attention fixée sur des objectifs égoïstes de perfectibilité et d’immortalité dans une vie tout entière privée de sens car coupée de l’échange avec les autres. Ce contraste nous est insoutenable lorsque la majorité de la population mondiale n’a pas accès à des soins médicaux de base.
Nous sommes d’ailleurs à peine surpris lorsqu’un film de science-fiction à grand spectacle, Elysium, nous brosse le portrait d’un monde non pas d’après-demain, mais de demain déjà, où l’humanité s’est scindée en deux sous-espèces distinctes : alors que l’une poursuit sa vie sur une terre où les villes ont toutes régressé au rang de bidonville, entourées d’un environnement pollué et dégradé pareil à un terrain vague s’étendant à perte de vue, l’autre portion du genre humain, privilégiée, elle, vit dans un monde idéal de villas luxueuses au sein de parcs impeccablement toilettés, dont chacune possède, comme un meuble de salon, un sarcophage permettant de guérir de toute maladie et garantissant du coup une immortalité meublée seulement de loisirs infinis. Nous sommes à peine surpris car ce monde de demain, scindé, à deux vitesses, nous en lisons le projet déjà bien avancé dans celui d’aujourd’hui.
Le talon d’Achille de l’État de bien-être est que l’État lui-même est depuis près de quarante ans conçu comme une entreprise commerciale. Faute pour l’État de bien-être d’avoir véritablement été inscrit dans nos institutions, la capacité de l’État à nous aider est devenue inextricablement liée à la croissance économique, très affaiblie par les temps qui courent.
Ainsi, le sort aussi bien que le but de cet État se trouve-t-il détourné de manière perverse de sa voie initiale, celle de protéger les plus démunis d’entre nous, au profit du marché triomphant.
Le monde tel qu’il devrait être
5. Faire de l’État-Providence une institution irréversible et intangible
Pendant que disparaît notre travail, un autre pilier de notre vie se fragilise parallèlement, qui la structurait et la confortait : ce que nous appelons l’État-Providence, mais que nous devrions désigner, à l’instar des Anglo-Saxons, « État de bien-être ». Son aide est en effet de moins en moins perceptible lorsque la maladie nous force à recourir aux soins de santé, lorsque nous cherchons désespérément une activité rémunératrice ou lorsqu’au soir de notre vie, nous avons besoin d’être aidés, car la vieillesse et ses handicaps prennent possession de nous.
Cette prétendue « Providence », soyons-en pleinement conscients, c’est bien nous qui l’avons appelée de nos vœux et conquise comme fruit de nos revendications, lorsque nous croulions sous le poids de longues journées de travail mal payées et d’une exploitation sans merci. Nous étions en quête d’un repos minimal, d’une assistance pour les jours où notre force de travail s’éteindrait après de nombreuses années sans plainte, ou lorsque la vie se serait montrée particulièrement cruelle envers nous. Luttant ensemble contre sa précarité, nous avons réussi à bâtir un édifice basé sur la solidarité car nous savions que seuls, nous étions impuissants face à la somme de malheurs que nous subissions. Cette solidarité a heureusement porté ses fruits. C’est elle qui nous a rendus plus forts et, au-delà de l’assistance matérielle, nous a rendu notre liberté d’expression et de revendication lorsque les circonstances l’exigent. C’est là un héritage dont nous pouvons être fiers et qui donne ses lettres de noblesse à notre humanité.
Alors que nous ressentons avec acuité le besoin d’être épaulés, dans le climat présent de disparition de l’emploi et d’une destruction massive de notre habitat qui est le produit d’une économie de marché « fondamentaliste », le reflux de la structure de l’État de bien-être nous laisse à l’abandon, nous reléguant au rang de spectateurs impuissants de nos malheureuses tribulations, n’arrivant pas à distinguer clairement qui vraiment nous dirige et quelles sont les instances auxquelles nous obéissons réellement.
Le malheur qui nous envahit nous est justifié par un principe plus que fallacieux selon lequel puisque la croissance diminue, il est normal que l’assistance de l’État se réduise d’autant. Ce retranchement arbitraire, nous le vivons comme une injustice brutale.
Nous vivons la troisième Révolution industrielle, nous n’avons guère le choix face au changement technologique immense qui bouleverse notre vie et nous devrions nous-mêmes assumer individuellement cette transition en nous proclamant auto-entrepreneurs (mais entrepreneurs de quoi ?) et en nous assurant nous-mêmes auprès de firmes à la recherche du profit, pénalisant du coup par une « prime de risque » ceux d’entre nous qui devraient au contraire bénéficier du meilleur soutien.
C’est bien le vent de l’ultralibéralisme qui souffle sur nos contrées, tendant à nous obliger, comme aux États-Unis, à nous prémunir nous-mêmes des accidents de la vie. Ce nouveau type de libéralisme prône, encore plus que l’ancien, le modèle de l’individualisme, de la compétitivité, l’admiration de celui qui « ose » prendre des risques, alors que c’est la collectivité qui paie de manière générale les pots cassés de ses engagements hasardeux.
Face à l’arrogance de ces apprentis « maîtres du monde » se tient la foule faite de nous autres, de plus en plus inquiète et malheureuse, livrée à elle-même et aux vicissitudes du destin comme lors de ces jours de grève que la faim et le désespoir rendaient interminables.
Au moment où beaucoup doivent choisir entre manger et se loger, se soigner et apprendre – et la liste est longue de ces cas de figure tragiques –, l’arrogance des très mal nommées « élites » nous enjoint de ne nous en prendre qu’à nous-mêmes pour ce déplorable état de fait.
Or, les ressources sont là, matérielles, intellectuelles, grâce à la technologie, et aussi humaines, grâce au sens de la solidarité qui nous a amenés jusqu’ici à nous montrer fraternels pour compenser les inégalités naturelles. Il est donc inacceptable de proclamer avec outrecuidance la mort de l’État de bien-être au nom d’une croissance qui ne reviendrait pas, essentiellement parce que ses fruits sont confisqués plutôt que partagés.
Bien au contraire, c’est l’État de bien-être qui doit nous offrir, grâce à l’autonomie qu’il nous procure, la possibilité de croître, de sortir grandis de notre traversée d’une période de transition sombre sans doute, mais nécessaire car elle trace la voie vers une renaissance. C’est à l’État de maintenir ce phare de l’État de bien-être au milieu de la nuit qui nous encercle, en l’inscrivant dans notre Constitution et en le mettant une fois pour toutes à l’abri des aléas de la croissance.
Proposition : Faisons de l’État-Providence une institution irréversible et intangible, en mettant fin à la dépendance qui le lie aujourd’hui à la croissance et subordonne son existence aux caprices de celle-ci, et en inscrivant la nécessité de leur consubstantialité dans la Constitution.
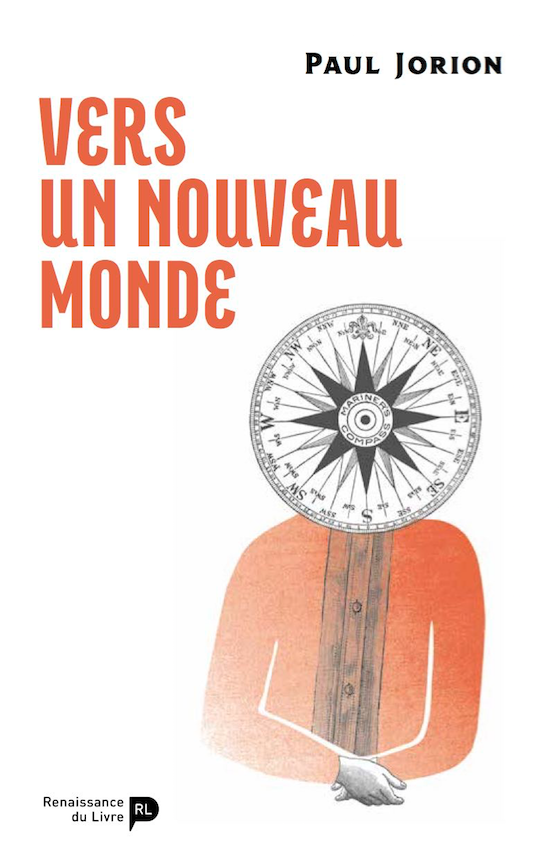
Laisser un commentaire