Ouvert aux commentaires. Deux chapitres complémentaires de mon nouveau livre-manifeste.
LE MONDE TEL QU’IL EST
11. Notre vraie Constitution : les règles comptables
Nos sociétés sont dites « démocratiques » car nous avons le droit d’élire nos représentants, mais nous découvrons jour après jour que toutes les décisions qui importent réellement dans la conduite de nos vies sont prises ailleurs, par d’autres et le plus souvent à notre insu.
Une étude de deux professeurs américains publiée en 2014 nous montre qu’aux États-Unis, sur 1 779 desiderata émis par le public, dont ils ont découvert la présence dans la presse, seule une poignée d’entre eux a trouvé son expression au niveau parlementaire et finalement sous forme de loi, ceux, disent-ils, qui correspondaient aux vœux « des élites économiques et de groupes organisés représentant les intérêts du milieu des affaires ».
Sur qui précisément compose ces « élites », une étude menée en Suisse en 2011 nous a informés. Une équipe de l’École polytechnique de Zurich a en effet mis en évidence que 737 entreprises constituent 80 % de la richesse du monde et un noyau plus petit de 147 d’entre elles 40 % déjà, trois quarts de celles-ci étant des banques.
Des appartenances multiples aux conseils d’administration font, nous expliquent-ils, que c’est un nombre plus restreint encore de personnes qui décident du cours économique du monde.
Avons-nous jamais voté la règle qui dit que les salaires sont des coûts pour l’entreprise, coûts qu’il faut bien entendu à tout prix faire baisser, tandis que les dividendes des actionnaires et les bonus indécents des patrons sont des parts de bénéfice, le bénéfice étant, comme chacun sait, la chose la plus admirable au monde, bien avant la vie elle-même, et qu’il faut faire croître autant que possible, nulle limite à la hausse ne lui étant connue ? Pourtant, c’est cette règle qui fait que le patron licenciant ses travailleurs obtiendra de son conseil d’administration une prime au prorata du nombre de travailleurs licenciés, parce qu’il a réduit ainsi les coûts de l’entreprise. Il y a là une application révoltante du principe des vases communicants dont nous ne jugeons cependant jamais utile de remettre la logique en question.
Ne sont-ce pourtant pas des règles comme celle-ci qui donnent véritablement leur forme à la société où nous vivons ? Ne devrait-on pas dire d’elles qu’elles sont la véritable Constitution réglant nos vies, plutôt que le texte que nous appelons ainsi, fait de beaux principes sans doute mais qui n’en sont pas moins autant de lettres mortes ?
Qui sait aujourd’hui que ces règles comptables sont édictées par une firme privée, l’IASB (International Accounting Standards Board), dont le parent est domicilié dans un paradis fiscal (l’État du Delaware aux États-Unis), et que ses membres sont les grandes firmes d’audit et les représentants des plus grosses transnationales au prorata de leur cotisation ?
Est-ce normal ? L’intérêt général est-il bien assuré de cette manière ?
Le monde tel qu’il devrait être
3. Remettre en question la définition du salaire comme « coût pour l’entreprise »
Pour qu’une entreprise fonctionne de manière optimale, il faut qu’elle dispose de capital, assurant l’accès à la logistique : locaux, énergie, machines, matières premières. Il est entendu qu’une coordination de l’activité et une surveillance du processus de production sont nécessaires à l’aboutissement de la tâche. Il est évident cependant que les travailleurs sont au fondement même d’un projet de cette nature et que sans eux, dans le contexte présent en tout cas (tant que les nouveaux progrès de la mécanisation n’auront pas rendu entièrement caduque leur intervention), l’entreprise n’existerait pas.
Aujourd’hui, la pyramide se tient sur sa pointe : ceux qui pourvoient à l’infrastructure de notre confort, de nos équipements souvent vitaux sont perçus dans la chaîne de production comme des éléments subsidiaires, pour plusieurs raisons : en raison de justifications qualifiées de hiérarchiques, alors que celles-ci masquent souvent simplement une utilisation abusive du pouvoir, en raison aussi de facteurs pratiques liés à la diminution de la consommation liée elle-même à la régression du pouvoir d’achat ainsi qu’à l’automation et à l’informatisation éliminant chaque jour des milliers d’emplois.
Devant un tel déséquilibre, plusieurs scénarios voient le jour, l’un nous ramenant par sa malheureuse actualité à la souffrance si présente au XIXe siècle, lorsque les travailleurs retiraient de leur labeur à peine de quoi survivre et pas assez certainement pour se soigner ni assurer leur existence ou celle de leurs enfants au niveau élémentaire. Au XIXe siècle, les patrons avaient trouvé le moyen de tirer encore un profit supplémentaire du maigre salaire de leurs travailleurs en leur donnant en location de petites habitations qu’ils faisaient bâtir et en achetant les épiceries qu’ils fréquentaient. Aujourd’hui, c’est le service du crédit facile qui s’est substitué à ces procédés, le crédit ancrant le travailleur à l’emploi qui lui permettra de rembourser le principal et de s’acquitter des intérêts et relançant la machine économique à laquelle préside le patron.
L’emploi, facteur d’insertion dans une société conviviale, est devenu son contraire : un lieu de disparités, dans notre société dominée par les plus forts. Alors que dans l’un des camps, celui du travail, la situation s’aggrave de jour en jour, dans l’autre, l’exigence devient de plus en plus forte : il faudrait – paraît-il – réduire les charges patronales de manière à créer de l’emploi. Mais la difficulté là est la suivante : les baisses exigées n’ont pas créé l’emploi escompté, et pour cause : le travail est de plus en plus effectué non plus par des êtres humains, mais par des robots et des logiciels et les sommes obtenues par la réduction des charges ne peuvent aboutir que là où des chenaux déjà bien tracés les conduisent par une pente naturelle : en dividendes versés aux actionnaires et en gonflement supplémentaire de bonus aux montants déjà extravagants.
L’injustice est à son comble quand, au moment où les banques voient leur grenier à nouveau bien garni en raison de l’obligeance de l’État à leur égard (la nôtre, en réalité, à nous les citoyens), prêt à leur pardonner leurs frasques en raison du « risque systémique » qu’elles font courir à l’économie (rien d’autre en réalité qu’une forme de chantage), succède une politique d’austérité qui exige de nous un effort supplémentaire : non seulement assumer la dette, mais nous convertir à l’austérité en soi, pour en faire notre mode de vie.
En plus d’être tenus pour responsables d’une dette dans laquelle nous ne sommes pour rien, il nous est enjoint de nous sentir coupables de son existence en tant que telle.
Le temps où l’irresponsabilité des banquiers faisait la une des journaux a rapidement laissé la place à celui où c’est nous qui nous voyons reprocher, en guise d’explication de la régression sociale que nous subissons, d’avoir « vécu au-dessus de nos moyens ». Mais l’imposture est flagrante et le moment est venu pour nous de nous lever et de le dire haut et clair : « Ce n’est pas nous ! C’est vous, Messieurs de la finance, qui, vivant à nos dépens, avez vécu au-dessus de nos moyens ! »
Alors que les travailleurs eurent à souffrir à titre personnel, et au titre de leurs familles, des conséquences de la récession née de la crise des subprimes et réglèrent rubis sur l’ongle, en tant que contribuables, l’ardoise salée qu’on leur présenta une fois les banques renflouées, les détenteurs d’obligations – directement ou par le biais d’une assurance contractée ou d’un fonds auquel on souscrit – furent eux à l’abri des retombées de la crise grâce à la protection absolue garantie par un instrument financier magique appelé le Credit default swap (CDS). Non pas parce qu’il serait miraculeux en soi, mais parce que lorsque la compagnie d’assurance American International Group (AIG), qui garantissait la majorité de ces contrats, s’effondra, l’ensemble des gouvernements, des États-Unis au Japon en passant par l’Europe, volèrent à son secours, si bien que pas un seul centime ne fut en fin de compte perdu.
Là encore, ce furent les contribuables dans leur ensemble qui sauvegardèrent la fraction la plus riche d’entre eux, celle qui, quant à soi, par la pratique de la bien nommée « optimisation fiscale », parvient déjà pour une grande part à échapper à l’impôt, c’est-à-dire à la solidarité nationale.
La crise de 2008 restera dans l’histoire comme l’illustration la plus parfaite de la logique selon laquelle notre société inégalitaire fonctionne réellement, selon le principe le mieux caché sans doute mais cependant le plus fondamental, le plus révélateur d’où vont ses préférences à l’égard des différentes catégories socio-économiques de citoyens : « Privatiser les bénéfices, socialiser les pertes ».
Or, nous n’y sommes strictement pour rien si la spéculation et l’avidité de profit de la classe possédante malmènent les non-possédants, nous n’y pouvons strictement rien si la troisième révolution technique mondiale amène avec elle des créatures conçues pour nous aider mais qui dans la réalité nous remplacent une fois pour toutes et engraissent encore davantage leurs propriétaires plutôt que de redistribuer leur manne à la communauté dans son ensemble, communauté qui a pourtant rendu possible leur venue par ses efforts.
La volonté de culpabilisation à notre encontre de cet état de fait, qui nous spolie essentiellement, s’exprime aussi dans les « conseils » dont on nous matraque : puisque notre durée de vie s’allonge, il nous faut économiser dès notre plus jeune âge afin de nous assurer une retraite convenable par nos propres moyens. Mais comment allons-nous économiser si l’emploi a disparu ? Pourquoi, après avoir travaillé toute une vie, n’avons-nous droit qu’à une pension qui nous permet à peine de survivre ?
Pour échapper à ce sentiment d’impuissance et d’infantilisation induit à notre intention par la classe dirigeante, il nous faut nous réapproprier notre travail et ses moyens de production, afin que ceux-ci cessent d’être littéralement happés par la spéculation et la recherche du profit.
J’ai évoqué des obstacles hiérarchiques, économiques, structurels, d’autres liés à des préjugés de civilisation, comme celui d’attacher davantage d’importance à l’aspect matériel de l’existence qu’à la recherche de son sens ou à la reconnaissance des travailleurs dans l’entreprise. Il est un autre préjugé cependant aussi important que celui que je viens d’évoquer et non moins dévastateur car il livre « pieds et poings liés » le travailleur au bon vouloir des actionnaires et des dirigeants d’entreprises : c’est celui qui concerne la manière d’aborder le travail en lui-même, préjugé véhiculé par la « science » économique et sa conception très particulière de la comptabilité.
Son principe est le suivant, que personne jusqu’à présent n’a jugé bon de contester : le travail, au sein de l’entreprise, est considéré comme un coût et les bonus accordés aux dirigeants, les dividendes aux actionnaires comme des parts de bénéfice.
Partant de ce principe, dont on nous affirme qu’il est celui que suggère le bon sens, le travail doit être rémunéré de manière inversement proportionnelle aux largesses accordées aux dirigeants et actionnaires. Il convient donc d’abaisser le salaire jusqu’au niveau de tolérance en dessous duquel le travailleur ne pourra plus remplir sa fonction de manière efficace et productive. Cette manière de voir ne laisse aucune place à une considération d’ordre humain ou éthique : le salaire est ce qu’il faut bien « céder » pour obtenir soi-même le maximum d’argent dont on se rassure qu’il récompense un talent dont il n’existe en réalité aucune preuve tangible, ou un risque que l’on s’est en réalité très prudemment abstenu de prendre, tout l’art de la logique du profit consistant précisément à transférer le risque à d’autres ; l’affaire des Credit default swaps de 2008 en étant la parfaite illustration.
Nous pourrions analyser l’ensemble de nos rapports sociaux uniquement à partir de cette formule, tant elle reflète avec justesse nos véritables « valeurs » : atomisation, exploitation, élitisme, matérialisme, domination.
Les règles comptables telle celle qui définit le travail comme coût et les bonus et dividendes comme parts de profit – un principe qui définit à notre insu le type de société où nous vivons bien mieux que notre constitution officielle – doivent être modifiées pour que toutes les avances consenties par des parties prenantes à la fabrication d’un produit ou l’offre d’un service, avances en travail aussi bien qu’en capital ou en supervision et direction des entreprises, soient rémunérées selon une logique unique, prenant pleinement en compte qu’elles sont toutes trois indispensables au même titre pour aboutir au produit fini : il faut aussi, parallèlement, que le travailleur remplacé par une machine bénéficie de la productivité future de celle-ci, selon le principe d’une « taxe Sismondi » (j’en expliquerai le principe au prochain chapitre).
Il est impératif que la définition et la révision ensuite des règles comptables européennes deviennent partie intégrante d’un processus de décision démocratique au lieu d’être déterminées comme c’est le cas à l’heure actuelle par un organisme privé nommé IASB (International Accounting Standards Board), une filiale de l’IASCF (International Accounting Standards Committee Foundation), domicilié de manière inacceptable dans un paradis fiscal (l’État du Delaware aux États-Unis). Wikipedia nous explique : « Indépendant, il n’a de comptes à rendre à personne sinon aux fondations qui le financent et où l’on retrouve les plus grands établissements financiers et les principaux cabinets d’audit de la planète. »
Il est impératif que soit révisée la structure actuelle de l’IASB où seuls ces grandes firmes d’audit et les représentants des plus grosses transnationales déterminent – avec un pouvoir de décision de fait au prorata du montant de leur cotisation – le contenu de règles qui, pour ce qui touche à notre vie de tous les instants, définissent le véritable cadre qui y préside pour l’essentiel.
Proposition : Remettons en question la définition comptable traditionnelle mais néanmoins arbitraire des salaires comme « coûts pour l’entreprise », coûts qu’il s’agit bien entendu de réduire autant que possible, alors que les dividendes accordés aux actionnaires et les bonus – souvent extravagants – accordés à la direction sont eux autant de « parts de bénéfice », dont chacun sait qu’il faut chercher à les maximiser à tout prix. Les « avances », comme s’exprimaient les économistes d’autrefois, quelle que soit leur nature, sont bien évidemment aussi indispensables les unes que les autres à la bonne marche de l’entreprise, et les avances en travail au même titre que celles en capital ou en direction / supervision de la bonne marche des affaires.
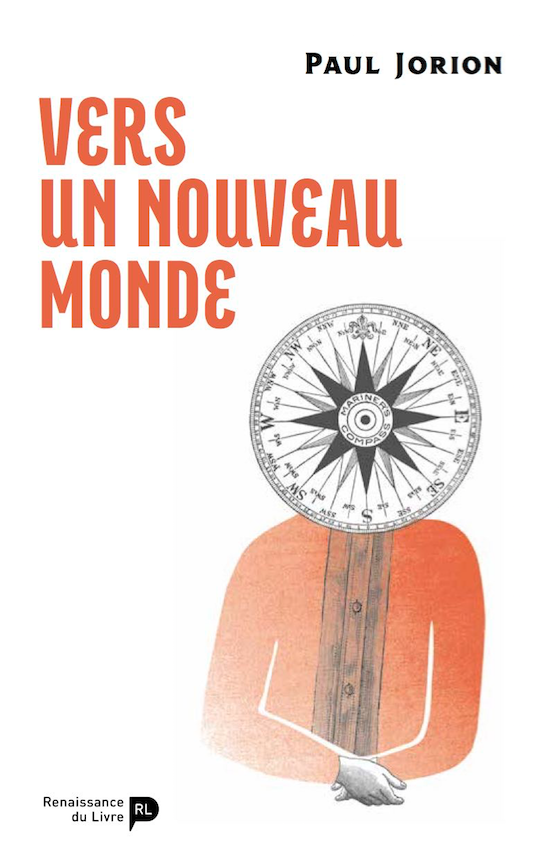
Laisser un commentaire