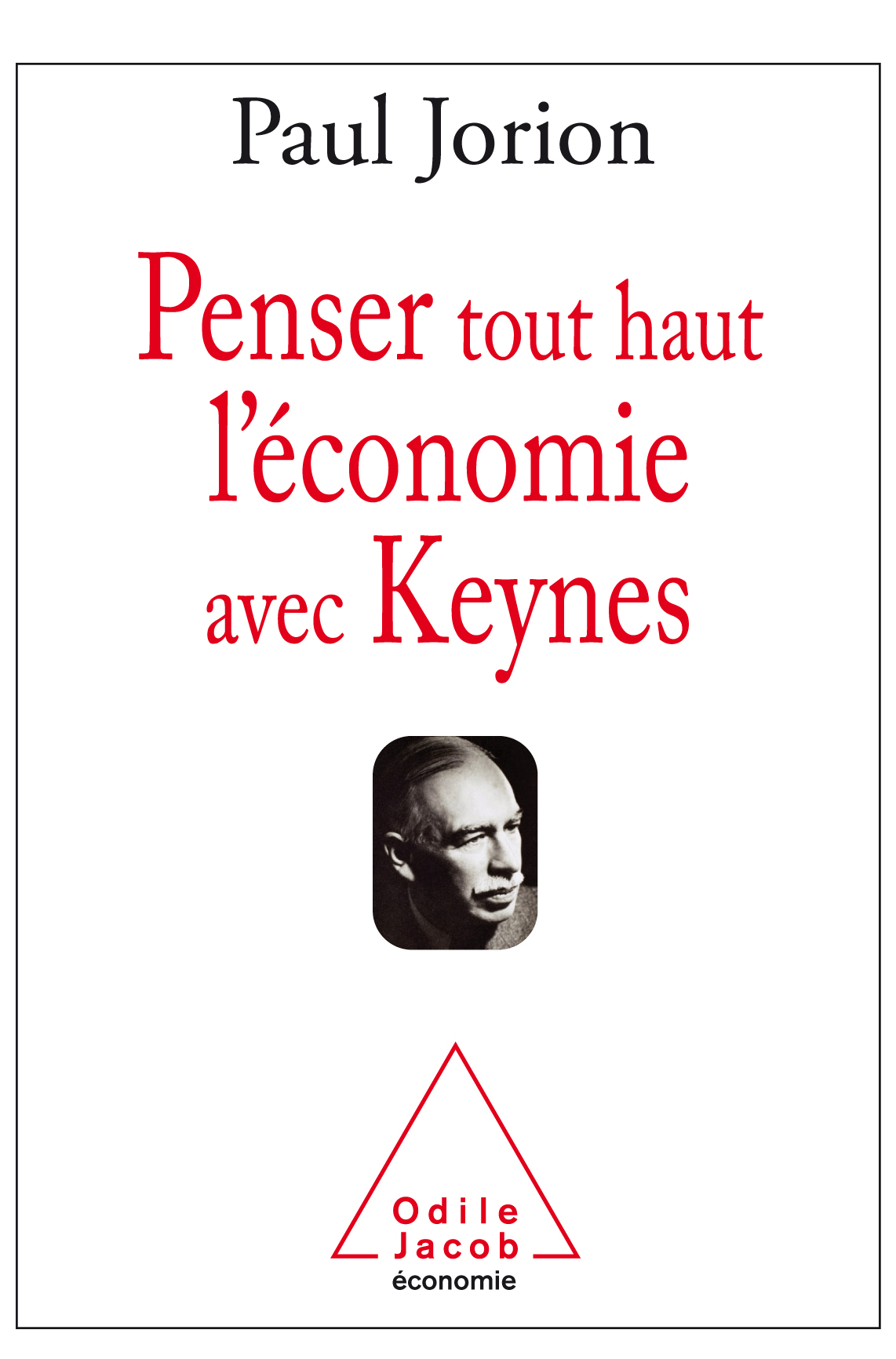 Si l’on veut remplacer la théorie économique dominante, dont Andrew Haldane, économiste en chef de la Banque d’Angleterre, vient de rappeler les faiblesses fondamentales, Keynes demeure un excellent point de départ. Je vous propose du coup en feuilleton dans les jours qui viennent, mes commentaires relatifs aux principaux textes de Keynes, tels qu’on les trouve dans Penser tout haut l’économie avec Keynes (Odile Jacob, 2015).
Si l’on veut remplacer la théorie économique dominante, dont Andrew Haldane, économiste en chef de la Banque d’Angleterre, vient de rappeler les faiblesses fondamentales, Keynes demeure un excellent point de départ. Je vous propose du coup en feuilleton dans les jours qui viennent, mes commentaires relatifs aux principaux textes de Keynes, tels qu’on les trouve dans Penser tout haut l’économie avec Keynes (Odile Jacob, 2015).
Am I a Liberal ? (1925)
[pp. 67-73]
Keynes libéral d’« extrême-gauche » antirévolutionnaire
En 1925, Keynes a quarante-deux ans. La campagne qu’il a menée pour empêcher le retour de la Grande-Bretagne à l’étalon-or vient d’échouer et il a salué sa défaite personnelle par une série de chroniques publiées au mois de juillet dans l’Evening Standard, textes rassemblés ensuite en une brochure : The Economic Consequences of Mr Churchill.
De même qu’il a cherché à montrer que la stabilité des prix est nécessairement excellente puisque la hausse des prix : l’inflation, et la baisse des prix : la déflation, sont toutes deux exécrables, il détermine que s’il est libéral, c’est parce qu’il ne peut être ni Travailliste, ni Conservateur. Ses pensées à ce sujet ont été rassemblées à l’occasion d’une allocution qu’il prononce en août à l’université d’été du parti libéral britannique intitulée : « Am I a Liberal ? », suis-je un libéral ?
Keynes ne s’est certainement pas facilité la tâche en se définissant comme appartenant au courant d’extrême-gauche de ce parti, tendance dont il est d’ailleurs le seul représentant dont on ait gardé le souvenir. Il affirme non sans un certain panache dans une allocution intitulée « Liberalism and Labour », le libéralisme et le travaillisme, prononcée en février 1926 : « La République de mon imaginaire se situe à l’extrême-gauche de l’espace céleste » (Keynes [1926] 1931 : 309).
Le militantisme de Keynes, proclamé haut et fort en faveur du courant qu’il imagine représenter, doit être situé dans le contexte de l’effondrement du parti libéral britannique aux élections de 1924, où il perdit 118 de ses 158 sièges. Keynes explique dans « Liberalism and Labour » que « Le parti Libéral se partage entre ceux qui, seraient-ils forcés de faire un choix, voteraient Conservateur, et ceux qui, dans les mêmes circonstances, voteraient Travailliste », à la suite de quoi il enjoint sans ambages ceux qui voteraient Conservateur de quitter le parti Libéral (ibid. 310), pour laisser libre jeu, semble-t-il, aux travaillistes dissidents de son espèce !
Keynes n’est pas un révolutionnaire : la représentation qu’il se fait d’une société viable est, comme je viens de le rappeler, une société, sinon du consensus, du moins du dissensus minimal : où l’on est parvenu à minimiser le volume du ressentiment global. Sa méfiance envers les révolutions s’alimente des conclusions auxquelles il aboutira dans les recherches qui débouchèrent en 1921 sur son Treatise on Probability, à savoir que la tâche de prévoir l’avenir est quasiment irréalisable. Cette opinion est la sienne depuis fort longtemps puisqu’on la trouve en fait déjà exprimée dans une dissertation de plus de 100 pages qu’il rédige en 1904 à l’âge de 21 ans alors qu’il étudie à Cambridge, à propos de l’homme politique et philosophe Edmund Burke (1729 – 1797), intitulée « The Political Doctrines of Edmund Burke » : « Notre capacité à prédire est si faible qu’il est rarement avisé de sacrifier un mal actuel pour un hypothétique avantage futur » (Skidelsky 1983 : 155), opinion dans la ligne d’une autre qu’il avait défendue deux ans auparavant dans une allocution alors qu’il était encore lycéen à Eton, que les abus de l’Ancien régime auraient pu être éliminés « par des moyens moins violents et passablement plus constitutionnels » (ibid. 102). Les périodes de transition peuvent être catastrophiques, dit-il encore, et il ne faut s’engager dans de tels bouleversements prévisibles qui si l’on est certain que le bien qui en résultera les justifiait pleinement. Il écrivait en ce sens, toujours dans sa dissertation de 1904 sur Burke : « il ne suffit pas que l’état de fait que nous cherchons à promouvoir soit meilleur que celui qui le précède, il faut encore qu’il soit à ce point préférable qu’il compense aussi les tragédies qui accompagnent la transition » (ibid. 156).
Keynes justifiera par une véritable argumentation son désaccord de principe avec la voie révolutionnaire dans le compte-rendu d’un livre que Trotski vient alors de consacrer à la Grande-Bretagne (Where Is Britain Going ? 1925).
Il commence par y souligner qu’il n’existe pas en Grande-Bretagne de projet révolutionnaire bénéficiant de l’assentiment d’une proportion importante de la population :
« [Trotski] suppose que les problèmes moraux et intellectuels de la transformation de la société ont déjà été résolus – qu’un plan existe, et qu’il ne reste plus qu’à l’appliquer. Il suppose que la société se divise en deux parties – le prolétariat, adepte de ce plan, et les autres qui s’y opposent pour des raisons purement égoïstes. Il ne comprend pas qu’aucun plan ne pourra gagner avant d’avoir convaincu un nombre considérable de personnes, et que, s’il existait déjà un tel plan, une multitude ne manquerait pas de s’y rallier » (Keynes [1926] 1933 : 66).
Et Keynes de conclure : « La prochaine étape se fait avec la tête, et les poings doivent attendre » (ibid. 67).
Certains n’hésiteraient cependant pas à dire que l’argumentation de Trotski, telle que Keynes l’a rapportée dans la première partie de son compte-rendu, n’est pas moins convaincante que sa propre démonstration, voire même répond par avance aux objections qu’il pourrait faire.
Dans sa recension, Keynes commence en effet par rapporter fidèlement les vues de Trotski. Selon celui-ci, l’hypothèse que le parti Travailliste accéderait au pouvoir par la voie électorale et par un vote majoritaire, et « parviendrait à accomplir cette tâche avec tant de circonspection, avec tant de tact, avec tant d’intelligence, que la bourgeoisie ne ressentirait aucun besoin de manifester son opposition active, est une farce » (ibid. 65). Keynes poursuit :
« Trotski affirme que les classes possédantes respecteront le résultat des élections aussi longtemps qu’elles contrôlent la machine parlementaire, mais que si elles en sont délogées, il est alors absurde de supposer qu’elles hésiteront un instant à recourir à la force. Supposons, dit-il, qu’une majorité parlementaire travailliste décide, de la manière la plus légale du monde, de confisquer la terre sans compensation, de taxer lourdement le capital, d’abolir la Couronne et la Chambre des Lords, ‘il ne fait aucun doute que les classes possédantes ne se soumettront pas sans lutter, d’autant que la police, l’appareil judiciaire et l’armée sont entièrement entre leurs mains’. Elles contrôlent de surcroît les banques et l’entièreté du système de crédit social ainsi que le secteur des transports et celui du commerce, si bien que l’alimentation quotidienne de Londres, y compris celle du gouvernement travailliste lui-même, dépend du bon vouloir des grands combinats capitalistes. Il va de soi, affirme Trotski, que de formidables moyens de pression ‘seront mis en branle avec une violence effrénée pour bloquer l’activité du gouvernement travailliste, pour paralyser ses moyens, pour le terroriser, pour tenter de provoquer des défections dans sa majorité parlementaire et, finalement, pour causer une panique financière, des difficultés d’approvisionnement, et des fermetures d’usines’ » (ibid. 65-66).
Dans tout ce passage, et avant qu’il n’exprime pour conclure ses propres objections à l’argumentation de Trotski – objections qui apparaissent bien timides par contraste, Keynes a pris un soin à ce point méticuleux de rapporter les vues du Russe qu’il est difficile d’imaginer qu’une telle considération ne trahisse pas une certaine sympathie envers celles-ci.
Le statut de ce compte-rendu d’un livre de Trotski est, on l’aura compris, on ne peut plus ambigu. Impossible de ne pas rapprocher cette publicité faite aux vues du révolutionnaire russe des propos tenus par Keynes huit ans auparavant quand il écrivait à sa mère que la révolution russe « est le seul résultat de la guerre jusqu’ici qui en vaille la peine » (Skidelsky 1983 : 337).
Keynes socialiste anti-travailliste
Aussi, après avoir expliqué de manière quelque peu paradoxale dans « Am I a Liberal ? » pourquoi il est un libéral, mais d’« extrême-gauche », Keynes entreprend de répondre dans cette même allocution à la question que tout contemporain se pose alors légitimement : « Étant aussi socialiste que vous affirmez l’être, pourquoi n’êtes-vous pas plutôt membre du parti Travailliste ? »
Keynes s’affirme en effet socialiste avec une belle constance et une belle vigueur, au point d’irriter passablement ceux qui s’estiment mieux en droit que lui de se prévaloir du titre. Son confrère économiste Hugh Dalton notera ainsi en 1930 dans son journal : « Lors d’une réunion, Keynes offensa le Premier Ministre [le Travailliste Ramsay MacDonald] en se décrivant lui-même comme « le seul socialiste présent dans la salle » » (Skidelsky 1992 : 363).
Le reproche que Keynes adresse au parti Travailliste est qu’on n’y rencontre guère la variété de socialisme de qualité supérieure dont il serait lui-même le représentant.
La description la plus complète du socialisme tel que Keynes le conçoit se trouve dans deux textes : dans un exposé qu’il fit à plusieurs reprises en 1928 et qu’il publiera en 1930 sous le titre « Economic Possibilities for Our Grandchildren », les alternatives économiques de nos petits-enfants, et dans les « Notes finales sur la philosophie sociale à laquelle la théorie générale peut conduire » qui constituent le chapitre final de sa Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie publiée en 1936 ; j’en dirai davantage lorsque mon récit aura atteint ces années là.
Skidelsky écrit : « Keynes admirait trois choses dans le socialisme : sa passion pour la justice sociale […], l’idéal fabien du service public, et son utopisme, fondé sur l’élimination de « l’argent comme moteur » et de l’« adoration de l’argent » » (Skidelsky 1992 : 234).
Née en 1884, la Fabian Society est un mouvement socialiste britannique d’inspiration quaker dont les personnalités les plus marquantes furent Beatrice et Sidney Webb ; parmi ses membres éminents : l’homme de théâtre George Bernard Shaw, le romancier de science-fiction H. G. Wells, Virginia Woolf.
Skidelsky a retrouvé dans les papiers de Keynes, une note inédite rédigée le 23 décembre 1925, c’est-à-dire à l’époque dont il est question ici. On y lit :
« Nous devrions plus souvent être dans un état d’esprit où, pour ainsi dire, le coût monétaire est entièrement mis entre parenthèses.
L’abolition de l’héritage aiderait de ce point de vue en permettant d’évacuer le problème que posent les comparaisons concrètes. Il faut que nous restreignions, plutôt qu’augmentions, le domaine où peuvent apparaître des comparaisons monétaires.
Les fluctuations historiques [sont] dues au fait que le système social qui est efficient sur le plan économique ne l’est pas sur le plan moral. L’économie babylonienne permit à des États d’atteindre une grande richesse et de connaître un grand confort et provoqua ensuite leur effondrement pour des raisons d’ordre moral. Le problème fondamental […] c’est découvrir un système social qui serait efficient à la fois sur le plan économique et sur le plan moral » (Skidelsky 1992 : 241).
Comment faire advenir le socialisme ? Le processus sera long et fondé sur l’essai et l’erreur : « le véritable socialisme du futur, écrit-il, émergera […] d’une variété infinie d’expérimentations visant à découvrir les relations adéquates entre les sphères de l’individuel et du social » (ibid. 185).
Le parti Travailliste a-t-il un rôle privilégié à jouer dans un tel avènement du socialisme ? Non, répondait Keynes en 1923, car le parti nécessaire à la tâche doit être « plus audacieux, plus libre, compter des esprits plus désintéressés que n’en a le parti Travailliste, qui devrait abandonner ses dogmes d’un autre âge » (ibid. 137). À ces reproches, il en ajoute d’autres, dans cette allocution même prononcée en août 1925 ainsi que dans « Liberalism and Labour », prononcée en février de l’année suivante.
Premier reproche : le parti Travailliste n’est pas universaliste puisqu’il s’affirme comme le parti de la seule classe ouvrière, qui n’est pas la classe où lui Keynes est né et au sein de laquelle il a été élevé. Non seulement cela, mais ce parti est hostile à la classe dont Keynes est issu. Il écrit :
« Devrais-je rejoindre le parti Travailliste ? […] La proposition est à première vue plus attirante [que d’être un Conservateur] mais à y regarder de plus près, il existe de sérieux obstacles. Pour commencer, c’est un parti de classe, et la classe en question n’est pas la mienne. Si j’étais obligé de poursuivre des intérêts spécifiques, je poursuivrais les miens. […] Je peux être influencé par ce qui me semble être la justice et le bon sens, mais la guerre des classes me trouvera aux côtés de la bourgeoisie éduquée » (Keynes [1925a] 1931 : 297).
Cette absence d’universalisme du parti Travailliste n’est malheureusement que le symptôme d’un mal plus profond. Ainsi, dans un passage qui suit immédiatement celui que je viens de citer dans « Am I a Liberal ? » mais qui, du vivant de Keynes, ne sera pas reproduit dans le volume des Å’uvres complètes, en raison sans aucun doute de sa brutalité, il déclare qu’au sein de ce parti : « trop sera toujours décidé par ceux qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent » (ibid. 297). Et dans un autre passage tout aussi mordant, il reproche aux dirigeants travaillistes de ne pas se contenter d’aimer le genre humain, mais de le détester aussi :
« Il est cependant nécessaire pour un dirigeant travailliste populaire d’être, ou du moins d’apparaître, un peu comme un sauvage. Il ne lui suffit pas d’aimer ses semblables, il lui faut aussi les haïr » (ibid. 300).
Et Keynes de conclure qu’il est de loin préférable d’être le seul socialiste de qualité au sein du parti Libéral plutôt que d’être entouré au parti Travailliste de socialistes dont le socialisme laisse trop à désirer.
Mais il ne s’agit là que de déclarations tonitruantes au niveau des grands principes : durant les années 1929 à 1931, les efforts de Keynes sur le plan politique seront consacrés uniquement à seconder Ramsay MacDonald alors que celui-ci se trouve pour la deuxième fois à la tête d’un gouvernement travailliste, même s’il lui infligera le camouflet dont Dalton a consigné le souvenir : de se prétendre « seul socialiste présent » lots d’une réunion à laquelle MacDonald prend part. Il aura alors cessé entièrement de s’impliquer dans les affaires du parti Libéral (Skidelsky 1992 : 344).
Keynes socialiste ? Certainement, mais au titre seulement d’électron libre.
A ce prix là, il n’est pas prêt de tuer le capitalisme dans l’oeuf !