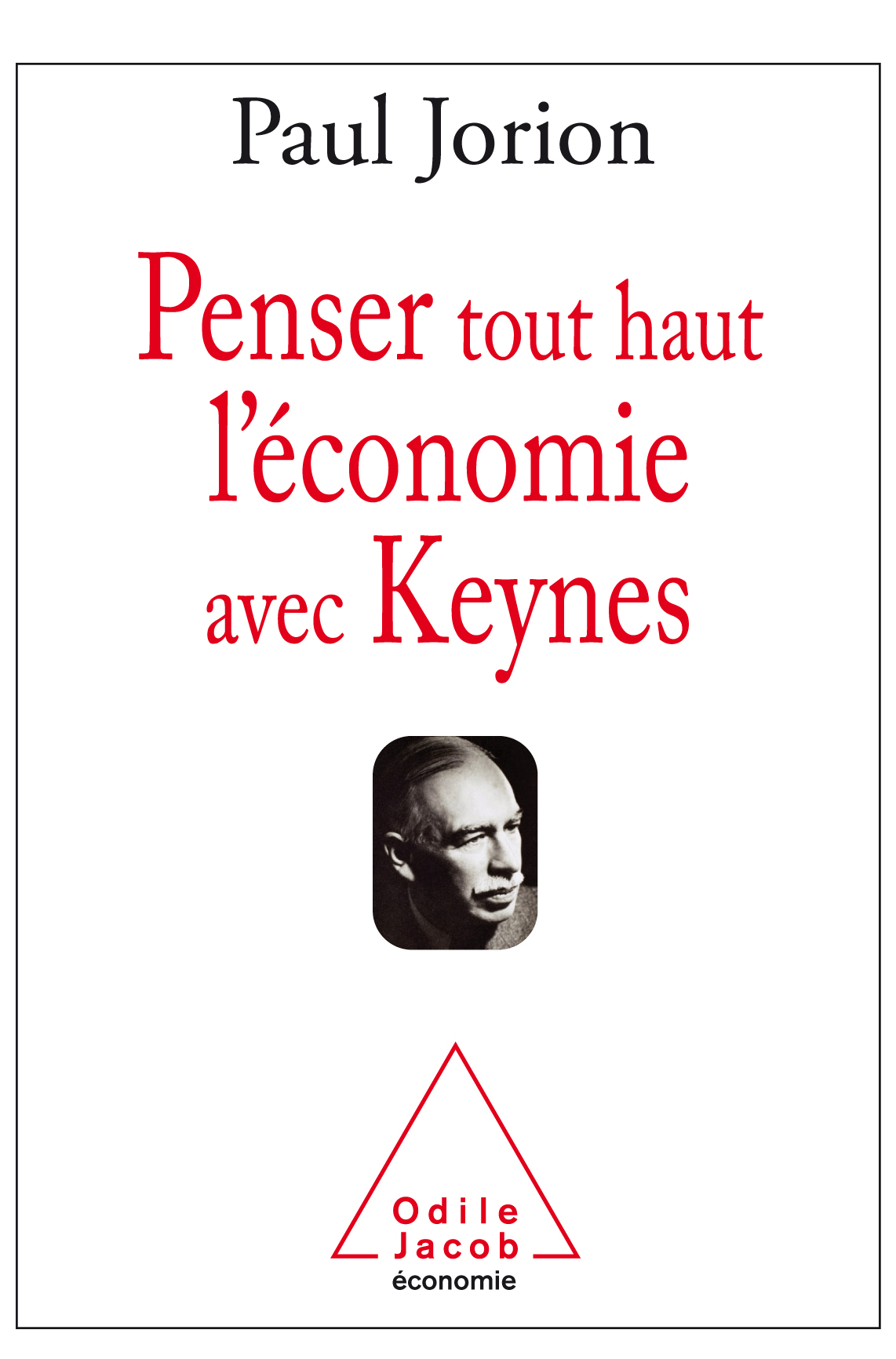 Si l’on veut remplacer la théorie économique dominante, dont Andrew Haldane, économiste en chef de la Banque d’Angleterre, vient de rappeler les faiblesses fondamentales, Keynes demeure un excellent point de départ. Je vous propose du coup en feuilleton dans les jours qui viennent, mes commentaires relatifs aux principaux textes de Keynes, tels qu’on les trouve dans Penser tout haut l’économie avec Keynes (Odile Jacob, 2015).
Si l’on veut remplacer la théorie économique dominante, dont Andrew Haldane, économiste en chef de la Banque d’Angleterre, vient de rappeler les faiblesses fondamentales, Keynes demeure un excellent point de départ. Je vous propose du coup en feuilleton dans les jours qui viennent, mes commentaires relatifs aux principaux textes de Keynes, tels qu’on les trouve dans Penser tout haut l’économie avec Keynes (Odile Jacob, 2015).
A Short View of Russia (1925)
[pp. 75-80]
Le communisme : un régime exécrable
Un peu plus de sept ans s’étaient écoulés depuis la Révolution d’octobre quand Keynes fut invité en Union soviétique au mois de septembre 1925 en tant que représentant officiel de l’université de Cambridge. Le tapis rouge fut déroulé devant lui durant les deux semaines que durera son séjour. Le mois précédent, il avait épousé celle qui était sa compagne depuis plusieurs années : la ballerine russe Lydia Lopokova, qui l’accompagna durant ce voyage. Il fut également reçu dans la famille de celle-ci et l’occasion lui fut ainsi donnée de voir la société soviétique sous différents éclairages : celui des dirigeants qui étaient ses hôtes mais aussi celui des gens ordinaires : le père de Lydia était ouvreur de cinéma.
Keynes fit part de ses impressions de l’Union soviétique dans trois articles dont la teneur fut rassemblée plus tard dans « A Short View of Russia », un cahier qui sera publié par les Hogarth Press de Leonard et Virginia Woolf, surtout connues aujourd’hui pour leur première édition des œuvres complètes de Freud en anglais, fait qui n’est pas purement anecdotique si l’on pense qu’à cette époque Bloomsbury se convertissait en masse au marxisme et à l’admiration de la Russie sous son nouveau régime.
« A Short View of Russia » est un étonnant texte d’une vingtaine de pages puisqu’on y trouve d’abord une charge féroce contre le communisme que Keynes a pu voir à l’œuvre et ensuite, en contradiction apparente avec le verdict brutalement négatif que l’on vient de lire, une interrogation : est-il exclu que sous sa forme grotesque, le communisme pose cependant les jalons de la société bienheureuse que connaîtront un jour nos lointains descendants ? Autrement dit, le communisme n’est-il pas l’un des exemples de cette « variété infinie d’expérimentations visant à découvrir les relations adéquates entre les sphères de l’individuel et du social » dont Keynes affirmait […] qu’émergerait « le véritable socialisme du futur » ?
En juillet 1937, Keynes écrirait au journaliste Kingsley Martin : « Il n’y a en réalité que deux [idéologies] : les états totalitaires… et les états libéraux. Ces derniers mettent la paix et la liberté individuelle au premier plan, les autres ne les mettent nulle part » (Keynes [1937] 2013 : 73). C’est en se fondant sur une telle prémisse qu’il bâtit son évaluation globale de l’Union soviétique. Il écrit dans « A Short View of Russia » :
« Je ne suis pas prêt à souscrire à une foi qui ne se soucie aucunement de combien elle annihile la liberté et le sentiment de sécurité dans la vie quotidienne, qui recourt délibérément aux armes de la persécution, de la destruction et de la lutte internationale. Comment pourrais-je admirer une politique dont l’une des expressions caractéristiques est qu’elle dépense des millions pour appointer des espions au sein de chaque famille et de chaque groupe à l’intérieur de ses frontières, et pour fomenter le désordre à l’étranger ? » (Keynes [1925b] 1931 : 258).
Huit ans plus tard, en 1933, Keynes dira de Staline et de l’Union soviétique, qu’avec lui, « les circonvolutions souples du cerveau s’y sont figées en bois » (Keynes [1933] 1982 : 246).
Vient alors une analyse de la situation économique : si l’Union soviétique ne sombre pas corps et biens, c’est que les ressources de son agriculture sont réquisitionnées pour assurer une perfusion permanente de son industrie qui, quant à elle, opère à perte en raison d’une gestion inepte. Keynes écrit :
« … le gouvernement communiste peut pouponner (toutes proportions gardées) le travailleur prolétarien, objet spécial de son attention bien entendu, en exploitant le paysan ; le paysan de son côté, en dépit de son exploitation, n’aspire à aucun changement de gouvernement, parce qu’il a reçu sa terre […] On lui achète son blé bien au-dessous du prix mondial, et on lui vend du textile et des biens manufacturés à des prix de loin supérieurs aux prix mondiaux, la différence entre les deux vient alimenter un fonds qui permet de financer les importants surcoûts et l’inefficacité globale du secteur manufacturier et de la distribution » (ibid. 263-264).
Comment expliquer une telle inefficacité ? Par la combinaison de deux éléments : le communisme en tant que tentative généreuse mais trop fruste d’inverser les priorités entre les préoccupations d’ordre économique et éthique, et le marxisme en tant que théorie économique erronée.
Le communisme : une « grande religion » en germe
Keynes voyait […] dans l’ancienne Babylone le premier exemple de « système social […] efficient sur le plan économique [et] inefficient sur le plan moral » dont le capitalisme contemporain est aujourd’hui la plus belle illustration, et appelait de ses vœux « un système social qui serait efficient à la fois sur le plan économique et sur le plan moral ». Or, si c’est bien ce dernier objectif que le communisme soviétique cherche à atteindre, il échoue dans cette tâche et ne parvient à produire dans la forme que prend l’échec pour lui qu’une version inversée du capitalisme : un système qui aspire à l’efficience sur le plan moral mais n’y parvient pas en raison des retombées de son inefficacité rédhibitoire sur le plan économique.
Keynes explique cela :
« Le léninisme est la combinaison de deux choses que les Européens ont maintenues historiquement dans deux compartiments séparés de l’âme : la religion et les affaires. Nous sommes choqués parce qu’ici la religion est neuve, et méprisants parce que les affaires, étant subordonnées à la religion plutôt que l’inverse, manquent grandement d’efficacité » (ibid. 265).
L’usage du mot « religion » dans le contexte d’une Union soviétique qui s’affirme radicalement athée peut paraître incongru mais Keynes avait tenu d’emblée à prévenir son lecteur : « j’utiliserai assez souvent par la suite l’épithète religieux quand il est question des disciples de Lénine » (ibid. 253). Comme on le verra par la suite, le mot n’est pas péjoratif sous sa plume : il emploie le mot « religion » dans son sens d’institution qui relie entre eux les membres d’une société, et là où l’on évoquerait aujourd’hui plutôt une « éthique » qu’une « religion ».
Le capitalisme moderne, par contraste, est selon lui « absolument irréligieux, privé de cohésion interne, pratiquement privé d’esprit collectif, et souvent, même si ce n’est pas dans tous les cas, un simple assemblage de possédants et de carriéristes. Pour pouvoir survivre, un tel système doit voir ses efforts couronnés de succès, non pas seulement modérément, mais immensément. […] En ce moment, c’est seulement modérément » (ibid. 267).
En 1934, John Maynard Keynes disait à Virginia Woolf qui nous l’a rapporté : « Notre génération […] doit beaucoup à la religion de nos aïeux […] Et les jeunes […] qui sont élevés sans elle, ne retireront jamais autant de la vie. Ils sont prosaïques : comme des chiens avec leurs impulsions. Nous avons bénéficié du meilleur de deux mondes. Nous avons détruit le christianisme mais nous avons bénéficié de ce qu’il apportait » (Skidelsky 1992 : xx).
Skidelsky fait observer qu’« en Russie soviétique, tout ce que les grandes religions avaient désigné comme criminel sur un plan spirituel, avait acquis ce statut criminel au plan légal et d’un point de vue social » (ibid. 235).
Quant à la théorie économique marxiste sur laquelle la « religion » léniniste repose, le verdict de Keynes est impitoyable :
« Comment pourrai-je accepter une doctrine qui s’est choisie pour bible, par-dessus et par-delà toute critique envisageable, un manuel d’économie dépassé, dont je sais qu’il n’est pas seulement faux sur le plan scientifique mais aussi dénué d’intérêt ou d’application possible dans le monde moderne ? » (Keynes [1925b] 1931 : 258).
Il faut savoir que Keynes reproche aux travaux économiques de Marx de ne pas être davantage qu’un commentaire peu imaginatif de l’œuvre de David Ricardo (1772 – 1823) et d’avoir ajouté sur cette base défectueuse, de nouvelles erreurs. En 1935, à l’époque où il rédige sa Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, il écrit dans une lettre adressée à l’homme de théâtre George Bernard Shaw : « Je suis en train de rédiger un livre de théorie économique dont j’imagine qu’il révolutionnera largement – pas immédiatement je pense, mais dans les dix années à venir – la manière dont le monde se représente les problèmes économiques […] Il y aura un changement radical et, en particulier, les fondations ricardiennes du marxisme auront été renversées » (Skidelsky 1992 : 520-521).
David Champernowne, l’un des étudiants de Keynes, rapportera : « Il avait lu Marx, disait-il, comme s’il s’agissait d’un roman policier, espérant trouver l’indice d’une idée sans jamais y parvenir » (ibid. 523). Mais la relation de Keynes à Marx est bien plus complexe que ce que de tels propos méprisants laissent entendre. Il y a surtout à mon sens comme explication à l’irritation que Keynes manifestera à la moindre mention du nom de Marx, sa frustration devant l’occasion lamentablement manquée que constitue l’Union soviétique. Le sentiment de Keynes que si celle-ci avait pu fonder sa réflexion sur une œuvre économique moins erronée, notre progrès dans la réalisation du socialisme par la seule méthode qu’il jugeait possible, à savoir, comme nous l’avons vu, celle de l’essai et l’erreur, aurait pu brûler les étapes, au lieu de se voir au contraire considérablement retarder par les errements économiques et liberticides du communisme soviétique.
C’est ce qui explique sans doute pourquoi le portrait absolument dévastateur de l’Union soviétique que l’on trouve dans « A Short View of Russia » se termine contre toute attente, car apparemment entièrement à rebrousse-poil du point de vue qui a été défendu jusque-là par son auteur, avec la note d’optimisme attendri que voici :
« Et pourtant, l’exultation, lorsqu’elle est ressentie, est considérable. Ici – c’est ce que l’on ressent à certains moments – en dépit de la pauvreté, de la stupidité et de l’oppression, se trouve le laboratoire de la vie […] C’est pourquoi le communisme russe représente peut-être le premier tohu-bohu confus d’une grande religion » (Keynes [1925b] 1931 : 269-270).
Quatorze ans plus tard, à la veille de la Seconde guerre mondiale, dans une conversation avec le même Kingsley Martin, intitulée : « Democracy and Efficiency », il dira dans le même esprit :
« Il n’est personne aujourd’hui en politique qui vaille six sous en-dehors des libéraux, si ce n’est la génération d’après-guerre des intellectuels communistes de moins de trente-cinq ans. Eux aussi, je les aime et je les respecte. Il est bien possible que dans leurs sentiments et leurs instincts ils soient ce qu’il y a de plus proche aujourd’hui du nerveux gentleman anglais non-conformiste représentatif qui partit pour les croisades, lança la Réforme, combattit lors de la Guerre civile anglaise, conquit nos libertés civiles et religieuses et humanisa le sort des classes laborieuses au siècle dernier » (Keynes [1939] 1982 : 494-495).
Synthèse par GPT4 de l’apport d’une agence marketing politique L’Agence Marketing Politique se spécialise dans l’accompagnement des candidats, consultants politiques…