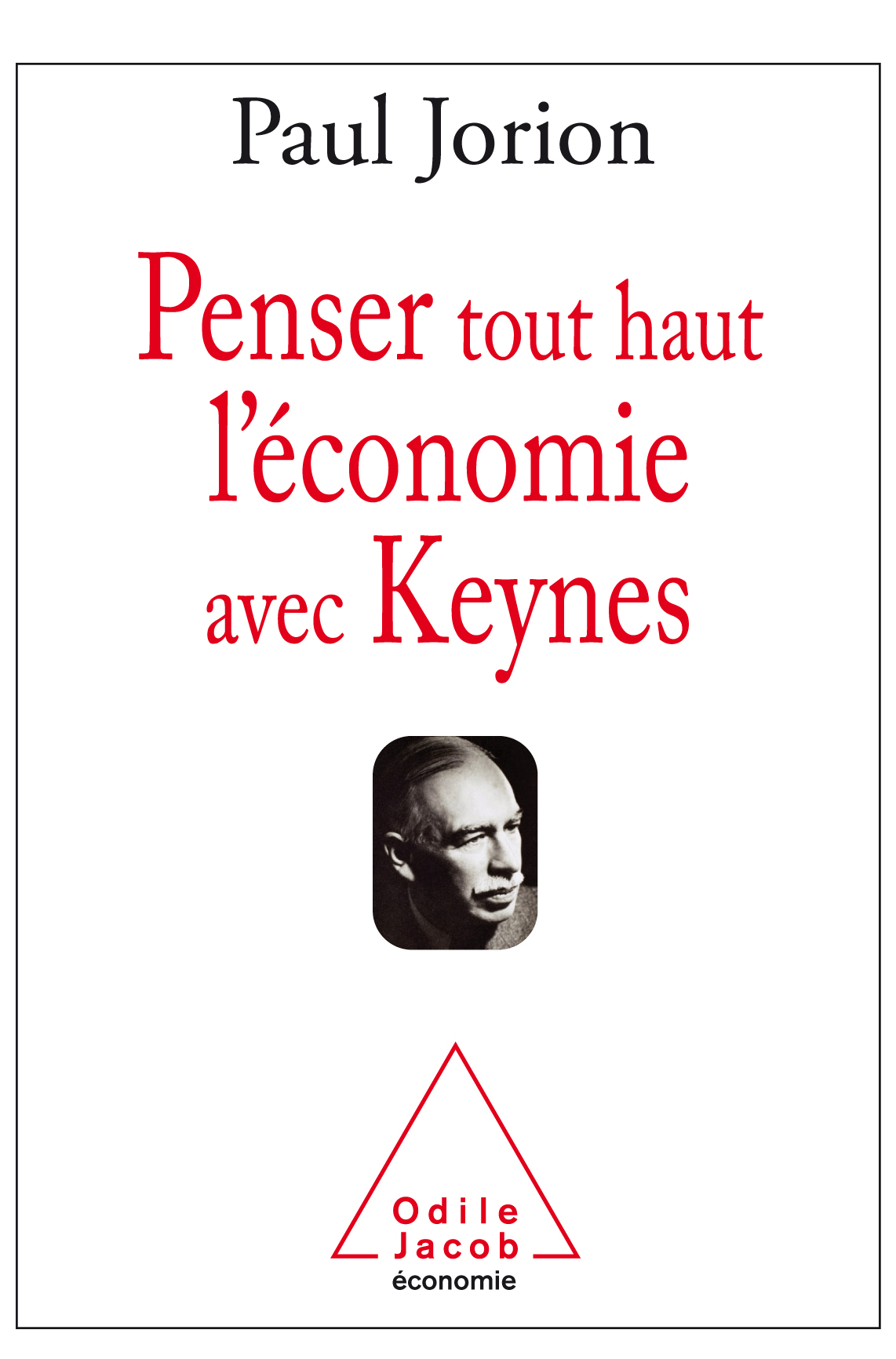 Comme j’ai tenu à l’expliquer dans Penser tout haut l’économie avec Keynes (Odile Jacob, 2015), la tache aveugle du système économique de John Maynard Keynes (1883 – 1946) est le rapport de force dans l’économie et la finance. J’ai tenté dans ce livre de compléter en proposant cette pièce manquante. Quoi qu’il en soit, si l’on veut remplacer la théorie économique dominante, dont Andrew Haldane, économiste en chef de la Banque d’Angleterre, vient de rappeler les faiblesses fondamentales, Keynes demeure un excellent point de départ. Je vous propose du coup en feuilleton dans les jours qui viennent, mes commentaires relatifs aux principaux textes de Keynes, tels qu’on les trouve dans Penser tout haut l’économie avec Keynes.
Comme j’ai tenu à l’expliquer dans Penser tout haut l’économie avec Keynes (Odile Jacob, 2015), la tache aveugle du système économique de John Maynard Keynes (1883 – 1946) est le rapport de force dans l’économie et la finance. J’ai tenté dans ce livre de compléter en proposant cette pièce manquante. Quoi qu’il en soit, si l’on veut remplacer la théorie économique dominante, dont Andrew Haldane, économiste en chef de la Banque d’Angleterre, vient de rappeler les faiblesses fondamentales, Keynes demeure un excellent point de départ. Je vous propose du coup en feuilleton dans les jours qui viennent, mes commentaires relatifs aux principaux textes de Keynes, tels qu’on les trouve dans Penser tout haut l’économie avec Keynes.
The End of laissez-faire (1926)
[pp. 81-92]
« The End of laissez-faire » est un pamphlet incisif que John Maynard Keynes publia en 1926 aux Hogarth Press de Leonard et Virginia Woolf, comme il l’avait déjà fait un an auparavant avec « A Short View of Russia ». Il y poursuit deux objectifs, le premier de manière explicite, le second de manière implicite. Le premier est celui qu’annonce le titre de l’essai et qui fait l’objet d’une authentique démonstration : signer l’arrêt de mort du laisser-faire en matière de politique économique en faisant l’historique du concept, en soulignant les vices des présupposés d’une telle politique et en en définissant une autre de remplacement à mettre en œuvre une fois la preuve faite de la nécessité du rejet du laisser-faire. Le second objectif est une disqualification de l’utilitarisme de Jeremy Bentham (1748 – 1832) et le moyen utilisé ici est la satire, mettant en scène de manière un peu inattendue une pseudo-théorie darwinienne de l’évolution des girafes. La poursuite de ces deux objectifs s’entremêle cependant dans l’exposé de manière inextricable ; j’essaierai d’y apporter un peu de clarté.
La doctrine du laisser-faire résulte d’un compromis entre courants de la pensée politique
Quelles sont les sources de la doctrine du laisser-faire au sein de notre culture ? En fait, affirme Keynes, qui en retrace alors la généalogie, il s’agit d’un compromis sur lequel sont tombées d’accord deux interprétations de l’histoire humaine a priori inconciliables, c’est le modus vivendi découvert comme une option viable entre la vision héritée d’Aristote qui voit l’homme comme un zoon politikon, comme une espèce sociale par nature, et celle qui découle du contrat social que développèrent Hobbes, Locke, puis Rousseau, qui voit les hommes, lassés de l’insécurité propre à l’état sauvage dans lequel ils vivent isolés, décidant d’abandonner par un pacte certaines de leurs libertés pour que la sécurité soit assurée dans le cadre d’une organisation politique telle que l’État. Ce contrat social ayant été conclu par l’accord de tous.
Les deux courants s’accorderont sur le fait que l’individu doit pouvoir se protéger contre les impositions éventuellement arbitraires du cadre global au sein duquel il vit, que celui-ci soit un donné d’ordre naturel ou résulte du pacte par lequel a été conclu le contrat social. Keynes écrit que
« Le principe de la survie du plus apte peut être lu comme une vaste généralisation de la théorie économique de Ricardo. Les interférences à connotation sociale devinrent, à la lumière de cette synthèse grandiose, non seulement inopportunes, mais aussi impies, semblant calculées pour retarder la progression du puissant processus par lequel nous nous étions, telle Aphrodite, élevés de l’écume primordiale de l’océan. C’est pourquoi l’origine de cette unité particulière de la philosophe politique d’usage courant du XIXe siècle me semble être le succès avec lequel elle parvint à harmoniser des écoles de pensée en lutte et à unifier tout ce qu’il y avait de bon en elles en vue d’un objectif commun » (Keynes [1926] 1931 : 276).
Dans cette vaste synthèse, les philosophes politiques de tout bord n’eurent aucun mal à se reconnaître :
« Le principe du laisser-faire était parvenu à harmoniser l’individualisme et le socialisme, et à identifier l’égoïsme de Hume et le plus grand bien du plus grand nombre » (ibid. 275).
La question centrale du libéralisme, qui émerge dans le sillage de l’individualisme militant naissant, sera celle-ci : où se situe le point d’équilibre entre l’exercice de la liberté individuelle et le fonctionnement sans entraves excessives du cadre collectif qu’est l’État dont la fonction est d’assurer le bien commun ?
C’est selon Keynes, Edmund Burke (1729 – 1797), à l’œuvre duquel il avait consacré, comme je l’ai déjà mentionné, un long mémoire, qui avait le mieux défini le problème de l’équilibre optimal entre l’individu et l’État :
« … ce que Burke avait désigné comme ‘l’un des problèmes législatifs les plus beaux, à savoir, de déterminer ce que l’État devrait prendre à sa charge afin de gouverner selon la sagesse publique, et ce qu’il devrait laisser, en interférant aussi peu que possible, à l’exercice individuel’ » (ibid. 288).
En fait, souligne Keynes, l’accord sur une représentation unifiée parvint si bien à se faire que l’ensemble des options de la pensée politique apparemment antagonistes du XIXe siècle finirent par définir la question quasiment dans les mêmes termes, se transformant en de simples variantes du même thème. Au début, dit Keynes, il y avait l’utilitarisme de Jeremy Bentham :
« Le socialisme d’État au XIXe siècle est né de Bentham, de la libre concurrence, etc. et constitue par certains aspects une version plus claire, et par d’autres aspects, plus confuse, de la même philosophie exactement qui sous-tend l’individualisme du XIXe siècle. Tous deux mirent également massivement l’accent sur la liberté, l’un de manière négative pour éviter de limiter les libertés existantes, l’autre de manière positive pour détruire des monopoles naturels ou acquis. Ils constituent des réactions différentes au sein de la même atmosphère intellectuelle » (ibid. 291).
Cette vision unifiée n’aurait pu acquérir cependant l’hégémonie qui allait devenir la sienne si elle n’avait satisfait les desiderata des milieux d’affaire :
« … en dépit de leurs racines plongeant dans les philosophies politique et morale de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècles, l’individualisme et le laisser-faire n’auraient pu sur le long terme confirmer leur emprise sur la conduite des affaires publiques, s’ils n’avaient été conformes aux besoins et aux souhaits du milieu d’affaire de l’époque » (ibid. 286).
Quelques pages plus tôt, Keynes avait commencé par caractériser de manière caustique la politique du laisser-faire comme une version délirante du darwinisme. Il écrivait que pour « les darwiniens […] c’est la libre concurrence qui a bâti l’homme. L’œil humain a cessé d’être la manifestation d’un dessein ayant miraculeusement conçu toute chose du mieux possible ; il s’agit de la réussite suprême du hasard opérant dans un contexte de libre concurrence et de laisser-faire » (ibid. 276).
Keynes entreprend alors d’expliquer selon le même angle l’évolution des girafes dans le « meilleur des mondes » du laisser-faire où sont simultanément optimisés le bonheur de ces sympathiques ruminants et l’usage des feuilles qu’ils broutent. En voici la démonstration :
« Donc, si nous nous abstenons d’interférer avec les affaires des girafes, 1) la quantité maximale de feuilles sera cueillie du fait que les girafes au cou le plus long parviendront, à force de condamner les autres à la mort par inanition, à s’approcher le plus près possible des arbres, 2) chaque girafe visera les feuilles les plus succulentes parmi celles qui sont à sa portée, et 3) les girafes pour lesquelles la jouissance d’une feuille en particulier est la plus grande seront celles qui allongeront le cou le plus loin pour l’atteindre. Ceci assure que le plus grand nombre des feuilles les plus juteuses aura été avalé, et fait en sorte que chaque feuille individuelle aura atteint le gosier convaincu qu’elle mérite le plus important effort » (ibid. 283).
Tout est donc pour le mieux dans le meilleur des mondes du laisser-faire. Comment caractériser succinctement une politique fondée sur lui ? En fait, dit Keynes, le principe qui lui est sous-jacent tient en quelques mots :
« La requête que l’agriculture, les industriels et le commerce présentent aux gouvernements est aussi modeste et raisonnable que celle que Diogène adressa à Alexandre : ‘Ôte-toi de mon soleil’ » (ibid. 279).
La « main invisible » d’Adam Smith
Un principe aussi simple pour le rapport entre les hommes qu’« Ôte-toi de mon soleil », auquel chacun souscrit spontanément, ou en tout cas, comme le dit Keynes, les agriculteurs, les chefs d’entreprise et les marchands, pourrait être érigé sans peine en un système politique ayant la capacité de satisfaire tout le monde. Quelles seraient les conditions à remplir :
« Supposons que par l’opération des lois naturelles, des individus poursuivant leurs intérêts propres de manière éclairée et dans un contexte de liberté, tendent à promouvoir en même temps l’intérêt général ! Toutes nos difficultés philosophiques seraient alors résolues – ou tout au moins pour l’homme de la pratique, qui pourrait alors concentrer ses efforts sur la mise en place des conditions nécessaires à la liberté » (ibid. 274-275).
Il suffirait qu’une seule hypothèse soit vérifiée, celle de la fameuse « main invisible » d’Adam Smith : que chacun se contente de poursuivre son intérêt personnel et le bien général en résultera. Il s’agit là sans doute d’un vœu pieux mais puisque chacun serait aisément disposé à y souscrire, supposons que l’hypothèse a en effet été vérifiée.
Il est peut-être bon de rappeler les termes en lesquels Smith lui-même avait énoncé cette hypothèse en 1776 dans La richesse des nations :
« Comme chaque individu […] entreprend autant qu’il le peut, d’une part, d’utiliser son capital pour soutenir l’industrie domestique et, d’autre part, de contribuer ainsi à ce que les produits de cette industrie aient la plus grande valeur, il en résulte que chaque individu travaille nécessairement de cette manière à rendre le revenu annuel de la société aussi important qu’il en a le pouvoir. En règle générale en effet, il n’entend ni promouvoir l’intérêt public, ni ne sait de combien il le promeut. En préférant le succès de l’industrie nationale à celui de l’industrie étrangère, il ne pense qu’à s’assurer personnellement une plus grande sécurité ; et en dirigeant cette industrie de manière à ce que son produit ait le plus de valeur possible, il ne pense qu’à son propre gain ; en cela, comme dans beaucoup d’autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n’entre nullement dans ses intentions ; et ce n’est pas toujours ce qu’il y a de pire pour la société, que cette fin n’entre pour rien dans ses intentions. Tout en ne recherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d’une manière bien plus efficace pour l’intérêt de la société que s’il avait réellement pour but d’y travailler. Je n’ai jamais vu que ceux qui aspiraient dans leurs entreprises de commerce à travailler pour le bien général, aient fait beaucoup de bonnes choses. Il est vrai que cette belle passion n’est pas très commune parmi les marchands, et qu’il ne faudrait pas de longs discours pour les en guérir » (Smith [1776] 1976, tome I : 456).
Smith affirme qu’il en est ainsi, et il a la vraisemblance pour lui, mais d’où tient-il que l’hypothèse soit vraie ? Certainement pas de constatations qui seraient d’ordre d’économie politique, observe Keynes :
« Le plaidoyer d’Adam Smith en faveur du ‘système simple et évident de la liberté naturelle’ résulte de sa vision théiste et optimiste de l’ordre du monde, telle qu’il l’expose dans sa Théorie des sentiments moraux (1759) plutôt que d’une quelconque proposition de l’économie politique à proprement parler » (Keynes [1926] 1931 : 279).
Pourquoi l’affirmation par Smith que cette hypothèse est vraie le servait-elle ? Parce qu’il se situait toujours dans la ligne de la Révolution anglaise de 1641, dans la ligne de réponses à opposer à un monarque absolu : que les interférences intempestives du pouvoir dans la vie du citoyen ordinaire font davantage de tort que de bien.
« L’objectif d’une promotion de l’individu était de déposer le monarque et l’Église », observe Keynes (ibid. 273).
Michel Foucault a développé cette brève remarque de Keynes ; il notait ainsi dans sa leçon du 28 mars 1979 au Collège de France :
« L’économie ne peut avoir que la vue courte, et s’il y avait un souverain qui prétendait avoir la vue longue, le regard global et totalisant, ce souverain ne verrait jamais que des chimères. L’économie politique dénonce, au milieu du XVIIIe siècle, le paralogisme de la totalisation politique du processus économique. […] la théorie de la main invisible me paraît avoir essentiellement pour fonction, pour rôle, la disqualification du souverain politique » (Foucault 2004 [1979] : 284-285 ; 287).
Ceci dit, l’hypothèse de l’autorégulation de l’économie par une « main invisible », est-elle plausible ? En réalité non selon Keynes :
« … nombreux sont ceux qui reconnaissent que cette hypothèse simplifiée ne rend pas compte des faits correctement mais concluent néanmoins qu’elle décrit ce qui est ‘naturel’ et est pour cette raison, idéal » (Keynes [1926] 1931 : 285).
Faut-il alors faire confiance à la main invisible ? Non une fois de plus, déclare Keynes :
« Il n’est pas vrai que les hommes disposent d’une ‘liberté naturelle’ normative dans leurs activités économiques. […] Le monde n’est pas gouverné d’en-haut de telle manière que l’intérêt privé et social coïncident toujours. Le monde n’est pas géré ici-bas de telle manière que ceux-ci coïncident en pratique. Que l’intérêt égoïste éclairé opère toujours dans l’intérêt général n’est pas une déduction correcte des principes de l’économie. Il n’est pas vrai non plus que l’intérêt égoïste soit éclairé ; ce qui est le plus souvent le cas, c’est que des individus agissant séparément pour promouvoir leurs propres objectifs sont trop ignorants ou trop faibles pour parvenir même à les atteindre. L’expérience ne révèle pas que les individus, quand ils se constituent en unités sociales, soient toujours moins clairvoyants que quand ils agissent à titre séparé » (ibid. 287-288).
Il arrive même que le laisser-faire débouche sur la destruction du système économique :
« … il se peut même que l’intérêt [égoïste] des individus aggrave la maladie » (ibid. 291-292).
La rationalité économique et l’éthique sont inconciliables
Nous avons vu Keynes affirmer que
« Le socialisme d’État au XIXe siècle est né de Bentham, de la libre concurrence, etc. et constitue par certains aspects une version plus claire, et par d’autres aspects, plus confuse, de la même philosophie exactement qui sous-tend l’individualisme du XIXe siècle (ibid. 291),
et souligner aussi que
« … en dépit de leurs racines plongeant dans les philosophies politique et morale de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècles, l’individualisme et le laisser-faire n’auraient pu sur le long terme confirmer leur emprise sur la conduite des affaires publiques, s’ils n’avaient été conformes aux besoins et aux souhaits du milieu d’affaire de l’époque » (ibid. 286).
Et par le biais d’une charge contre Bentham, ce sont donc ces mêmes milieux d’affaire que Keynes cherche à atteindre.
Robert Skidelsky a écrit avec beaucoup de justesse alors qu’il s’apprêtait à mettre un point final au portrait minutieux de Keynes qu’il a brossé en trois volumes :
« … il en vint à se rendre compte que ce n’était pas le christianisme qui était l’ennemi, mais l’ »esprit calculateur benthamite » ou, plus prosaïquement, le matérialisme. L’âge aidant, l’athéisme de son adolescence – le rejet du dogme chrétien – avait cessé de définir son attitude envers le christianisme. Il s’était mis à l’apprécier pour des raisons d’ordre social et moral » (Skidelsky 2000 : 474).
Keynes était parvenu à la conclusion que le véritable ennemi du genre humain c’était bien celui-ci : l’utilitarisme benthamite, bien davantage que le christianisme qu’adolescent et ensuite jeune homme, il avait initialement mis au banc des accusés.
Car qu’est-ce qui suggère en fait de jeter un autre regard sur le militantisme darwinien des girafes que nous avons vu à l’œuvre, et à poser grâce à ces paisibles animaux, quelques questions embarrassantes à l’« esprit calculateur benthamite », et au capitalisme en général ? C’est l’éthique :
« Si nous avons à cœur le bien-être des girafes, nous ne devons pas perdre de vue la souffrance des cous plus courts condamnés à mourir d’inanition, ni non plus ces tendres feuilles qui tombent à terre et seront piétinées dans la bagarre, ni la suralimentation des girafes à très long cou, ni le mauvais regard en proie à l’anxiété, ni encore l’avidité combative qui obscurcit certains doux visages de leur troupeau » (Keynes [1926] 1931 : 285).
L’ennemi ultime de toute « solution du problème économique », autrement dit l’éradication de la pauvreté et du manque matériel en général, c’est donc selon Keynes, l’utilitarisme, cet « esprit calculateur benthamite » qui constitue le principe du capitalisme. Or si l’on y réfléchit un peu, l’esprit du capitalisme est une bien étrange manière de concevoir le monde et les hommes qui peuplent celui-ci :
« … ils ont commencé par supposer un état-de-choses où la distribution idéale des ressources productives se réalise par l’action d’individus agissant de manière autonome en recourant à la méthode d’essai et d’erreur, ce qui assure que les individus allant dans la bonne direction annihileront dans la concurrence qui s’exercera entre eux ceux qui vont dans la mauvaise direction. Ceci implique qu’aucune merci ne sera accordée à ceux qui auront mis en jeu leur capital ou leur travail en s’engageant dans la mauvaise direction, qui ne bénéficieront eux d’aucune protection. Il s’agit d’une méthode qui permet à ceux qui deviennent les plus prospères dans la course au profit de parvenir au sommet dans une lutte pour la survie brutale, lutte qui sélectionne les plus efficaces au prix du sacrifice des moins efficaces. Elle ne tient pas compte du prix de cette lutte, mais s’intéresse uniquement aux bénéfices du résultat final, dont on suppose alors qu’ils sont permanents » (ibid. 282).
Keynes souligne que la rationalité de l’homo oeconomicus, telle que la conçoivent les économistes, va à l’encontre de l’éthique. De là à penser que cette rationalité économique est destructrice de l’ordre social il n’y a qu’un pas, que Keynes n’hésite pas à franchir. On nous présente, dit-il, le motif le plus méprisable, l’appât du gain, comme le moteur sain et légitime de l’économie dans son fonctionnement normal :
« C’est donc à l’une des plus puissantes des motivations humaines, à savoir l’amour de l’argent, qu’est confiée la tâche de redistribuer les ressources économiques de la manière optimale pour augmenter la richesse » (ibid. 284).
Constatation qui lui permet alors de raffiner davantage la métaphore darwinienne de l’esprit du capitalisme qu’il avait offerte dans sa parabole des girafes :
« Darwin invoqua le désir sexuel, à l’œuvre dans la sélection sexuelle, comme un accessoire à la sélection naturelle par la concurrence, qui permet de guider l’évolution le long des voies qui seraient à la fois désirables et efficaces, de même, l’individualiste invoque l’amour de l’argent, à l’œuvre dans la poursuite du profit, comme un accessoire à la sélection naturelle, pour réaliser la production à la plus grande échelle possible de ce qui est le plus ardemment désiré et que sa valeur d’échange mesure » (ibid.).
Par quoi remplacer le laisser-faire ?
La crise de 2008 annonçait, dit-on, le retour en force des idées de Keynes en économie. Celui-ci a effectivement lieu en ce moment-même, et sous de multiples formes, mais c’est sans doute dans la fin du laisser-faire que le retour de Keynes se manifeste le plus clairement, fin honteuse sans doute, qui n’ose dire son nom, mais fin néanmoins.
Où l’État doit-il exercer de préférence son empire ? La première distinction à établir, dit Keynes, est celle que Bentham, recourant au latin, avait établie entre les choses qu’il convient de faire, Agenda et celles dont il convient au contraire de s’abstenir, Non-Agenda :
« Nous devons distinguer ce que Bentham, dans sa nomenclature très utile bien qu’aujourd’hui oubliée, appelait Agenda et Non-Agenda, et le faire sans l’a priori de Bentham que toute interférence est, automatiquement, « généralement non-nécessaire » et « généralement pernicieuse ». La principale tâche des économistes au jour d’aujourd’hui est peut-être de distinguer sur des bases nouvelles les Agenda des gouvernements des Non-Agenda, et la tâche accompagnatrice de la politique est de mettre au point au sein d’une démocratie, les formes de gouvernement qui seront capables de mener à bien les Agenda » (ibid. 288).
Keynes précise alors que
« L’Agenda le plus important pour l’État ne touche pas aux services que des individus privés assurent déjà, mais à ces fonctions qui tombent en-dehors de la sphère de l’individuel, ces décisions qui ne seraient prises par personne si l’État ne les prenait pas quant à lui. La chose la plus importante pour l’État n’est pas de faire des choses que des particuliers font déjà, et de les faire un tout petit mieux ou un tout petit peu moins bien qu’eux, mais de faire des choses qui à l’heure qu’il est ne sont faites par personne » (ibid. 291).
Pourquoi le démenti par les faits du laisser-faire est-il ignoré ?
Et Keynes achève son examen de la doctrine du laisser-faire par quelques dures remarques sur la nature du capitalisme :
« Je pense pour ma part que le capitalisme, géré avec sagesse, peut probablement être rendu plus efficace dans la tâche de réalisation de buts économiques que tout autre système dont nous avons connaissance, mais qu’en lui-même, il est de bien des manières extrêmement répréhensible […] ce qui me semble être la caractéristique essentielle du capitalisme, c’est la manière dont l’appel intense qu’il adresse aux instincts des individus qui les poussent à faire de l’argent et à aimer l’argent, constitue chez lui la principale force motrice de la machine économique » (ibid. 293-294).
Le monde des affaires peut-il alors accepter les propositions faites par Keynes pour améliorer le fonctionnement du capitalisme ?
« Suggérer à la City de Londres une action de type social dans une perspective de bien public est l’équivalent de discuter de L’origine des espèces avec un évêque il y a soixante ans [P.J. : dans les années 1870]. La réaction instinctive n’est pas d’ordre intellectuel mais moral. C’est une orthodoxie qui est mise en question, et plus les arguments seront convaincants, plus grave sera l’offense. Ceci étant dit, m’étant aventuré dans le repaire du monstre en léthargie, j’ai quand même pu investiguer ses prétentions et sa généalogie de manière à mettre en évidence qu’il a régné sur nous davantage par droit héréditaire que par mérite personnel » (ibid. 287).
Pourquoi les inconditionnels du capitalisme rejettent-ils, se demande Keynes, ce que j’avance, alors que mes propositions n’ont qu’un seul but : le sauvetage du système qui leur est si cher ? La réponse est celle-ci :
« … les adeptes du capitalisme sont le plus souvent indûment conservateurs, et rejettent les réformes de son fonctionnement technique qui pourraient en réalité le renforcer et le préserver, de peur que celles-ci ne se révèlent n’avoir été en réalité que les premiers pas conduisant à son abandon » (ibid. 294).
C’est donc que les hommes d’affaire ont percé à jour Keynes et savent quel est son véritable objectif.
Synthèse par GPT4 de l’apport d’une agence marketing politique L’Agence Marketing Politique se spécialise dans l’accompagnement des candidats, consultants politiques…