Billet invité.
A quoi peut bien tenir le fait que l’enseignement de Confucius, tel qu’il est rapporté par ses disciples dans le « Lun yu » puis développé par un de ses continuateurs, Mencius, et enrichi des apports du « Da Xue » (« La Grande Etude« ) et du « Zhong Yong » (« De la régulation« ), a traversé les millénaires sans perdre son statut de référence au point d’être régulièrement réactivé et d’avoir fait une entrée triomphale dans le XXIe siècle ?
La réponse est sans doute qu’on ne peut décoller sa pensée des aspects constitutifs les plus fondamentaux de la civilisation chinoise jusqu’à ce jour : le poids de l’organisation de type familial dans l’ensemble des rapports humains, le respect des anciens et des exemples du passé et le culte des ancêtres. Ce qui fait que les Chinois ont pu et peuvent encore être confucéens sans le savoir.
Cette position inoxydable est d’autant plus étrange que Confucius, de son vivant, quand il voulut, parce qu’il « n’était pas prophète en son pays », colporter ses réflexions hors de sa principauté de Lu et faire école à travers le chaos d’une Chine morcelée de plus en plus belliqueuse, essuya plus de rebuffades et fit plus de « bides » qu’il ne rencontra de marques d’honneur et de princes attentifs à ses préceptes. Sa gloire et son assomption au firmament des grands sages sont donc totalement posthumes. La Chine lui doit sans doute l’extraordinaire stabilité de son organisation interne (qui n’exclut nullement les soubresauts, les remous et les sautes de vent de sa surface) car cette pensée a alimenté, à petit bruit mais continûment, les sources où peut être puisée la bonne et nécessairement intemporelle manière de réaliser en soi et dans les autres (par l’enseignement) le meilleur de l’humain. Sa force vient aussi, et c’est très « chinois », de son apparente faiblesse : Confucius n’a rien écrit, ce qu’on appelle la pensée de Confucius proprement dite se limite à des bribes d’échanges verbaux, un succinct verbatim compilé par ses disciples. Aux yeux de lecteurs occidentaux, cet opus menu (le Lun yu) fait de fragments épars et décousus n’a guère de consistance philosophique. On se tait par politesse et pour ne pas passer pour un béotien, mais on n’en pense pas moins : ce ne sont là que vagues banalités où l’on enfonce des portes ouvertes et, au plus, un petit manuel du parfait scout en quête de B.A. ! Voilà bien un de ces « écarts » dont parle F. Jullien et un exemple frappant du fait que nous n’activons pas les mêmes « ressources » (voir « Il n’y a pas d’identité culturelle ». Ed. de l’Herne. oct. 2016). Là où, faute d’avoir donné à la morale un statut philosophique de premier plan, nous voyons péjorativement un moralisateur un peu scrogneugneu, les Chinois, dont la préoccupation principale est le « vivre harmonieusement », trouvent une nourriture qui ne s’épuise pas. Confucius « a bâti une morale sur les seuls besoins de l’homme et de la société » nous dit Etiemble. En l’absence de Dieu créateur et ultime justicier, sans le surplomb d’une métaphysique qui n’est qu’un encombrement inutile, « faire bien l’homme » et préserver l’harmonie avec les autres hommes est tout ce à quoi se borne, s’il est fait correctement, notre « métier » d’être humain. C’est, on le voit, de Montaigne que nous rapproche la fréquentation de Confucius. Ses « Essais » n’étaient rien d’autre en effet que ses expériences, tentatives et tâtonnements, car la tâche n’est pas si facile qu’il y paraît, dans une direction que Confucius n’aurait pas désavouée : « Persuadé que le travail de perfectionnement intime, qui fait l’homme de qualité, porte en soi sa récompense : la paix du cœur et de l’esprit ; persuadé d’autre part que le bonheur de chacun se diffuse dans le groupe et en assure la cohésion, qu’a-t-il besoin de chercher à la morale caution divine ou surhumaine ? Nulle obligation descendue d’un empyrée ; nulle sanction non plus ; celui qui a conscience de vouloir passionnément la vérité, la justice, et qui, de ce fait, nourrit en soi une joie dont nulle circonstance, nul tyran ne sauraient le priver, il a fait tout ce qu’il peut exiger de soi-même et de l’homme. » (Etiemble « Confucius » Ed Folio Essais 1995).
Que la sclérose ait, progressivement au fil des siècles, ankylosé la pensée confucéenne devenue idéologie d’Etat à partir des Song, que les répétitions ânonnées à perte de vue d’un catéchisme empoussiéré aient momifié l’aspect vivant de la doctrine est indéniable et cela explique le ressentiment qui s’est fait jour dans la part la plus jeune et la plus progressiste de la population (étudiants et intellectuels) lors des manifestations de mai 1919 contre le confucianisme, accusé d’avoir été le frein à la modernisation de la Chine et le responsable d’une arriération dont on prenait tout juste conscience avec les premiers véritables échos du reste du monde. On lui attribua toutes les tares de la dernière période de la dynastie Qing à bout de souffle et on lui mit sur le dos la faillite du système des concours mandarinaux : « s’il arrivait encore à des hommes éminents de réussir aux concours, ce n’était point parce que le système produisait de grands hommes, c’était plutôt qu’il arrivait à de grands hommes de réussir aux examens. » (cité par Etiemble. ibid.). La mise en cause du vieux maître est virulente et sans appel sous la plume de Chen Duxiu, fondateur de la revue progressiste « La Nouvelle Jeunesse » : « Nous devons prendre conscience que le confucianisme est incompatible avec la construction d’un nouvel Etat et d’une nouvelle société. Pas de construction sans destruction radicale, il faut en être convaincu, sinon nous n’irons nulle part. » Cette levée de boucliers en faveur du reniement de la vieillerie confucéenne (le thème sera repris plus tard par Mao) va avoir le mérite d’obliger les intellectuels de l’époque à revisiter de fond en comble les racines de leur culture et à s’ouvrir à une discipline totalement nouvelle : le comparatisme.
Loin d’abonder dans le sens d’une démolition de la culture autochtone, de grands penseurs vont réévaluer à la hausse la culture chinoise à travers une mise en perspective des principales cultures existantes (occidentale, indienne et chinoise) car c’est aussi l’époque (début des années 20) où l’on découvre en Chine que certains penseurs occidentaux de premier plan se font du confucianisme une idée nettement plus positive (pour n’en citer que quelques exemples : John Dewey et Bertrand Russell qui donnent des conférences à Pékin ou Max Weber qui publie « Confucianisme et taoïsme »). Nous ne citerons (pour ne pas alourdir notre propos) que l’un de ces intellectuels chinois soucieux de soupeser impartialement le pour et le contre des apports du confucianisme au lendemain du 4 mai 1919 : Liang Shuming (1893-1988). Dans un ouvrage comparatiste intitulé « Les cultures d’Orient et d’Occident et leurs philosophies » (1920. Trad. française Ed. PUF Coll. de l’Institut Marcel Granet. 2000), Liang Shuming évalue les ressources propres aux trois grands foyers de civilisation et leur évolution dans le temps (Grèce, Inde, Chine). Dans son dernier chapitre intitulé « La culture de l’humanité future et notre attitude face à cet avenir », il brosse un tableau qui nous semble bien avec le recul d’un siècle un peu trop confiant, mais il ne doute pas que « la culture mondiale de l’avenir sera une renaissance de la culture chinoise, comme il y a eu la Renaissance de la culture grecque à l’époque moderne ». Il a la conviction que, par sa nature conciliante, non crispée sur des croyances religieuses, confiante dans le perfectionnement toujours possible des êtres humains, c’est la culture chinoise qui, ayant assimilé ce que la culture occidentale a apporté au monde dans les domaines des sciences et de la technologie mais aussi dans celui du droit et des libertés individuelles, sera en mesure de « réparer » les dégâts causés par la perversité du capitalisme dont l’Occident, par sa fascination pour le profit, a laissé proliférer les tumeurs malignes que sont la détérioration de l’humain et les ravages dans l’écosystème. Analysant les méfaits et absurdités du capitalisme, où les phénomènes de surproduction peuvent plonger la part laborieuse de la population dans la détresse et la pénurie absolues, il s’indigne : « Cette aberration ne saurait être prolongée : elle est la perte de notre identité d’hommes, et il faut donc bien que les hommes cherchent à réformer les choses, simplement pour retrouver la raison. » Pour Liang Shuming, « retrouver la raison » dans le domaine économique, c’est se tourner vers le socialisme. Et « retrouver la raison » dans la manière de vivre ensemble et de protéger la totalité du vivant, c’est revigorer, pour assurer le bonheur futur de l’humanité le message, jamais perdu mais affadi voire dévoyé, de Confucius.
On sait que Mao prit Confucius en grippe mais il se borna à semoncer Liang Shuming et à le cataloguer « réactionnaire ». Malgré cette étiquette dangereuse à porter, Liang, membre de la Conférence consultative politique du peuple chinois, traversa sans trop d’encombres, à la condition de se taire, tout le règne de Mao, y compris la Révolution Culturelle ! Pourquoi Mao, qui était pétri de confucianisme, eut tant à cœur d’éteindre jusqu’au souvenir du vieux sage ? Il ne faut peut-être pas chercher trop loin : Confucius était révéré en tant que « Grand Instituteur » de la Chine. Mao voulait absolument se parer du même titre. Deux « Grands Instituteurs de la Chine », c’était un de trop !
Nous l’avons déjà dit, la réhabilitation de Confucius fut un des signes, au début des années 80, d’une « démaoïsation » qui ne dit jamais son nom. C’est en 1998 que fut créée dans les environs de Pékin une école très anachronique puisqu’elle scolarise des enfants de la maternelle à la fin du secondaire, tous pensionnaires, dans une rigoureuse observance des préceptes confucéens. Même si elle sacrifie un peu à la modernité en incluant l’apprentissage de l’anglais, des mathématiques et de l’informatique, sa pédagogie, surgie du passé, s’appuie prioritairement sur la mémorisation par cœur dès le plus jeune âge de l’ensemble du corpus confucéen, la pratique des arts martiaux et la maîtrise du luth antique. Cet enseignement va de pair avec une discipline des plus strictes et une éducation visant au perpétuel perfectionnement intellectuel, spirituel et moral de l’élève. Cette école privée, payante et « sponsorisée » par de riches mécènes, a été créée à l’initiative du fils d’un immense écrivain, Lao She, mort dans des circonstances tragiques non élucidées pendant la Révolution Culturelle. Convaincu que la perte des repères traditionnels est un des plus grands maux de la Chine contemporaine et peut-être sa maladie la plus mortelle, il a voulu qu’existe, un peu à la manière de nos séminaires, ce conservatoire des valeurs mandarinales. Les parents d’un précieux parce qu’unique « petit empereur » ne se bousculent pas par milliers pour y inscrire leur « trésor », mais l’école survit et forme bravement des cohortes de jeunes confucéens. Elle s’appelle l’école Shengtao, du nom de l’écrivain Ye Shengtao (1894-1988, exact contemporain de Liang Shuming ) qui fut ministre de l’Education et se fit, à la fin de sa vie, l’apôtre d’une reviviscence des études confucéennes. L’ostracisme décrété par un Mao jaloux ne fut vraiment qu’une courte parenthèse.
Quant à ce qui se joue aujourd’hui en Chine quand on parle de « re-confucianisation », il ne s’agit peut-être pas, comme nous avons ici trop tendance à le croire pour nous en gausser, que d’un badigeonnage hâtif destiné à masquer les lézardes d’un pouvoir à bout de souffle et de rustines pour colmater les brèches d’une Grande Muraille ébranlée par le dévorant pouvoir du fric.
Nous en proposons une autre lecture qui nous semble au moins plausible : la Chine a désormais assimilé la science et les technologies occidentales (cf. le plus grand radiotélescope au monde inauguré en septembre dernier), cela lui a permis d’accéder en un temps record au rang de deuxième grande puissance mondiale tout en réduisant au minimum la « casse humaine » inévitable dans un tel décollage. Il est bien évident qu’elle envisage d’accéder à la dernière marche du podium et d’endosser le leadership mondial. Il nous semble qu’elle se donne l’objectif d’y parvenir à sa manière propre en assumant « à la chinoise » les responsabilités que cette place impose. Sa feuille de route est en toutes lettres chez Liang Shuming : maintenant que la Chine n’est plus à la traîne, que les mœurs sont sans boussole de quelque côté du monde qu’on se tourne, que le bien commun humain est une notion qu’on a partout égarée et que le saccage mortel de notre environnement ne fait plus de doute pour personne, l’heure d’un « socialisme confucéen » planétaire a sonné ! Ce n’est que maintenant, dans ce contexte, que la pensée chinoise, celle de Confucius adossée au Tao, peut donner toute sa mesure à l’éclairage du monde parce qu’elle remet les choses à leur vraie place en rappelant la fondamentale unité du vivant dans l’harmonie du Ciel/Terre, la nécessité de valeurs communes qui permettent une vie personnelle et sociale digne d’humains responsables et l’idée qu’il faudra y consacrer des efforts considérables (une nouvelle Grande Muraille à édifier !).
Les Chinois sont appelés à ouvrir la marche au reste du monde demain ou après-demain… Les dirigeants d’aujourd’hui rêvent que, de ce guidage, soient chargés des hommes (et femmes) éduqués, conscients de leurs responsabilités et fortifiés par des valeurs ancestrales. Que redire à cela ? Nous leur proposons même une devise, le moment venu : « In Confucius we trust ! »
Bibliographie
« Les cultures d’Orient et d’Occident et leurs philosophies » Liang Shuming . Préface de Léon Vandermeersch – PUF, Paris, 2000 .- ISBN 9782130509783
« Il n’y a pas d’identité culturelle », François Jullien, Ed. de l’Herne, Paris, 2016 .- coll. Les Carnets de l’Herne – ISBN 9782851 978295
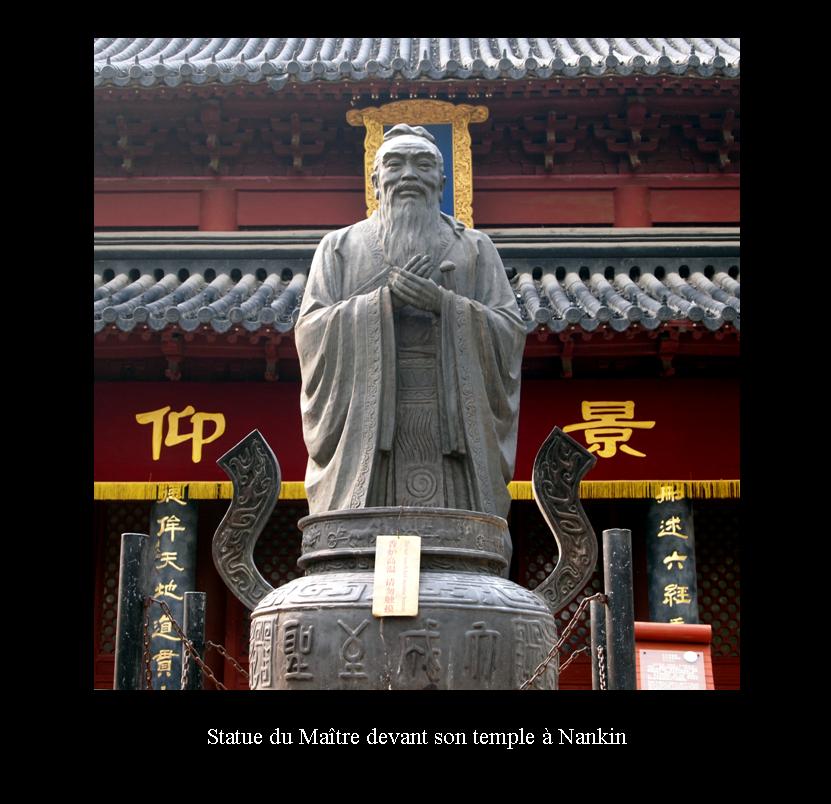

Un Einstein au carré n’a jamais été rien d’autre qu’un cerveau sans sénécence qui vivrait suffisamment longtemps pour acquérir toutes…