Ouvert aux commentaires.
Le Figaro, Apocalypse now, par Éric Zemmour
« La fin du monde est pour demain. Les robots vont prendre la place d’une humanité rendue folle par le capitalisme. Un essai tonique mais qui laisse sceptique. »
LE DERNIER QUI S’EN VA ÉTEINT LA LUMIÈRE. Paul Jorion, Fayard, 273 p.
« La surenchère est partout. La compétition, la rivalité aussi. Chez les sportifs, les artistes, les écrivains, les politiques. Chez les prophètes aussi. Paul Jorion s’était fait connaître du grand public en annonçant la crise des subprimes de 2008. Dans son dernier livre, il prophétise carrément la fin de l’espèce humaine ; son extinction et son remplacement par des robots. L’apocalypse millénariste n’est pas pour demain mais pour après-demain ; pas cinquante ans, mais cent ans. Elle sera la conjonction de trois vagues catastrophiques : crise écologique, crise économique, crise technologique. Par destruction des ressources naturelles ; destruction de la classe moyenne ; destruction de l’homme. L’auteur ne nous laisse aucune chance. Son livre n’est pas le récit analytique de ce qui conduit à notre perte. Nous n’en sommes déjà plus là, selon lui. Notre fin est actée. Il n’y a pas lieu de la discuter, ni même de l’expliquer. Elle est un fait acquis. Le livre répond à une autre question que l’on n’attendait pas si vite : pourquoi sommes-nous incapables d’éviter notre fin ?
Ce parti pris audacieux fausse notre lecture. Jorion répond à une question que l’on ne se pose pas. En tout cas pas encore. Il a sauté une étape. En tout cas pour nous, pauvres béotiens. Et il ne répond pas à la question que l’on se pose : allons-nous vraiment être remplacés par des robots ? Allons-nous être rayés de la surface de la Terre comme de vulgaires dinosaures ? Pourquoi ? Comment ? Les climato-sceptiques sont-ils vraiment tous stupides ou achetés par l’industrie pétrolière ? Les déchets nucléaires sont-ils impossibles à retraiter ? Les ouvriers anglais qui brisaient les métiers à tisser dans les années 1820 ne croyaient-ils pas déjà qu’ils seraient remplacés par les machines ? Nos robots ne pourraient-ils pas heureusement compenser la faible natalité de l’Europe et nous permettre, sur le modèle japonais, de pérenniser notre système économique en dépit de la réduction de notre population active, et ce, sans avoir besoin d’immigrés de moins en moins assimilables ? Comment l’espèce humaine, qui a triplé en un siècle, alors qu’elle avait mis des milliers d’années à atteindre son premier milliard d’êtres vivants, peut-elle disparaître en cent ans ? Le danger mortel pour l’humanité n’est-il pas, à l’inverse de ce que prétend l’auteur, son pullulement excessif, qui la répand en masse dans des villes devenues invivables et la déverse dans de vieilles cités européennes, les submergeant et détruisant leur civilisation millénaire ? Mais toutes ces questions ne seront pas posées par notre prophète tendu vers son apocalypse. Circulez, il n’y a rien à voir. Mais pas rien à lire.
L’auteur a des formules à la Woody Allen : « Nous, êtres humains, n’avons en réalité jamais digéré le fait que nous allions mourir un jour. » Beaucoup de références à des films récents, comme si le cinéma hollywoodien était parole d’évangile. Des citations en vrac, de Rousseau, Hegel, Keynes, Lacan, Molière, Freud, Nietzsche, Schopenhauer, etc., les unes archiconnues, les autres plus originales. Un style qui mêle relâchement journalistique et sentences scientifiques absconses. Un recul bienvenu de celui à qui on ne la fait pas dès qu’on parle d’économie : « La science économique est un discours dogmatique dont l’usage est d’être invoqué par les financiers pour opacifier les débats autour de la chose économique. »
L’économie, c’est son truc. Antilibéral d’une rare férocité, mais pas sans arguments. Il montre avec acuité comment le capitalisme est drogué à la croissance tandis que notre survie écologique réclame la décroissance. Comment notre démocratie est redevenue censitaire. Comment nos sociétés ayant abattu toutes les distinctions ne connaissent plus que celles fondées sur l’argent, comme l’avait prédit Tocqueville revenu d’Amérique : « Le prestige qui s’attachait aux choses anciennes ayant disparu, la naissance, l’état, la profession ne distinguent plus les hommes, ou les distinguent à peine ; il ne reste plus guère que l’argent qui crée des différences très visibles entre eux et qui puisse en mettre quelques-uns hors de pair. La distinction qui naît de la richesse s’augmente de la disparition et de la diminution de toutes les autres. »
Ses quatre cavaliers de l’apocalypse ont pour nom Smith, Bentham, Friedman, Hayek, quatre apôtres du libéralisme économique, à qui Jorion reproche d’avoir inoculé le virus individualiste, utilitariste, court-termiste qui empêche l’humanité, et en particulier ses nouveaux patrons de la finance, de voir au-delà de leur cupidité jamais assouvie. Et, accessoirement pour les deux derniers, d’avoir soutenu la dictature chilienne de Pinochet et d’avoir débranché le libéralisme économique de son moteur politique historique, la démocratie libérale.
Mais quand il quitte les terres de l’économie, le pas de notre auteur se fait moins assuré. Ses analyses sur la catastrophe écologique, moins acérées, plus banalisées. L’avènement des robots doit plus au souffle du cinéma qu’aux réalités concrètes. Le transhumanisme est survolé et guère discuté. Jorion est au fond un moraliste à l’antique qui cherche une religion sans dieu, finit par avoir pour seul ennemi le « veau d’or », et badigeonne d’une couche de peinture scientifique les anciennes maximes de Blaise Pascal sur la faiblesse de l’homme et sa prétention démesurée, entre les vertiges de l’infiniment petit et de l’infiniment grand : « Le cerveau humain, a dit le biologiste François Jacob, est conçu comme une brouette sur laquelle aurait été greffé un moteur à réaction. »
Jorion est un humaniste égaré dans un monde techniciste. Son essai sur l’extinction de l’humanité hésite entre la fable et le pamphlet, entre la parabole et la note économique, entre la prophétie millénariste et le rapport d’entreprise. On le suit et on le perd. Il ne se lasse pas de citer le Macbeth de Shakespeare : « La vie… est un conte raconté par un idiot, rempli de vacarme et de fureur, ne signifiant rien. » À la fin, on ne sait toujours pas s’il préfère disparaître sur cette terre ou trouver refuge sur une autre planète. Mais on garde la vieille maison. On ne sait jamais : elle peut encore servir. »
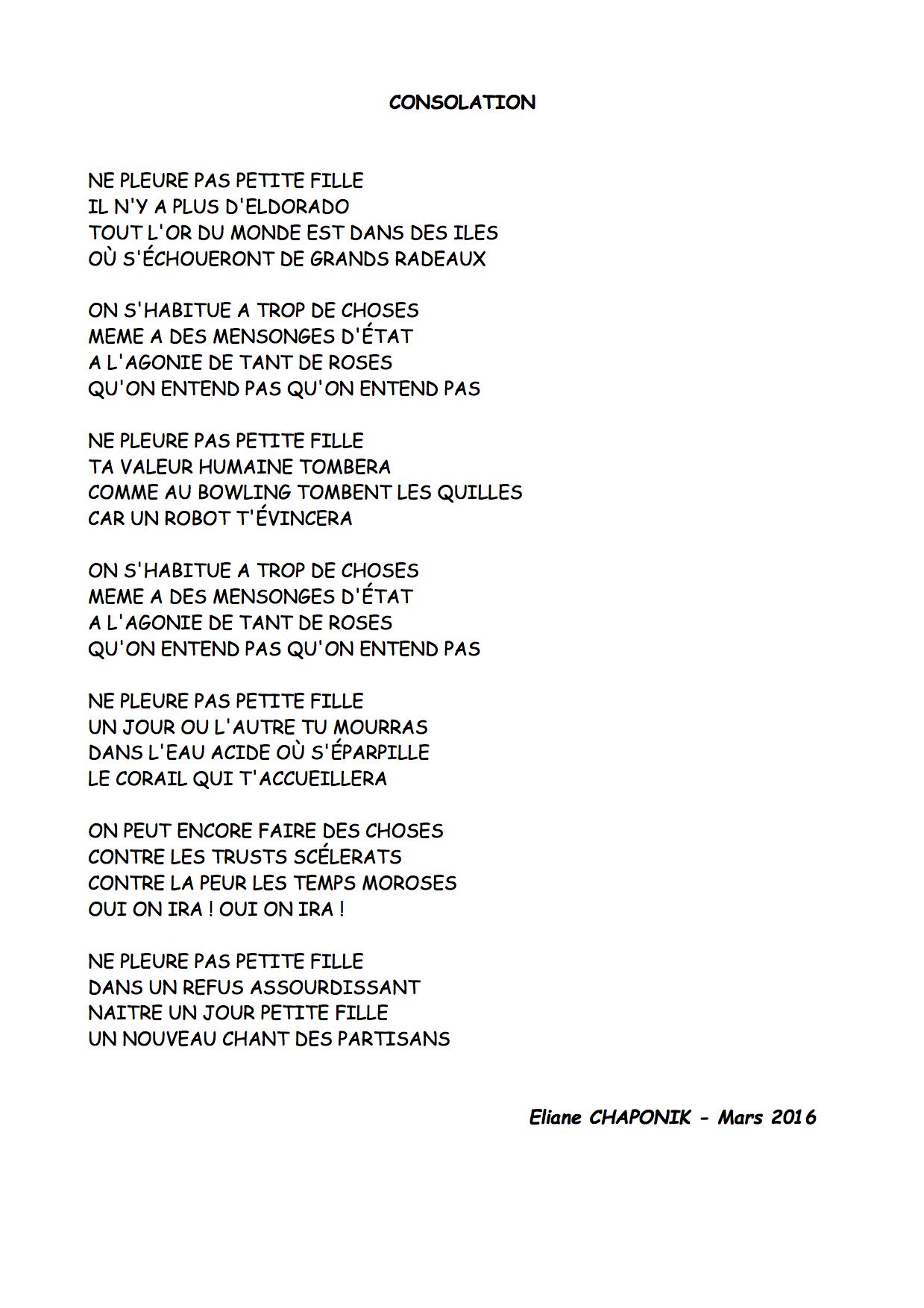
Laisser un commentaire