Billet invité.
Le livre de Paul Jorion au travers la vie et l’œuvre de John Maynard Keynes, nous parle de la genèse de la pseudo ‘science économique’, et comment bien que reposant sur des postulats erronés, elle réussit à métastaser dans tous les secteurs de nos sociétés. Jusqu’à nous amener aujourd’hui au bord du gouffre.
Mais Penser tout haut l’économie avec Keynes, nous incite au contraire à ne pas désespérer. En nous montrant ce qu’une éducation pétrie d’une longue tradition d’humanisme, peut apporter aux hommes en les obligeant à s’élever au-dessus de leur égoïsme de classe. Comment elle tend alors à dissiper l’épaisse et aveuglante fumée de nos croyances, celles qui nous cachent l’accaparement des richesses par quelques-uns.
A contrario, en faisant revivre d’une manière originale la pensée de Keynes, Paul Jorion nous réapprend une leçon essentielle : il ne saurait y avoir d’économie viable, qu’au service du bien commun.
C’est pourquoi, en toute subjectivité, j’ai voulu écrire ces notes. Pour faire partager le plaisir que j’ai éprouvé en tant que lecteur, à me réapproprier le présent au travers du passé. Afin de pouvoir penser un avenir commun. Ensemble !
Rien que pour cela, ce livre mériterait d’être remboursé par la sécurité sociale.
De l’économie politique, à la pseudo-science économique
Ce livre nous parle du plus gigantesque tour de passe-passe de tous les temps. Celui qui a vu une économie politique, véritable science au service du bien commun, être remplacée par la pseudo-science économique, véritable escroquerie au service d’une infime, mais désormais toute puissante, kleptocratie.
Et comment mieux décrire notre époque de nouvelles ténèbres, qui voit les inégalités et les injustices grandir et qui amène l’humanité au bord du gouffre, qu’en parlant de la lumière ? Non pas de la froide lumière idéelle et calculatrice distillée par nos écrans, mais de la fragile et vacillante lumière de l’esprit humain. Celle de l’intelligence d’un homme pétri d’humanisme et formé aux meilleures écoles de son temps, celle du plus célèbre des inconnus : John Maynard Keynes.
Et il fallait bien l’érudition d’un Paul Jorion, qui a pris la peine de lire et d’étudier dans le texte la pensée de Keynes, pour réaliser ce tour de force : remettre au jour la vieille science oubliée pour nous libérer de nos modernes chaînes de la prétendue « science » économique, et de sa gargouille-croquemitaine, TINA.
C’est en cela que ce livre est passionnant, parce que sans jargon et dans un langage clair, il nous parle d’histoire, d’économie, des hommes et de leurs sociétés. Il nous oblige à nous rendre compte combien les idées que nous prenons pour évidentes sont le fruit d’une construction idéologique maintenant au service d’une caste.
Au travers de plus d’un demi-siècle d’histoire faite de bruit et de fureur, traversé par deux guerres mondiales, Paul Jorion nous fait suivre le chemin de l’homme Keynes, à la personnalité si attachante et si so british pour un lecteur francophone. Il nous donne à voir le cheminement de sa pensée, de ses fulgurances, de ses doutes, mais également de ses erreurs. Il nous donne à voir un monde disparu, un autre qui aurait pu advenir à la chute du nazisme, mais qui ne fut jamais de par la volonté américaine. Il nous donne à comprendre pour pouvoir mieux agir. Un cadeau inestimable à l’heure où le statu quo ante n’est plus possible.
Penser tout haut l’économie avec Keynes, mais aussi avec Paul Jorion et tous les humains de bonne volonté, qui veulent un avenir et un monde vivable pour leurs enfants.
Du privilège de recevoir une éducation de qualité, et de la nécessité de savoir dépasser son égoïsme de classe
John Maynard Keynes est né en 1883 à Cambridge, à l’apogée de l’Empire britannique et du Rule, Britannia!, sous le règne de Victoria, Reine de Grande-Bretagne et d’Irlande, et Impératrice des Indes. Un homme du 19ème siècle donc, issu d’une famille d’intellectuels de la bourgeoisie anglaise (un père Maitre de conférences, une mère écrivaine qui sera élue maire de Cambridge), et qui bénéficia d’une formation des plus élitistes. Passant du collège d’Eton au King’s College de Cambridge. Si l’on ajoute pour faire bonne figure, que le jeune Keynes était outrageusement doué en mathématiques, discipline ou il trusta les premiers prix, certains seront sans doute tentés de le comparer à nos « élites » actuelles, à un improbable hybride entre énarchie et rigidité victorienne. Or il n’en est rien !
Keynes était un « Cambridge man », le produit d’un milieu intellectuel dont les racines remontent à l’esprit scolastique de l’université médiévale, celle de la poursuite du projet aristotélicien. Paul Jorion nous fait découvrir un homme pour qui les mathématiques ne sont qu’un simple outil, certes utile, mais trivial. Loin, très loin de la discipline qu’il juge première entre toutes : la philosophie. Et le lecteur de (re)découvrir la véritable signification du mot élite. Non celle de la vulgarité crasse et de la suffisance auxquelles les lamentables oligarques nous ont accoutumés, mais au contraire, celle d’une éthique de la vertu que des hommes libres s’essayent à transformer en actes, au service du bien commun et de la bonne vie.
Aux antipodes des pratiques de nos modernes nihilistes de l’Eurogroupe et autre Troïka !
Alors sans doute, est-il difficile de s’imaginer ce que ressentit cet homme pétri d’humanisme, en voyant la jeunesse européenne disparaître dans la boue des tranchées, en un absurde carnage industriel. Et lorsque la conscription sera décrétée en Grande-Bretagne en 1916, Keynes s’affirmera fort logiquement, objecteur de conscience. Mais, et c’est là toute l’ambigüité de l’homme, en tant que haut-fonctionnaire au ministère des Finances et rouage clé dans l’économie de guerre, un tribunal militaire le jugera comme étant indispensable au poste qu’il occupe. Alors même que Keynes écrit et dit à qui veut l’entendre « travailler pour un gouvernement qu’il exècre en vue d’objectifs criminels » ! Pour ses amis, pas dupes, ceux du groupe dit « de Bloomsbury », constitué d’intellectuels et d’artistes bohèmes, il rejoint ainsi le camp des gentlemen en haut de forme qui se tiennent prudemment éloignés des champs de bataille.
La fin de l’innocence qui le voit sauver sa peau, alors que tant de ses proches disparaissent dans le hachoir. Mais qui de nos jours, pourrait le lui reprocher ? Au contraire même. En notre époque de nouvelle barbarie, pouvons-nous nous féliciter que John Maynard Keynes ne fut pas immolé inutilement !
Lucide néanmoins, à la fin du conflit, Keynes ne pourra que constater la disparition de son monde : celui de l’ère victorienne et d’une certaine civilisation aristocratique.
Cette même lucidité qui le fera démissionner de son poste de haut fonctionnaire, pour mieux dénoncer l’atmosphère revancharde de la conférence de Paris, ainsi que le Traité de Versailles qui en sera l’aboutissement mortifère. En sortira un livre, « Les Conséquences économiques de la paix », où il affirmera l’impossibilité pour l’Allemagne de payer des dettes de guerre surévaluées par la France, ainsi que le ressentiment que cela ne manquera pas de susciter. Traduit en douze langues, l’ouvrage connu un immense succès et assit la réputation de son auteur.
Keynes venait de trouver là, le rôle qu’il jouera jusqu’à sa mort en 1946, celui de l’intellectuel montrant la vérité nue. Celle-là même que les hommes politiques de tous temps, tous bords et toutes nationalités, essayent sans cesse de travestir.
Ça n’est donc qu’au début des années 20, à 35 ans passés, que ce mathématicien et philosophe de formation, démissionnaire de son poste de haut fonctionnaire, devint pour des raisons bassement matérielles, économiste !
Mais à sa manière, celle d’un iconoclaste guidé par la scolastique médiévale. Comment s’étonner alors que son premier travail véritablement universitaire fut tellement… détonnant ? Et en effet, si dans son « Traité de probabilités » publié en 1921, il rend hommage à Alfred Nobel, c’est à sa manière bien particulière : en dynamitant la doxa qui veut que l’on puisse dans tous les cas, attribuer une valeur à une probabilité. Remettant par-là même en cause, l’usage immodéré que fait la théorie économique des mathématiques ! Victimes collatérales, Homo oeconomicus et autres esprits animaux, s’y verront couverts de honte et de ridicule. Une implacable démonstration, qui pour notre plus grand malheur comme le rappelle Paul Jorion, est toujours superbement ignorée 94 ans plus tard. Que ce soit la réglementation de Bâle-III, relative au risque financier des banques, ou celle de Solvabilité-II, relative au risque des compagnies d’assurances, toutes deux s’appuient sur des calculs du degré de risque couru, dont l’absurdité fut prouvée par Keynes en 1921 !
Comme il est dit et démontré à longueur de billets sur ce blog, c’est cela la véritable signification du mot férocité. Celle d’une religion qui en niant la réalité, rend la catastrophe inéluctable.
Et en parlant de catastrophe, ce n’est pas manquer de respect à la mémoire du grand homme, que de dire qu’il y eut un Winston Churchill décideur économique. Aussi mal à l’aise que l’on puisse l’être avec l’économie, Churchill et sa politique inspirera à Keynes un autre livre publié en 1925, « Les Conséquences économiques de M. Churchill ». Keynes s’y attaque au retour de l’étalon-or, cette relique barbare comme il la nomme, dans un ouvrage qui parle d’économie au travers de philosophie sociale et des indispensables consensus à préserver. Il y affirme, blasphème suprême !, que si des équilibres économiques peuvent apparaître dans diverses configurations sociopolitiques, le seul critère discriminant doit être celui des équilibres sociaux. Ce qu’il s’agit de maintenir aux yeux de Keynes, c’est sinon une maximisation du consensus, tout au moins une minimisation du dissensus. Ignorez ce simple fait tout de bon sens, et comme nos dirigeants actuels, vous courrez le risque de provoquer une dislocation du contrat social et de la volonté de vivre ensemble !
Mais après avoir commis des ouvrages blasphématoires, qui de nos jours lui vaudraient à coup sûr le bucher médiatique, Keynes récidivera. Bientôt même, il en appellera au meurtre de paisibles et innocents rentiers !
Sans toutefois omettre de tester entre-temps ses théories financières, à des fins d’enrichissement personnel… Noblesse oblige, sans doute.
Le briseur d’idoles
L’esprit humain peut être considéré comme une machine à « donner du sens » au réel. Pour se faire, il pose des frontières afin d’enfermer arbitrairement vivants et choses dans un cadre. Bien sûr, sauf dans les cas extrêmes de psychorigidité, nous admettons que les limites des dites frontières sont souvent floues et mouvantes. Mais ce que nous ne supportons vraiment pas, c’est ce qui nous apparait comme inclassable. L’inconnu, le non-définissable nous inquiètent. À tel point que nous préférons souvent la certitude de la souffrance, mais dans un cadre connu, plutôt qu’une incertitude porteuse de tous les possibles. Une attitude qui pourrait se traduire brutalement par – la peur de la liberté -.
Or, tout dans la personnalité de John Maynard Keynes, de sa formation à son agilité intellectuelle, concourt à le rendre inclassable et par là-même, plus ou moins inquiétant à nos yeux comme à ceux de ses contemporains. Il suffit d’ailleurs pour s’en convaincre, d’écouter Keynes lui-même se définir par rapport aux systèmes politiques de son temps : un libéral d’« extrême gauche », antitravailliste et antirévolutionnaire. Un économiste jugeant aussi sévèrement la théorie marxiste, que les inepties de la ‘main invisible du marché’ ou du ‘laisser-faire’.
Une pensée complexe et subtile donc. Difficile à réduire par la simplification, sans la dénaturer. Bref, le cauchemar des politiciens professionnels et de tout bon journaliste « main stream ».
Dans ces conditions, il était écrit que le briseur d’idole que fut John Maynard Keynes, se retrouverait caricaturé par notre époque manichéenne, où une pensée, une méthode, une théorie, doivent pouvoir tenir en 140 caractères. Ou en 45 secondes, coincées entre les pages sport et les pages people des biens mal nommées ‘informations’. Keynes ? Ah oui, ce gars qui voulait tuer les rentiers et relancer l’économie par des grands travaux d’état…
Alors, bien qu’il fasse plus de 140 caractères – et que sa lecture vous prendra plus de 45 secondes -, il faut lire l’ouvrage de Paul Jorion. Parce que l’auteur a pris la peine de vérifier dans le texte ce qu’a réellement écrit Keynes, et qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage d’économie absconse et truffée d’équations. Pour tout cela et plus encore, mais surtout parce que Paul Jorion nous révèle l’homme Keynes. Un véritable extra-terrestre qui ne fétichisait pas les chiffres d’or et les règles gravées dans le marbre. Un esprit libre qui n’hésitait pas à démontrer le tragique ridicule des puissants de son époque. Un humaniste soucieux des moyens d’accroitre le bien-vivre ensemble. Un philosophe enfin, pratiquant l’éthique, cette science morale si éloignée de notre époque.
En ce sens Paul Jorion aurait pu donner comme titre à son livre, de revolutionibus orbium coelestium. Car cet ouvrage est celui des nouveaux et des anciens coperniciens. Ceux qui ont toujours su que la société n’orbitait pas autour de l‘étoile de la mort TINA, mais autour du chaud soleil de l’Humanité. Là, sont la véritable démonstration, le véritable message, de John Maynard Keynes. J’y reviendrai dans mon prochain billet.
Dans les cuisines du maître
Quand paraît en 1936 la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, Keynes a cinquante-trois ans. L’âge où expérience individuelle et enseignements d’une formation scolastique, se cumulent pour aboutir à l’écriture de l’œuvre d’une vie. Sans doute Keynes ne l’aurait-il pas entendu de cette oreille, lui qui était habitué à remettre sans cesse l’ouvrage sur le métier. Mais ainsi s’écrit l’histoire. Même les plus farouches anti-keynésiens s’accordent sur le fait, que ce traité a fondé la macroéconomie moderne, et qu’il a eu une considérable influence au 20ème siècle. Au point de devenir le marqueur de la théorie keynésienne !
Et c’est bien là le problème. Celui d’une pensée, qui tour à tour sacralisée ou vilipendée, voit son originalité disparaître derrière le mythe.
Heureusement, les chapitres que Paul Jorion consacre à cet ouvrage phare, permettent de lever le voile. En expliquant à l’aide d’exemples simples (mais non simplistes !), les « incontournables » keynésiens, ceux des concepts-formules aussi célèbres que le fameux E=mc2 d’Albert Einstein : « préférence pour la liquidité », « euthanasie des rentiers », « théorie des prix », ou autres « propriétés de l’intérêt de la monnaie ».
Vous vous direz alors avec raison, que c’est là la moindre des choses. Et sans doute penserez-vous qu’avec un minimum de maîtrise du web, on peut facilement trouver les mêmes informations.
Eh bien non !
Que vous disposiez ou non d’une solide culture économique, vous allez pouvoir entrer dans l’esprit de John Maynard Keynes, et sans baguette magique ! Éclairé uniquement par une lecture minutieuse des nombreux écrits du célèbre économiste, vous pourrez suivre l’édification d’un véritable monument intellectuel. Avec ses envolées architecturales et ses flamboyances, mais aussi avec ses ratés, ses gravats malhabilement camouflés et son espace intérieur baroque. Et c’est passionnant de suivre le guide Paul Jorion à l’intérieur du monument. De l’écouter raconter, non seulement comment furent pensés les planchers, les murs et leurs agencements, mais de le suivre également dans les fondations de l’œuvre, là où se trahissent les véritables intentions de l’architecte. Dans la profondeur et l’épaisseur des soutènements.
Et stupeur ! De découvrir que Keynes était quasiment…, j’ose à peine l’écrire tellement c’est laid : un socialiste ! Un homme capable de bâtir à lui tout seul, une théorie ad hoc pour imposer un agenda politique à base de plein emploi et de consensus sociétal. La figure même de l’antéchrist, pour les prêtres de la Religion Féroce.
Alors bien sûr, près de 80 ans plus tard, la fière construction a subi les outrages du temps. Qui oserait encore imaginer, en nos jours promis à une robotisation galopante, la société du plein emploi ?
Non seulement les fissures originelles, comme l’impensé du rapport de force entre prêteurs/emprunteurs et vendeurs/acheteurs, ou bien encore l’indétermination des mécanismes du taux d’intérêt, se sont agrandies sous le règne d’un capitalisme financiarisé et mondialisé, mais de graves malfaçons comme celle de la préférence urbi et orbi pour la liquidité, sont apparues au grand jour. Menaçant par là-même la stabilité de tout l’édifice. La résultante des petites tricheries, d’un architecte qui n’a jamais intégré les dimensions politiques, historiques et sociologiques à son horizon des évènements. Quitte à devoir utiliser lui-même, les raisonnements circulaires qu’il savait si bien dénoncer chez les autres. Voire pire ! Quitte à soutenir des explications idéalistes et non matérialistes, donc par essence irréfutables.…
Les limites intellectuelles d’un grand penseur ? Plutôt la rouerie d’un homme que ses contemporains n’hésitaient pas à juger comme étant too clever by half ! (un peu trop malin pour le commun des mortels). C’est ce que démontre Paul Jorion dans un jubilatoire chapitre faisant penser par son intitulé, à l’univers d’Agatha Christie : « L’énigmatique brouillon du chapitre 5 ». Où l’on découvre tout ce que Keynes a fait disparaitre de la version finalement publiée, et pourquoi il l’a fait.
Bonne âme, je garderai le silence pour ne pas vous ôter le plaisir de la découverte. Tout juste, à la manière de cette chère Agatha, vous livrerai-je un indice : John Maynard Keynes était plutôt constitutionnaliste que révolutionnaire.
Dans le chaudron du diable
Toute production de croyance a pour but immédiat d’escamoter le réel, en faisant passer de pures constructions idéologiques pour des évidences. Le forfait est réussi, lorsqu’en toute bonne fois, une majorité en vient à considérer comme triviales des idées qui lui ont été imposées.
Dans ce schéma, on retrouve au-dessus des ‘simples’ citoyen(ne)s, la communauté des « gardiens du Temple » : les chiens de garde bien sûr, chargés de répandre la bonne parole ad nauseam dans les médias, en décrédibilisant toute pensée alternative et en relativisant les crimes économiques. Mais aussi leurs indispensables compléments, les purs et neutres universitaires (comprendre, les économistes mainstream, grassement rémunérés par les banques et les transnationales).
Enfin, tout en haut de la pyramide, se trouvent les « maitres du Monde ». Ceux qui se moquent des subtilités de la prétendue science économique comme de leur premier million d’euros ou de dollars, mais qui comprennent tout à la corruption, aux rapports de force, et aux faiblesses des hommes.
Ceci dit, s’il faut maintenant fermer les yeux et se boucher les oreilles très fort pour ignorer l’effondrement en cours, il est tout de même nécessaire de démontrer la fausseté des raisonnements et l’ineptie des thèses, de cette prétendue « science ». Ne serait-ce que pour comprendre comment la finance, activité terne et ennuyeuse s’il en fût, s’est transformée peu à peu en arme de destruction massive pour nos démocraties.
C’est ce qu’entreprend Paul Jorion, en introduisant une notion totalement ignorée par Keynes, celle du rapport de force. Réexaminant les règles comptables, il démontre ainsi l’idéologie consistant à intégrer les salaires dans les coûts de production, alors que les profits de l’entrepreneur -par nature variables-, sont eux perçus comme une prime de risque. En clair, cela signifie que tout les surplus, une fois les coûts de production réglés, appartiennent à l’entrepreneur si tel est son bon plaisir. Et les employés dont le travail ne représente qu’un coût, n’ont donc aucune légitimité à demander un meilleur partage des richesses créées. CQFD !
Le même genre d’explication farfelue est d’ailleurs avancée par la « science » économique, dans l’importance qu’elle donne au facteur rareté pour la détermination des prix. Aux fins des fins, en poussant la logique d’un Léon Walras (l’un des fondateurs de la science économiste marginaliste) jusqu’au bout, on apprend que la rareté fait le prix tel qu’il est, parce que !
Une explication métaphysique, que Keynes lui-même ne songera pas à combattre. Aveuglé par l’institution ‘si évidente’ de la propriété privée, ce brillant esprit sera incapable de voir que la rareté n’est rien d’autre que la ponction d’une rente par un modèle de redistribution : celui des aubaines générées par la nature, et transformées par le travail des hommes. La rareté n’étant alors qu’une des résultantes possibles du rapport de force existant entre tous les acteurs. Un simple goulet d’étranglement, totalement artificiel.
Ce qu’il verra par contre, c’est que contrairement à ce que prétend la doxa, le profit n’est pas la récompense du risque. C’est même l’exact inverse, puisque par la grâce d’un rapport de force favorable, ce sont bien les riches qui réussissent à transférer la quasi-totalité du risque aux plus pauvres !
Et pourtant, au lieu d’en faire l’élément déterminant du rapport de force entre classes, au lieu d’en intégrer l’évidente dimension politique, le risque lié à l’incertitude de l’avenir ne restera pour Keynes, que l’un des ingrédients de ses fumeux « mécanismes psychologiques ».
Cependant, là où Paul Jorion s’éloigne le plus des travaux de Keynes ou de Friedrich Hayek (ceux de la doxa économique), c’est dans sa description du mécanisme global expliquant la formation des prix combinés. Dans sa réfutation du ‘prix objectif’ hayekien, dont on est bien en peine de voir autre chose qu’un ectoplasme appartenant à la même famille que la célèbre ‘main invisible du marché’. Mais également dans sa réfutation des mécanismes décrits par Keynes, notamment les mécanismes psychologiques passés à la postérité sous le terme générique ‘d’esprits animaux’.
Mais si l’aspect théorique occupe une place importante dans le livre, ce n’est jamais aux dépends de la pratique.
Et une pratique innovante ! Paul Jorion prenant comme exemples les rehausseurs de crédit des compagnies d’assurances, et les tristement célèbres Credit-Default Swap, présente ces deux catastrophes financières sous une perspective radicalement nouvelle. Celle de l’erreur grossière, dans l’interprétation de la formation du prix d’un instrument financier. Et l’on frémit rétrospectivement à l’analyse de ce qui faillit emporter dans un cas, tout un pan du secteur financier, et dans l’autre, la zone euro elle-même…
C’est ce qui s’appelle un changement de paradigme. Loin, très loin, de l’omniscience des marchés et de leurs thuriféraires nobélisés par la banque de Suède.
Ainsi, rappelons-nous que George Orwell disait que dans les temps de tromperie universelle, dire la vérité devenait un acte révolutionnaire.
Rappelons-nous que dire la vérité, surtout lorsqu’elle doit à tout prix rester cachée, a un prix.
C’est celui que Paul Jorion vient de payer en perdant sa chaire de la VUB.
Au prétexte qu’il était incapable de réciter Hamlet à l’envers, en se tenant sur une jambe.
Des monnaies et des hommes
Bien que né en 1883, John Maynard Keynes était pleinement un homme de son temps. Marqué par l’atroce absurdité de la Grande Guerre de 14-18, mais également par la désolante tragi-comédie du Traité de Versailles : un texte dicté par les égoïsmes nationaux, les intérêts politiciens courtermistes, et dont il présentait les funestes répercussions qu’il exposera dans son livre Les Conséquences économiques de la paix.
Pour ce brillant esprit formé dans l’esprit de la scolastique, il était évident que la paix entre nations devait pour pouvoir se maintenir disposer de soubassements économiques solides, et que des peuples affamés, des cohortes de millions de chômeurs, finiraient par porter au pouvoir les pires des hommes. C’est pourquoi il pensait la macroéconomie en termes de « désarmement financier », et se donnait pour objectif suprême, un système monétaire international « pacifié » et stable. Ou pour le dire avec son bel esprit anglais, a level playing field, un superbe gazon parfaitement plat où chaque pays, quel que soit son handicap, pourrait jouer à armes égales. Un système adossé à un certain type de monnaie, décrit dans le détail par Paul Jorion, et dont la résultante, l’esprit même, aboutirait à une réduction automatique des inégalités entre débiteurs et créanciers. Cela par la régulation des flots de capitaux, afin de toujours veiller à ce que leurs allocations soient favorisées, là où elles sont socialement utiles et nécessaires aux économies. Dit inversement, un système où chaque nation aurait la possibilité de gérer ses propres taux d’intérêt, sans que leur niveau ne soit déterminé par la prédation qu’exercent des capitaux pirates, à la recherche de l’opportunité la plus alléchante à l’échelle internationale.
Est-il utile de préciser que le fonctionnement d’un tel mécanisme, implique également la prohibition des havres fiscaux ? Bref, de quoi comprendre la véritable haine que près de 70 ans après sa disparition, les prêtres de la Religion Féroce vouent encore à Keynes !
Mais cela veut-il dire que la martingale absolue existe, et qu’il suffit de l’appliquer pour détruire le Veau d’Or ? Il semblerait, d’après les écrits enthousiastes qu’il a adressé au gouvernement britannique, que Keynes ait réellement cru l’avoir découverte… au travers du système économique que l’Allemagne hitlérienne avait mis en place, pour contourner le Traité de Versailles et reconstituer une armée et une industrie de guerre !
Un principe basé sur le troc, appelé bons MEFO, et qui permettait de dissimuler une partie de l’endettement du pays, tout en capturant les fonds thésaurisés par les différents agents économiques. Ce qui a probablement séduit Keynes, étant l’idée que deux pays puissent conclure un accord bilatéral (en l’occurrence avec des marks « parallèles », les « Aski » – Ausländersonderkonten für Inlandszahlungen), permettant de négocier leur taux de change. Mais en fait, dès le mois de novembre 41, Keynes aura changé d’avis du tout au tout pour parler d’« une fiction faite de bric et de broc, fondée essentiellement sur l’expérience anormale d’un état de guerre » (Skidelsky 2000 : 216).
La lecture du livre vous dévoilera la raison de cette volte-face, mais au moins les choses sont-elles claires : Keynes n’était pas un dogmatique. Lorsqu’un problème se présentait à lui, il le mettait totalement à plat et l’examinait d’un œil neuf. Cela sans aucun a priori, hormis sa volonté de mettre l’économie au service du bien commun. Et il n’hésitait pas un seul instant – comportement incompréhensible pour les thuriféraires de la Religion Féroce – à changer d’avis, si les faits lui donnaient tort !
Et pourtant, malgré sa très riche expérience et son intelligence au service d’une sensibilité prônant une organisation sociale et économique, allant dans le sens d’une plus grande justice – ou du moins une réduction des inégalités – Keynes échoua à imposer sa vision à Bretton Woods. Les accords qui y furent signés en juillet 44, entérinèrent la nouvelle organisation monétaire mondiale voulue par les Américains. Une organisation où toutes les monnaies sont définies en dollar, et où le seul dollar est défini en or. Exit donc le bancor proposé par Keynes comme unité de compte aux échanges internationaux, et seul à même de « pacifier » les relations économiques, en évitant les déséquilibres trop importants entre les balances extérieures des nations.
On sait ce qu’il en advint, et toutes les étapes qui conduisirent à l’effondrement du système sont clairement déclinées.
Mais au-delà de l’échec d’un homme, qui avec le recul semblait inévitable –comment le représentant d’un pays ruiné par la guerre aurait-il pu s’imposer, face à une Amérique dont l’économie représentait alors la moitié de la production mondiale ? – la véritable découverte pour le lecteur provient de l’éclairage original donné par Paul Jorion, du combat que Keynes mena face au représentant des États-Unis, Harry Dexter White.
En suivant pas à pas une enquête digne d’un célèbre détective à la gabardine fripée, le lecteur apprendra comment la maladie diminua John Maynard Keynes, au moment où il avait le plus besoin de toutes ses facultés. Pire même, comment le traitement qu’il suivait fut susceptible de modifier sa personnalité et ses réactions !
Des contingences de la vie auxquelles nuls, même les plus grands esprits, n’échappent. Ainsi s’écrit l’Histoire…
Dépasser Keynes pour bâtir une économie au service du bien commun
Keynes aurait pu faire sienne la devise d’Érasme, « Nulli concedo » (je ne fais de concessions à personne). Non par orgueil, mais par la grâce de la merveilleuse alchimie résultant d’une éducation humaniste et d’une grande intelligence. Avec des résultats socialement détonants ! Les anecdotes abondent sur les petites phrases insolentes et sur les remarques cinglantes qu’il n’hésitait pas à décocher aux ‘puissants’, fussent-ils Premier Ministre. C’est ainsi que beaucoup de ses contemporains ne perçurent pas la véritable personnalité de Keynes. De lui ne voyaient-ils au mieux, que l’excentricité toute britannique d’un génie, ou au pire, que l’arrogance de ceux qui se sachant intellectuellement supérieurs, s’imaginent dispensés des marques élémentaires de la civilité.
Et pourtant avec le recul qu’autorise l’Histoire, c’est un tout autre visage qui apparaît. Celui d’un homme dont l’acuité intellectuelle perçait immédiatement à jour les lamentables artifices et les petits stratagèmes, ceux que les médiocres tentent de cacher sous le masque de la respectabilité et de la responsabilité. Comment ne pas imaginer que c’était là également le fruit d’une magnifique éducation, de celles qui vous permettent de vous élever en dépassant vos faiblesses humaines et votre propre finitude ? Le fruit d’un enseignement mettant en avant tout ce que rejette notre moderne stupidité, de tout ce qui a une inestimable valeur mais qui ne saurait avoir de prix : les arts et les lettres.
Mais cependant, le génie se double souvent de redoutables et surprenantes inaptitudes. Si Keynes aurait probablement percé facilement à jour un tricheur « à l’insu de son plein gré » comme M. Martin Winterkorn (ci-devant, ex-P-DG de VW), il était totalement désarmé face à la Terra incognita qu’était pour lui l’esprit féminin. Selon le bon mot de Paul Jorion, Keynes s’adressait aux femmes comme l’aurait fait un ambassadeur terrien avec des extra-terrestres. De la même manière selon ses proches, Keynes, le défenseur reconnu des arts et des lettres… ne comprenait pas grand-chose à l’art ! La clé de ce mystère ? Son amour des artistes. Keynes aima la peinture parce qu’il fut amoureux du peintre Duncan Grant, et il aima le ballet parce qu’il devint le mari de la ballerine Lydia Lopokova. L’amour de l’art a donc chez Keynes un seul nom : sa loyauté envers les gens qu’il aime (Jorion p. 287).
Et comment ne pas respecter un homme qui fait de l’amour et de la loyauté, ses valeurs cardinales ? Une pâte humaine, aussi pétrie d’imperfections que d’éclats de génie, et qui adoucit considérablement l’arrogance de classe dont fit souvent preuve ce Cambridge man né au 19ème siècle.
Mais nous, simples humains sans génie particulier, vivons au 21ème siècle. Un siècle qui pourrait fort bien être le dernier de la liste, tant les ravages causés par notre espèce à sa biosphère semblent irréversibles !
Alors, en quoi les travaux de Keynes peuvent-ils nous aider à survivre, puisque c’est en ces termes que se pose désormais la question ?
Eh bien nous dit en synthèse Paul Jorion, parce que l’œuvre ô combien imparfaite de Keynes, peut servir de fondation à une nouvelle économie politique. À une économie qui soit véritablement au service du bien commun, et non comme aujourd’hui, au service d’une poignée.
L’escroquerie de la « science économique » et sa nocivité, sont maintenant patentes pour tous. Les théories de Milton Friedman ou de Friedrich Hayek sont désormais reconnues pour ce qu’elles sont vraiment : une religion mortifère au service de sociopathes et d’un néo-féodalisme.
Alors restent Marx et Keynes, les deux grands penseurs ennemis (Keynes était né moins de 3 mois après la mort de Marx, et il détestait cordialement les idées marxistes et bien plus encore, l’Union Soviétique). Mais pourquoi ces deux-là, alors que le bestiaire de la gent économiste est des plus fourni ? Parce que nous dit Paul Jorion, ces deux-là ne s’adonnent pas à la fiction mathématique, à l’utopie d’une théorie économique en tant que description scientifique du réel. Ces deux-là font de l’économie politique, c’est-à-dire que tout dans leurs pensées, part et converge vers l’homme et ses besoins.
Ce qui n’empêche pas Paul Jorion d’intituler son dernier chapitre « ni Marx, ni Keynes ».
Ni Marx, parce que la profonde gangue dogmatique qui imprègne sa pensée, a donné les désastreux résultats que l’on sait. Parce qu’il confond sous le terme générique de capitalistes, les dispensateurs de capital, mais également les industriels et les marchands. Mais surtout comme le démontre l’auteur, parce que Marx exclut la formation des prix et la fixation du niveau des salaires du contexte de la « lutte des classes ». Ce sont ces deux exclusions du cadre des rapports de force, qui obligeront Marx à bâtir un édifice bancal à base d’arguments d’autorité (si la réalité me contredit aujourd’hui, demain elle me donnera raison…)
Ni Keynes, parce qu’il y a chez lui une absence totale de rapports de force entre les différents agents économiques ! Parce que prix et taux sont essentiellement décidés par les seuls vendeurs/prêteurs. Parce que ses fameux « mécanismes psychologiques » ne sont que des deus ex machina convoqués pour faire tenir un raisonnement ad hoc. Parce que la nouvelle richesse créée apparaît chez lui comme venue de nulle part.
Ni Marx, Ni Keynes, parce que le travail humain est le pivot du système conceptuel de l’un comme de l’autre. Or comme chacun le constate, le travail humain disparaît à grande vitesse, remplacé par les robots et les logiciels. Comment dès lors penser, si ce n’est le consensus social, du moins un monde où le dissensus est maintenu à son plus bas niveau ?
Voilà pourquoi nous sommes obligés de sortir du cadre pour penser un nouveau paradigme.
Voilà en quoi nous devons nous inspirer de John Maynard Keynes, pour qui le premier objectif de l’économie était la paix.
Voilà comment le livre de Paul Jorion, Penser tout haut l’économie avec Keynes, peut aider les hommes et les femmes de bonne volonté à penser leur avenir. Pour mieux le prendre en main.
La folie du rapport de force que notre espèce a engagé… avec la Nature
La lignée Homo a traversé à plusieurs reprises des goulets d’étranglement qui ont failli la faire disparaître. Le dernier événement catastrophique datant de 69.000 à 77.000 ans, quand le ‘super-volcan’ Toba sur l’île de Sumatra, explosa en causant un hiver nucléaire qui amena la population de nos ancêtres au bord de l’extinction.
Et nous voici de nouveau devant un tel goulet d’étranglement. À la différence près, qu’il ne s’agit pas cette fois-ci d’un accident exogène. De ceux où une nature aveugle décime des pans entiers de l’écosystème planétaire à l’aide de titanesques explosions volcaniques ou d’Himalayas célestes nous percutant à des vitesses de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde.
Non, cette fois-ci la catastrophe a un aspect beaucoup moins spectaculaire. Elle tient dans les quelques centaines de centimètres cubes de notre boîte crânienne. Dans cette évidence, que nous éprouvons les pires difficultés à brider nos instincts ou à nous projeter dans le futur. Dans le constat chaque jour renouvelé, que demain n’existe pas, et que seule compte la jouissance immédiate. Quel que soit le prix de son assouvissement !
Et justement, comme les lecteurs attentifs de Paul Jorion le savent bien, tout prix est le résultat d’un rapport de force. En l’occurrence celui que la folie de notre espèce a engagé… avec la Nature !
C’est en cela que la lecture de Penser l’économie tout haut avec Keynes peut constituer un point de départ à une réflexion commune. En découvrant comment la pensée keynésienne, sous des aspects souvent baroques, s’articule autour d’une simple mais nécessaire idée : celle d’une économie au service de la paix.
C’est à partir de cette utopie que nous devons penser tout le reste. De là découleront la prohibition des paris boursiers et des havres fiscaux, la neutralisation par la réappropriation populaire des banques systémiques et des transnationales. De là, nous pourrons penser le partage des richesses produites par la robotique et l’informatique. De ce changement de paradigme économique, découleront des représentations politiques qui ne seront plus celle de l’argent, mais celles de notre volonté commune de donner un avenir viable à nos enfants.
Nous sommes condamnés à l’utopie ou à la guerre.
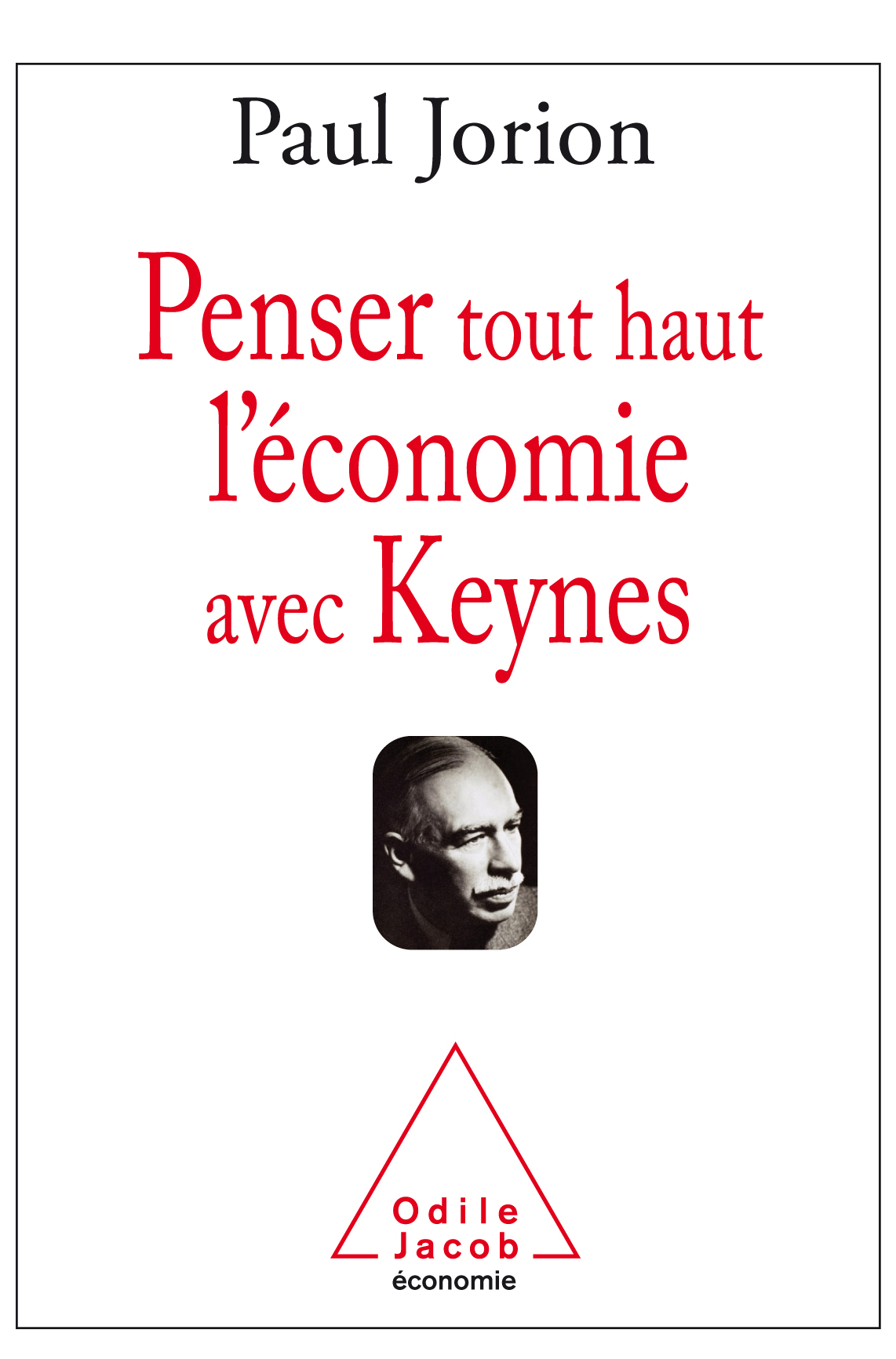
Cher Vincent, « L’origine humaine disparaîtra avec les données synthétiques » C’est bien ce qui m’inquiète (si cela devait arriver) car dans…