Billet invité.
Keynes aurait pu faire sienne la devise d’Érasme, « Nulli concedo » (je ne fais de concessions à personne). Non par orgueil, mais par la grâce de la merveilleuse alchimie résultant d’une éducation humaniste et d’une grande intelligence. Avec des résultats socialement détonants ! Les anecdotes abondent sur les petites phrases insolentes et sur les remarques cinglantes qu’il n’hésitait pas à décocher aux ‘puissants’, fussent-ils Premier Ministre. C’est ainsi que beaucoup de ses contemporains ne perçurent pas la véritable personnalité de Keynes. De lui ne voyaient-ils au mieux, que l’excentricité toute britannique d’un génie, ou au pire, que l’arrogance de ceux qui se sachant intellectuellement supérieurs, s’imaginent dispensés des marques élémentaires de la civilité.
Et pourtant avec le recul qu’autorise l’Histoire, c’est un tout autre visage qui apparaît. Celui d’un homme dont l’acuité intellectuelle perçait immédiatement à jour les lamentables artifices et les petits stratagèmes, ceux que les médiocres tentent de cacher sous le masque de la respectabilité et de la responsabilité. Comment ne pas imaginer que c’était là également le fruit d’une magnifique éducation, de celles qui vous permettent de vous élever en dépassant vos faiblesses humaines et votre propre finitude ? Le fruit d’un enseignement mettant en avant tout ce que rejette notre moderne stupidité, de tout ce qui a une inestimable valeur mais qui ne saurait avoir de prix : les arts et les lettres.
Mais cependant, le génie se double souvent de redoutables et surprenantes inaptitudes. Si Keynes aurait probablement percé facilement à jour un tricheur « à l’insu de son plein gré » comme M. Martin Winterkorn (ci-devant, ex-P-DG de VW), il était totalement désarmé face à la Terra incognita qu’était pour lui l’esprit féminin. Selon le bon mot de Paul Jorion, Keynes s’adressait aux femmes comme l’aurait fait un ambassadeur terrien avec des extra-terrestres. De la même manière selon ses proches, Keynes, le défenseur reconnu des arts et des lettres… ne comprenait pas grand-chose à l’art ! La clé de ce mystère ? Son amour des artistes. Keynes aima la peinture parce qu’il fut amoureux du peintre Duncan Grant, et il aima le ballet parce qu’il devint le mari de la ballerine Lydia Lopokova. L’amour de l’art a donc chez Keynes un seul nom : sa loyauté envers les gens qu’il aime (Jorion p. 287).
Et comment ne pas respecter un homme qui fait de l’amour et de la loyauté, ses valeurs cardinales ? Une pâte humaine, aussi pétrie d’imperfections que d’éclats de génie, et qui adoucit considérablement l’arrogance de classe dont fit souvent preuve ce Cambridge man né au 19ème siècle.
Mais nous, simples humains sans génie particulier, vivons au 21ème siècle. Un siècle qui pourrait fort bien être le dernier de la liste, tant les ravages causés par notre espèce à sa biosphère semblent irréversibles !
Alors, en quoi les travaux de Keynes peuvent-ils nous aider à survivre, puisque c’est en ces termes que se pose désormais la question ?
Eh bien nous dit en synthèse Paul Jorion, parce que l’œuvre ô combien imparfaite de Keynes, peut servir de fondation à une nouvelle économie politique. À une économie qui soit véritablement au service du bien commun, et non comme aujourd’hui, au service d’une poignée.
L’escroquerie de la « science économique » et sa nocivité, sont maintenant patentes pour tous. Les théories de Milton Friedman ou de Friedrich Hayek sont désormais reconnues pour ce qu’elles sont vraiment : une religion mortifère au service de sociopathes et d’un néo-féodalisme.
Alors restent Marx et Keynes, les deux grands penseurs ennemis (Keynes était né moins de 3 mois après la mort de Marx, et il détestait cordialement les idées marxistes et bien plus encore, l’Union Soviétique). Mais pourquoi ces deux-là, alors que le bestiaire de la gent économiste est des plus fourni ? Parce que nous dit Paul Jorion, ces deux-là ne s’adonnent pas à la fiction mathématique, à l’utopie d’une théorie économique en tant que description scientifique du réel. Ces deux-là font de l’économie politique, c’est-à-dire que tout dans leurs pensées, part et converge vers l’homme et ses besoins.
Ce qui n’empêche pas Paul Jorion d’intituler son dernier chapitre « ni Marx, ni Keynes ».
Ni Marx, parce que la profonde gangue dogmatique qui imprègne sa pensée, a donné les désastreux résultats que l’on sait. Parce qu’il confond sous le terme générique de capitalistes, les dispensateurs de capital, mais également les industriels et les marchands. Mais surtout comme le démontre l’auteur, parce que Marx exclut la formation des prix et la fixation du niveau des salaires du contexte de la « lutte des classes ». Ce sont ces deux exclusions du cadre des rapports de force, qui obligeront Marx à bâtir un édifice bancal à base d’arguments d’autorité (si la réalité me contredit aujourd’hui, demain elle me donnera raison…)
Ni Keynes, parce qu’il y a chez lui une absence totale de rapports de force entre les différents agents économiques ! Parce que prix et taux sont essentiellement décidés par les seuls vendeurs/prêteurs. Parce que ses fameux « mécanismes psychologiques » ne sont que des deus ex machina convoqués pour faire tenir un raisonnement ad hoc. Parce que la nouvelle richesse créée apparaît chez lui comme venue de nulle part.
Ni Marx, Ni Keynes, parce que le travail humain est le pivot du système conceptuel de l’un comme de l’autre. Or comme chacun le constate, le travail humain disparaît à grande vitesse, remplacé par les robots et les logiciels. Comment dès lors penser, si ce n’est le consensus social, du moins un monde où le dissensus est maintenu à son plus bas niveau ?
Voilà pourquoi nous sommes obligés de sortir du cadre pour penser un nouveau paradigme.
Voilà en quoi nous devons nous inspirer de John Maynard Keynes, pour qui le premier objectif de l’économie était la paix.
Voilà comment le livre de Paul Jorion, Penser tout haut l’économie avec Keynes, peut aider les hommes et les femmes de bonne volonté à penser leur avenir. Pour mieux le prendre en main.
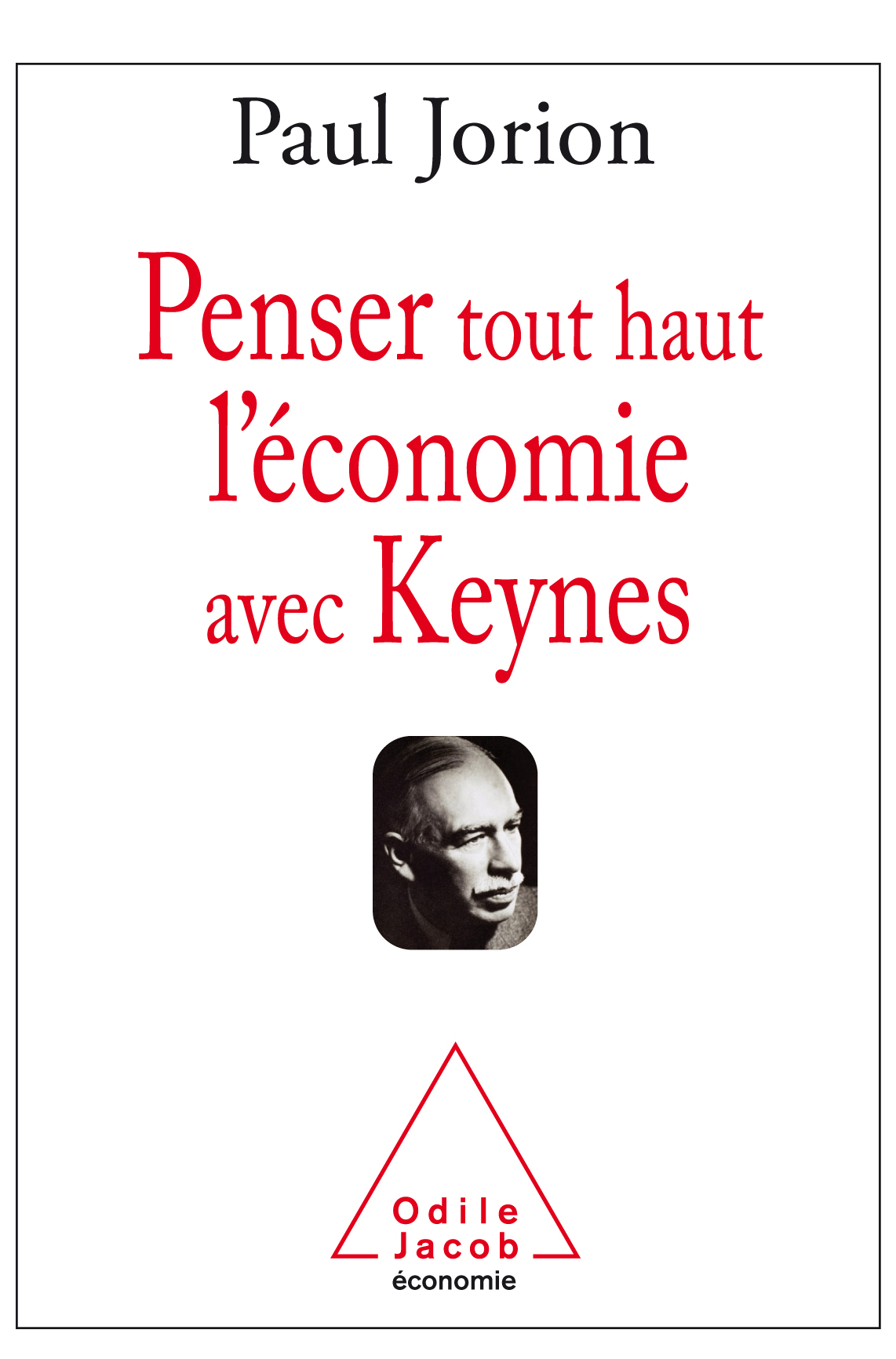
Un Einstein au carré n’a jamais été rien d’autre qu’un cerveau sans sénécence qui vivrait suffisamment longtemps pour acquérir toutes…