Billet invité.
« Ce n’est pas comme ça que ça se passe »
Ce tableau est faux. Les choses ne se passent pas comme ça.
Comment « l’argent » passe-t-il d’une banque à l’autre, en combien de temps ? On n’en sait rien.
Voici comment les choses se passent :
Ce qui apparaît, c’est qu’à chaque mouvement, le compte du client bénéficiaire du prêt est soldé, mais que la créance demeure, elle ! Donc plutôt que production de monnaie, il y a d’abord production de dettes. Une fois le prêt utilisé, c’est à dire viré dans une autre banque, sur un autre compte, la dette demeure. Et ça fait une sacrée dette au total, tandis que la somme prêtée est extrêmement modeste : au plus elle fait 90. Cette modeste somme n’est, évidemment, pas prêtée partout en même temps comme l’insinue frauduleusement ce stupide schéma, elle circule. Il court il court le furet. Si le dépôt d’origine est un vrai dépôt (par exemple le salaire d’un ajusteur-mécanicien P3 de la SNCF), le dépôt est effectivement prêté mais pas plus que pour 90 %, ce qui me paraît extrêmement raisonnable. Où est le scandale ? Il est dans la production de dettes. Et pourquoi tant de dettes ? Parce que les ajusteurs P3 ne gagnent pas assez pour vivre décemment. Que dire des autres ouvriers et employés ou même des comptables. Non seulement ils n’épargnent pas, mais ils doivent emprunter. J’entends parler ici ou là de politique keynésienne. Où est-elle cette politique ?
On note également que contrairement à l’idée reçue, la créance ne circule pas. Elle demeure et comment !
On voit aussi que c’est bien le dépôt qui permet le prêt et non l’inverse. Et le prêt ne produit pas des dépôts, mais des dettes. Quand même, s’il vous plaît. Un peu de sérieux.
Ce qui manque surtout dans le schéma faux, c’est l’évidence de la circulation (et non pas l’évidence de la création). Ce qui n’a rien d’étonnant. Or, puisque, à chaque mouvement le compte du client bénéficiaire du prêt est soldé, il n’y a pas du tout d’empilement vertigineux et créatif d’argent. Comment pourrions nous voir cela dans le tableau faux puisque l’avoir du client emprunteur ne paraît même pas. À quoi cela sert-il de présenter des bilans, qui sont des coupes synchroniques dans les comptes alors que l’on prétend examiner un mouvement à travers le temps, diachronique. N’auriez vous pas remarqué que dans le mot « Journal », il y a jour. À chaque jour, suffit sa peine. L’invention du Journal est ce qui donne son nom à la partie double et non pas le fait qu’il y ait contrepartie, débit et crédit, ce qui fut inventé un siècle plus tôt que le Journal. Quand je pense que l’on trouve ce schéma dans tous les manuels d’enseignement ! Heureusement, j’ai échappé à cela. Au contraire, dans mon schéma, on voit parfaitement qu’il n’y qu’un seul jeton qui circule et qui, de plus, va s’amenuisant. Ainsi, la somme prêtée est extrêmement modeste, un salaire d’ajusteur suffit. Il y a seulement empilement vertigineux de dettes. Ce qui est euphémiquement nommé, dans le schéma faux, « Crédit » est en fait de la reconnaissance de dette. Et cette reconnaissance de dette ne circule pas, contrairement à l’idée reçue, elle s’empile, sur place, dans chaque banque tandis que le jeton prêté ne fait que passer, comme dans le conte de La dame de Condé, mais à l’envers : plus le jeton passe, plus il laisse de dettes derrière lui. Et cette créance sur le client, c’est un actif, c’est une valeur. Voilà donc comment on crée de la valeur, avec un simple salaire d’ajusteur mécanicien ! Vous avez donc vu qu’il ne faut pas beaucoup d’argent pour créer beaucoup de « valeur ». Tout s’explique donc.
Les réserves, maintenant. Le soir du jour du mouvement, puisque le compte de l’emprunteur est soldé, la banque peut ajuster ses réserves et il lui revient un peu de trésorerie pour le lendemain. 10 pour banque A, 9 pour la banque B, 8 pour la banque C, etc. soit au total 55 quand nous arrivons à la banque J. Voilà autant de trésorerie qui va pouvoir repartir pour un tour et faire de nouvelles dettes, d’ordre 2, plus petites.
Conclusion : les crédits ne font pas les dépôts, ils font les dettes. Ça n’a rien de surprenant. Tout le monde sait ça. Donc les dépôts son bien une des trois ressources des banques, tandis que les dettes, elles, font… le bénef, il ne faut pas tout confondre.
Je pense avoir répondu à la question de Cyril at Jorion’s. Ce n’est pas l’argent qui manque, ça dépend pour qui, évidemment.
Mise à jour (10/2/10) :
Comme ce Journal-Bilan ci-dessous est peu orthodoxe, je dois donc expliquer comment le lire : première ligne à droite j’indique que le compte du client X (l’ajusteur mécanicien) est crédité par le débit du compte Compensation ; troisième ligne à gauche j’indique que le compte du client Y est débité par le crédit du compte Compensation. Si ça peut faciliter votre compréhension, vous pouvez remplacer Compensation par Trésorerie, comme je l’ai fait pour la banque C, qui ce jour là n’avait pas de candidat pour un prêt.
Ce qui apparaît, c’est qu’à chaque mouvement, le compte du client bénéficiaire du prêt est soldé, mais que la créance demeure, elle ! Donc plutôt que production de monnaie, il y a d’abord production de dettes. Une fois le prêt utilisé, c’est à dire viré dans une autre banque, sur un autre compte, la dette demeure. Et ça fait une sacrée dette au total, tandis que la somme prêtée est extrêmement modeste : au plus elle fait 90. Cette modeste somme n’est, évidemment, pas prêtée partout en même temps comme l’insinue frauduleusement ce stupide schéma, elle circule. Il court, il court le furet. Si le dépôt d’origine est un vrai dépôt (par exemple le salaire d’un ajusteur-mécanicien P3 de la SNCF), le dépôt est effectivement prêté mais pas plus que pour 90 %, ce qui me paraît extrêmement raisonnable. Où est le scandale ? Il est dans la production de dettes. Et pourquoi tant de dettes ? Parce que les ajusteurs P3 ne gagnent pas assez pour vivre décemment. Que dire des autres ouvriers et employés ou même des comptables. Non seulement ils n’épargnent pas, mais ils doivent emprunter. J’entends parler ici ou là de politique keynésienne. Où est-elle cette politique ?
On note également que contrairement à l’idée reçue, la créance ne circule pas. Elle demeure et comment !
On voit aussi que c’est bien le dépôt qui permet le prêt et non l’inverse. Et le prêt ne produit pas des dépôts, mais des dettes. Quand même, s’il vous plaît. Un peu de sérieux.
Ce qui manque surtout dans le schéma faux, c’est l’évidence de la circulation (et non pas l’évidence de la création). Ce qui n’a rien d’étonnant. Or, puisque, à chaque mouvement le compte du client bénéficiaire du prêt est soldé, il n’y a pas du tout d’empilement vertigineux et créatif d’argent. Comment pourrions nous voir cela dans le tableau faux puisque l’avoir du client emprunteur ne paraît même pas. À quoi cela sert-il de présenter des bilans, qui sont des coupes synchroniques dans les comptes alors que l’on prétend examiner un mouvement à travers le temps, diachronique. N’auriez vous pas remarqué que dans le mot « Journal », il y a jour. À chaque jour, suffit sa peine. L’invention du Journal est ce qui donne son nom à la partie double et non pas le fait qu’il y ait contrepartie, débit et crédit, ce qui fut inventé un siècle plus tôt que le Journal. Quand je pense que l’on trouve ce schéma dans tous les manuels d’enseignement ! Heureusement, j’ai échappé à cela. Au contraire, dans mon schéma, on voit parfaitement qu’il n’y qu’un seul jeton qui circule et qui, de plus, va s’amenuisant. Ainsi, la somme prêtée est extrêmement modeste, un salaire d’ajusteur suffit. Il y a seulement empilement vertigineux de dettes. Ce qui est euphémiquement nommé, dans le schéma faux, « Crédit » est en fait le redoutable mot de « Créance » ce mot terrible qui amène un beau jour l’huissier à votre porte muni d’une reconnaissance de dette signée de votre main. Et ça, ce n’est pas de l’argent. Et cette reconnaissance de dette ne circule pas, contrairement à l’idée reçue, elle s’empile, sur place, dans chaque banque tandis que le jeton prêté ne fait que passer, comme dans le conte de La dame de Condé, mais à l’envers : plus le jeton passe, plus il laisse de dettes derrière lui. Et cette créance sur le client, c’est un actif, c’est une valeur. Voilà donc comment on crée de la valeur, avec un simple salaire d’ajusteur mécanicien ! Vous avez donc vu qu’il ne faut pas beaucoup d’argent pour créer beaucoup de « valeur ». Tout s’explique donc.
Les réserves, maintenant. Le soir du jour du mouvement, puisque le compte de l’emprunteur est soldé, la banque peut ajuster ses réserves et il lui revient un peu de trésorerie pour le lendemain. 10 pour banque A, 9 pour la banque B, 8 pour la banque C, etc. soit au total 55 quand nous arrivons à la banque J. Voilà autant de trésorerie qui va pouvoir repartir pour un tour et faire de nouvelles dettes, d’ordre 2, plus petites.
Conclusion : les crédits ne font pas les dépôts, ils font les dettes. Ça n’a rien de surprenant. Tout le monde sait ça. Donc les dépôts sont bien une des trois ressources des banques, tandis que les dettes, elles, font… le bénef, il ne faut pas tout confondre.
Je pense avoir répondu à la question de Cyril at Jorion’s. Ce n’est pas l’argent qui manque, ça dépend pour qui, évidemment.
Encore un point. Creutz, en bas de la page qui précède celle où figure le mauvais schéma qu’il critique sévèrement, écrit ceci :
/169/ (…) La figure 31 ci-dessous reproduit le schéma d’un tel cycle, qui reprend l’exemple plus simple donné dans le livre de Bernhard Lietaer, « Das Geld der Zukunft » (L’argent de l’avenir)
(…)
2°) que l’enchaînement des octrois de crédits et des constitutions de réserves par les banques tel qu’il est décrit ne peut se faire qu’aussi longtemps qu’aucun des déposants ne dispose de son avoir en effectuant un retrait ou un virement ; /170/
Creutz est trop bon et commet de ce fait une petite erreur dont il n’est pas responsable, mais qu’il faut imputer au schéma que je qualifie de « stupide », c’est à dire sans doute écrit dans un état de stupeur. Cette erreur est d’affirmer que cet enchaînement « ne peut se faire aussi longtemps… ». C’est une petite erreur car c’est pire que cela. Cet enchaînement ne peut pas du tout se faire tant que le déposant ne dispose pas de son avoir, c’est à dire tant que son compte n’est pas soldé. Et cela n’apparaît pas du tout dans le bilan, et pour cause puisque le compte du déposant étant soldé, il ne peut plus apparaître au bilan, seul demeure le solde créditeur de l’ajusteur mécanicien. Donc le mauvais tableau n’est pas faux comptablement, mais méthodologiquement. C’est une erreur de méthode que de concevoir un tel tableau dans ce cas. Ce tableau n’est pas seulement stupide, il est vicieux puisqu’il induit en erreur un lecteur aussi averti et chevronné que Creutz.
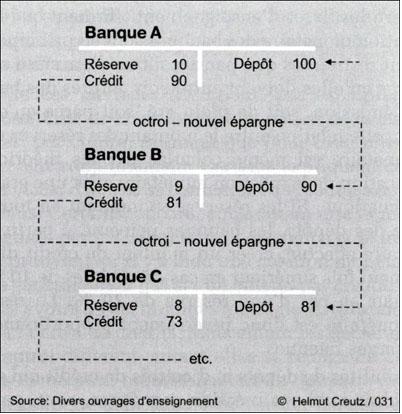
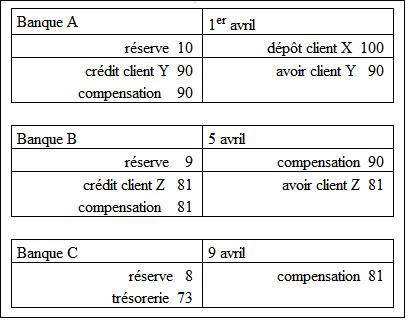
302 réponses à “« Ce n’est pas comme ça que ça se passe », par Jean-Pierre Voyer”
Merci pour cette clarification
Il faut savoir comment ca marche.
Mais comment faut-il faire pour que ca c e s s e ?? Puisque ca ne « marche pas ».
Vous me comprenez?
Merci de m’aider à entrevoir un système moins dysfonctionnel voire franchement efficace pour les g e n s .
CQFD
Il y a logtemps que l’erreur de Creutz a été « dénoncée » … ici par exemple:
http://ecce-home.wikispaces.com/message/view/Article+4/12472401
Alors, bien sur que non, ça ne se passe pas comme cela !
Mais merci Monsieur Voyer d’avoir démontré que Schumpeter s’est trompé http://monnaie.wikispaces.com/J.A.+Schumpeter
@toute neuve
« Là aussi, on peut supposer que chaque commerçant met dix pourcent de sa recette de côté et qu’il dépense le reste directement ou indirectement dans un autre magasin pour faire des achats. Là encore, l’addition des opérations d’achat donnerait le même résultat que celles des opérations de crédit dans le cas de la « surmultiplication de la création monétaire ». Et pourtant personne n’irait prétendre que la masse monétaire a été multipliée par neuf ou que les commerçants ont créé 900 millions [ex nihilo »
Je cite donc commerçant A 100, il garde 10 dépense 90, commerçant B il garde 9 dépense 81, commerçant c il dépense 73 garde 8. Ok il n’y a bien que 100 qui circulent.
Mais dans le cas d’une banque c’est différent, une banque (exemple avec 10% d’intérêts) avec 90 elle va avoir 9 d’intérêt, avec avec 81, 8.1, avec 73 7.3 ect… et si on reprend l’ensemble des intérêts 9+8.1+7.3=24.4
on voit bien qu’il faut considérer 244 et non pas 100.
J’ajoute que le raisonnement avec le commerçant qui garde 10 et dépense 90, puis l’autre commerçant qui dépense 81 et garde 9 puis l’autre encore dépense 73 et garde 8 , ne peut se comparer avec le schéma d’une banque.
Car les commerçants n’ont plus à chaque fois que 10, 9, et 8 à la fin de l’opération.
Ce qui n’est pas le cas d’une banque : la banque inscrit les 90 à l’actif et au passif, les 90 qu’elle a crée objet du prêt ne sont pas ceux du dépôt que le client peut lui dépenser. Il y a double écriture pour un même montant.
Si on reprends l’exemple du commerçant ça reviendrait à dire, que le billet de 90 qu’il vient de donner à l’autre commerçant il le reprends aussitôt pour aller faire la même chose chez le suivant, au premier il achète une télé, au second il achète un frigo et il a toujours ses 100, il ne fait en fait que les faire voir et tout le monde croit être payé.
Montrez-vous comment ça marche, ou bien comment ça ne marche pas ?
Désolé si la question vous semble bête…
Connaissez-vous la différence entre un jongleur et une banquier ?
Lorsque le jongleur loupe son coup c’est lui qui reçoit sa quille (sa balle,etc…) sur la tronche
Lorsque le banquier jongle, c’est nous qui le ramassons dans la gueule.
Connaissez-vous la différence entre un pilote d’air France et un banquier ?
Le pilote d’air France ne vole que quelques heures par semaine.
Je ne comprends pas tout, mais en ce moment puisqu’on ne prête plus, l’argent ne doit plus circuler ? (mis à part celui de la spéculation)
Elle circule moins. D’où la chute des indicateurs de la masse monétaire.
Pardon, ce que je dis n’a rien à voir directement avec le sujet,
mais à propos de la vidéo du 29 janvier 2010 sur Daylimotion,
quelqu’un pourrait-il faire une réponse au seul commentaire qui s’y trouve?
Je n’ai pas tout compris mais ça me ferait mal qu’il n’y ait pas de réponse faite.
Merci!
J’essaie de transmettre les vidéos.
Merci de l’explication.
J’aurais encore une question:
Si maintenant on boucle le processus (de C à A) par la tritrisation que se passe-t-il?
D’autre part selon le schéma la création de dette est disons, pour faire court, logarithmique. Est ce en adéquation avec la réalité?
Bonsoir
La BCE impose on taux de reserve oblgatoire de 2%, dans votre exemple sur le dépot client X de 100, la réserve devrait etre 2?, reprennez moi si c’est une confusion.
Ce qu’on voit surtout c’est que 100 engendre 244 de nouveaux moyen de paiement.
A propos d’où viennent les 100 parce que si l’ajusteur est payé par son employeur via sa ligne de découvert bancaire
(par exemple tout bête et tout simple ), c’est bien d’un crédit que provient le dépôt de l’ajusteur. Donc encore une fois le crédit fait le dépôt.
Pour moi, ça s’obscurcise un peu, mais, intuitivement, c’est bien ainsi que je le comprends: « … tandis que le jeton prêté ne fait que passer, comme dans le conte de La dame de Condé, mais à l’envers : plus le jeton passe, plus il laisse de dettes derrière lui. » Et c’est vrai, je pense, même des « jetons » qui servent à rembourser les dettes. Cependant, le système devrait s’auto-limiter puisque, pour toute banque, le montant total des crédits est limité par celui des dépôts. Faut-il expliquer la non limitation apparente par le fait que : « Et cette créance sur le client, c’est un actif, c’est une valeur. » , c’est-à-dire que cet actif autorise son propriétaire à prêter plus ? Si la réponse est oui, j’en resterais fort perplexe.
Et j’en rajoute une couche:
Maintenant, il reste à déterminer si l’apport initial du travailleur de la SNCF, provenait d’un travail créateur de richesse ou d’un travail non productif de richesse.(fonctionnaire de surcroit!!!!!!!!!)
Comment faire pour différencier la monnaie à « valeur bien matériel » de la monnaie sans « valeur matérielle »?
Quelle est la valeur d’une dette, assise sur une monnaie à valeur que l’on ne peut différencier d’une monnaie sans valeur.
Une dette sans valeur c’est quoi?
Monsieur Voyer, vous ne devriez considérer que les intérêts et vous posez la question :
est ce normal en définitive de rémunérer une banque parce qu’elle avance un pouvoir d’achat qu’elle ne possède pas plus que vous en réalité? Quelle est donc la légitimité de cet intermédiaire ?
Car effectivement si les banques ne prêtaient que 100 euros au lieu de 244 euros on pourrait la concevoir mais ce n’est pas le cas. C’est donc un système qui si je ne peux nier son intérêt évident pour tous favorise aussi tous les abus car il n’y aucune limite à la prise d’intérêts si les emprunteurs sont solvables et quand ils ne le sont pas c’est tous les autres qui trinquent comme actuellement et pas la banque au nom du principe que le système risquerait de s’écrouler et faire plus encore de dégats. Vous voulez à tout prix qu’une banque soit une entreprise comme les autres, pourtant elle possède des avantages que les autres n’ont pas.
à jeannot14
Je ne comprends pas bien votre allusion au fait que le fonctionnaire aurait un travail non productif de richesse…
Si vous faites ainsi allusion au point de vue du capitaliste, vous avez entièrement raison ! C’est ce que Marx démontre tout au long du Capital : pour le capitaliste il n’y a qu’un travailleur productif, celui qui lui rapporte de la survaleur (plus-value, comme on disait autrefois). Tous les autres ne viennent que réduire cette part de survaleur qu’il s’octroie : il faut donc de son point de vue réduire les coûts d’entretien et de renouvellement de la force de travail (réduire les salaires, réduire les enseignants, les médecins et autres suceurs -malheureusement inévitables- de survaleur, mais aussi les routes, les canaux… sans compter les agents de police et du fisc !).
Ainsi, si vous considérez qu’un enseignant ne produit rien par son activité parce que c’est un fonctionnaire, alors vous êtes un libéral complètement décomplexé ou qui s’ignore !
En revanche si vous considérez que les travailleurs même non productifs de survaleur sont quand même utiles, créatifs, voire indispensables… alors c’est que vous avez envie d’une autre société qui ne se limite pas à la comptabilisation de la survaleur exploitée sur le dos des dits travailleurs, qu’ils soient fonctionnaires ou non d’ailleurs.
JeanNimes, c’était tout simplement un clin d’oeil, de l’humour potache, allusion illusoire.C’était facile, je milite pour le maintien des services publics, d’une république avec des principes républicains et laïques. Principes n’étant valeurs, valeur réunissant des groupes et non pas l’ensemble des individus de notre République.
à liervol
je ne trouve absolument pas normal
et ça ne l’est pas dans l’absolue (même pour faire fonctionner l’économie on peut trouver mieux)
liervol dit :
8 février 2010 à 23:20
Tout à fait. Les banques ne peuvent être des entreprises comme les autres sous le régime actuel
J’enchaine ainsi, si les entreprises de maçonnerie qui construisent des maisons travaillaient comme les banques actuellement, l’entreprise de maçonnerie qui construit une maison pour un de ses clients demanderait en paiement à son client que ce client lui construise, disons, une maisonnette par an pendant vingt cinq ans. Voici, imagé, l’absurdité d’ailleurs voleuse des banques par les intérêts qu’elles demandent sur de l’argent qu’elles s’approprient et qu’elles louent très cher quand elles font des prêts. Nous ne réfléchissons jamais à ce que cela représente, mais nous gémissons du coût ahurissant de la vie…
Car le client qui demande un crédit est lui seul le porteur de garanties demandés par la banque pour l’argent qu’il demande. La banque, à ce stade, risque très peu. Car ce sont des garanties à lui, le client, puisqu’il met ses garanties dans la balance pour un argent qui n’a de la valeur – que – parce que – lui – apporte des garanties à la banque. Donc cet argent lui appartient de facto (et devrait lui appartenir de juré) et il n’a que la responsabilité juridique d’accomplir le remboursement. La banque n’a pas à s’approprier et louer (et à quel prix!) l’argent des crédits demandés. Un argent qui, premièrement, n’aurait aucune valeur s’il n’y avait pas les garanties du client qui emprunte, et, deuxièmement, l’argent des crédits octroyés n’a de valeur que parce qu’il y a des produits et des services fabriqués sur le marché qui donnent la valeur à l’argent – et non l’inverse -, argent dont on se sert pour acheter les produits et les services, sans lesquels l’argent ne servirait à rien, n’aurait pas de sens.
Rappel de base (autrement on s’embarque dans des explications absconses): ce sont les produits et services fabriqués par la société productrice dans son ensemble qui authentifie l’argent et donnant la possibilité de monétiser la production des biens et des services ce qui forme concrètement ce qu’on appelle un pouvoir d’achat. Ce pouvoir d’achat se rapporte à la possibilité de se procurer des produits et des services. Donc rappel très éclairant: parmis les produits et les services qu’on trouve sur le marché, il y a parmis tous les services vendus, ceux de la banque, les services comptables de la banque qu’on doit payer comme on paie une autre entreprise (par ex. l’entreprise de maçonnerie qui vous construit une maison, etc.) et rien de plus, surtout pas d’intérêts. L’argent prêté ne doit pas appartenir à la banque, mais à celui qui emprunte et qui endosse alors seulement la responsabilité de restituer cet argent qui sera détruit lors du remboursement du crédit; c’est ce qui se passe quand on paie comptant l’achat d’un produit ou d’un service, donc sans crédit. Les prix ne comporteront plus cette addition d’intérêts qui, aujourd’hui, provient de l’accumulation de tous les intérêts bancaires de toutes les entreprisesl ayant besoin de financement par les banques et qui doivent grever leur prix à cause des inérêts bancaires et des frais financiers, tous ces frais énormes se retrouvent, bien lovés, dans les prix que nous payons au quotidien, comme à terme.
@Crapaud Rouge
Non, le montant total des crédits – de l’ensemble des banques – n’est limité pas par celui des dépôts: il est limité par la demande des agents non bancaires et les besoins de monnaie centrale pour les établissements bancaires; ce qu’on appelle « fuites » (plus les règles de Bâle 2 qui limitent les crédits nouveaux en fonction des fonds propres)
Le montant total des crédits accordables pour une enseigne bancaire donnée (BNP, SG, BRED, etc) est ne fonction de sa part de marché (tous autres paramètres restant constants) : autre explication qi vaut ben celle de Schumpeter : celle d’Henry Tulkiens http://monnaie.wikispaces.com/Henry+Tulkens
@Tous
« L’erreur de Creutz », si vous lisez bien le lien que j’ai donné, c’est que ce ne sont pas les dépôts à vue qui sont prêtés… la banque crée littéralement de nouveaux crédits, monnaie scripturale (« reconnaissances de dette » si l’on veut… je ne suis pas bloquée sur l’utilisation de cette dénomination: on pourrait aussi parler de « pseudo monnaie »:)).
A partir d’une certitude d’obtenir 100 de la banque centrale ou d’un dépôt d’un client en monnaie centrale ( monnaie fiduciaire) dans une banque, l’ensemble du système bancaire peut créer X fois (de l’ordre de 6 à 7, suivant le taux de fuites de billets ou le taux de Réserve Obligatoire) ce montant en nouveaux crédits (nouvelle « monnaie » scripturale) sans toucher aux comptes bancaires (dépôts à vue) des client…
L’erreur qui a été attribuée aux « créationnistes » est flagrante sur ce point, en leur faisant dire que les banques prêtaient une partie des dépôts à vue de leurs clients, du fait qu’il apparait que le montant des crédits est un rapport du montant des dépôts à vue (mais on peut toujours faire dire ce que l’on veut aux rapports): les banques ne prêtent pas les dépôts à vue de leur clients sans le leur dire, cet « argent » ou une partie de cet argent n’est pas à deux endroits à la fois. Ceci apparait bien dans cet article http://tinyurl.com/yguopo4
« n’est limité pas par celui des dépôts » … lire évidemment » n’est pas limité par celui des dépôts » 🙂
Merci Mr Voyer de votre schéma qui permet une compréhension pour tous y compris pour moi-même.
Ce conflit sur la compréhension de la mécanique monétaire me gène quelque peu. Je me demande si on n’est pas en train de discuter du sexe des anges (©pj !…).
Que deviennent ces 2 tableaux si on regroupe en 2 familles cumulées :
Les banques d’un coté et les clients de l’autre ?
>>tableau 1:
Banques : réserves 27, credits 244
… mais si on mettait le stop au tableau 1 au même niveau que le tableau 2 on aurait :
Banques : réserves 27, credits 171, trésorerie 73
Clients : depots 271
>>tableau 2:
Banques : réserves 27, credits 171, trésorerie 73
Clients : depots 100, avoir 171
La différence s’estompe déjà quelque peu… La compensation influence chaque banque prise individuellement mais au niveau global, elle s’annule par définition.
L’écart se situe donc dans ce qui est appellé « avoir » au lieu de « dépot » et « trésorerie » au lieu de « crédit ».
Il me semble que pour les clients (les non-banques), les dépots (espèces) et avoirs(monnaie scripturale) sont sommés/mélangé/mixées dans leurs comptes à vue : et comme l’usage courant d’échange entre clients se fait de plus en plus hors espèces, cela ne change pas grand chose. Les avoirs sont bien utilisés comme moyens de paiement et à l’usage, ils ressemblent à s’y méprendre à une dépot…
Bref, l’écart entre les deux « concepts » se situe bien au niveau de la sémantique…
Cher monsieur, j’ai modifié mes tableaux après la lecture de votre réponse.
Notez qu’il ne s’agit pas de bilans mais de journaux très abrégés. J’ai allongé les libellés qui étaient trop succincts. J’ai ajouté également cet avertissement « Voici comment les choses se passent. Notez qu’à mon habitude, je reconstitue, à rebours, les écritures du journal qui ont conduit au bilan présenté dans le schéma faux. Il est question de généalogie, ici, et seulement de généalogie. N’y a-t-il qu’une monnaie de naissance noble, au château ; ou bien y a-t-il aussi une monnaie de naissance vile, dans les faubourgs ? Or vous ne pouvez traiter les questions d’origine dans un bilan où tout est compensé et consolidé, toutes trace du passé effacées, mais seulement dans le journal qui garde trace de toutes les opérations qui ont menée à cet état des choses »
JPV
Monsieur Voyer
Et pour l’ensemble des banques A,B,C,D, etc .. votre explication donne quoi, si vous consolidez les comptes ?
Que font les banques, créent elles ou non de la monnaie, je crois que ce qui diffère la banque des autres entreprises devraient nous amener à mieux appréhender la question.
– dans un restau, pour prendre de nouveaux clients et faire des recettes supplémentaires, il faut libérer la table en 1er lieu, la banque fonctionne en temps réel et elle n’a pas à libérer la table pour servir de nouveaux clients, elle dresse virtuellement une nouvelle table au dessus de la première pour créer son nouveau prêt…
– dans une entreprise de service, il faut libérer la personne pour lui permettre de s’occuper d’un nouveau client, dans l’industrie et même en cas de sous activité, il y aura besoin de matières 1ères ou de main d’oeuvre supplémentaire pour satisfaire un nouveau client ou produire une nouvel article.
Il me semble donc que la banque est une activité à part, son rôle est lui aussi particulier, il sert l’intérêt collectif…
En fait je pense que le problème des banques est vicié à la base, c’est une entreprise différente des autres, elle participe de l’intérêt général, CE QUI EXPLIQUE D’AILLEURS L’AIDE QU’ELLES ONT RECUES DES ETATS, ce faisant ce n’est pas tant ce qu’elles font en interne qui est dérangeant, c’est que d’une part, la totalité des bénéfices qu’elles font devrait revenir au collectif, ensuite qu’elles ne devraient pas avoir la possibilité de jouer pour elles en spéculant comme elles le font.
Je ne suis pas de gauche, de coeur ni d’esprit, ce me semble ce que font les USA en monétisant la dette est tout simplement l’application de cette règle, elles font le banquier, la valeur de la monnaie est celle que l’on veut bien lui donner, disons le la monnaie est aujourd’hui fictive, elle est une écriture quelque part avant tout et dépend de la puissance de celui qui écrit ou de celui qui dit avoir l’argent, en ce sens la non converibilité en or est une séquence logique, la monnaie est avant tout fictive…
Maintenant peut on laisser ce droit de jouer avec une monnaie fictive à une entreprise privée hors du champs de contrôle du collectif, c’est peut être cela la vraie question…
Ce n’est pas de nouvelles règles de contrôles qu’il faut parler, c’est du rôle des banques dans la société, le capital des banques devrait obligatoirement appartenir aux états car elles disposent de la création monétaire qui est du domaine du collectif et donc de l’état et non du privé, reste alors à trouver un mode de fonctionnement des banques en accord avec leur rôle collectif…
@ Bourdon
Je pense que vous tenez le point central de tout le probléme, la monnaie , à mon sens, est un bien public au même titre que l’eau, l’air, …….
Nationalisons les banques pour y faire le ménage, et regagner les intérêts ponctionnés par la finance.
@ enzobreizh,
vous concluez:
« Nationalisons les banques pour y faire le ménage, et regagner les intérêts ponctionnés par la finance. »
Et pensez vous donc, c’est bien connu que les fonctionnaires sont tous d’honnêtes gens, en plus ils sont très nombreux, alors la ponction sera faite pour payer leurs salaires. La morale est sauve !
Il n’y a qu’a voir les fonctionnaires de Bruxelles, avec leur lobbies avenue …
@ paul
je pars du principe que la banque nationalisé devienne une banque de credit et de dépot pas de spéculation, quand je parle de regagner les intérêts il s’agit de foutre en l’air cet intermédiaire entre la BCE et l’état qui greve notre dette.
Parce que vous croyez qu’une banque d’état ponctionne plus à l’économie (eu égard à ses fonctionnaires trop nombreux et couteux: salaud de fonctionnaire) qu’une banque privée, pourriez vous me l’expliquer s’il vous plait .
Schumpeter explique ainsi « l’expansion du crédit »
Ceci devrait clore le débat sans fin sur l’expansion du crédit (de monnaie scripturale = reconnaissances de dettes bancaires = « pseudo monnaie ») et bien sur non pas « argent » (dans le sens de monnaie fiduciaire = cash = espèces ) que seules les banques centrales émettent à la demande des agents non bancaires
« Ceci devrait clore le débat sans fin sur l’expansion du crédit » : sage précaution que de recourir au conditionnel. Bien malin qui mettra fin à ce débat…
Je viens de lire le texte de Schumpeter. Il décrit le mécanisme des réserves fractionnaires, tel que je le rapporte de mon côté dans « L’argent, mode d’emploi » aux pages 137 à 146. Il n’y a pas de création monétaire « ex nihilo », ni dans son explication, ni dans la mienne. En toute modestie, j’ajouterai que mon explication est aisément compréhensible et la sienne, passablement embrouillée. Ceci dit, il faut souligner que la démonstration de Schumpeter ne vise en aucune manière à prouver qu’il y aurait création monétaire « ex nihilo ». J’espère que ma réponse vous convient.
Les banques ne devraient-elles pas pouvoir prêter au plus que ce qu’elles ont comme actifs ?
Mais quid alors des règles de concurrence et de compétitivité sur le (les) secteur (s) national et internationale ?
C’est donc impossible à gérer dans le système tel qu’il est théoriquement décrit et mis en pratique aujourd’hui.
Vous me direz peut-être qu’aujourd’hui la compétitivité n’est pas réellement productive…
Ce blog est de moins en moins un simple blog et de plus en plus un véritable média citoyen.
Inutile de chercher un job d’universitaire monsieur Jorion : vous êtes déjà directeur de rédaction à plein temps.
Et pas directeur de n’importe quel canard : le directeur d’un des meilleurs média d’analyse et d’économie politique de la toile, une vraie référence.
Si je puis me permettre, je vous suggérerai d’apporter quelques améliorations de forme, en vous inspirant des expériences de Rue89, d’Agoravox ou de Mediapart, afin de mettre à profit la marque « Paul Jorion » et développer une plateforme de travail collaborative d’un niveau supérieur.
Vous avez fait le plus dur Monsieur Jorion : vous faire connaitre et reconnaitre. Dans le monde de l’information Internet, bien plus exigeant en réalité que le monde de l’information des media de masse, cela n’a pas de prix.
Il est donc peut-être temps de changer de catégorie et de passer à l’étape suivante.
Comme de nombreux participants à cette discussion (et ses précédents épisodes) ont manifestement la flemme de lire « L’argent, mode d’emploi » (Fayard 2009), je vous signale un article qui ne fait que neuf pages : It Is Now Mathematically Impossible To Pay Off The U.S. National Debt où l’auteur explique la circulation monétaire exactement de la même manière que moi dans mon livre. Nous sommes suffisamment peu nombreux pour que cela mérite d’être mentionné ! Par rapport à mon livre, ça a l’avantage d’être court et gratuit. Ça a l’inconvénient bien sûr d’être en anglais.
Les « updates » (mises à jour) à la fin corrigent certaines erreurs dans le texte initial, comme l’affirmation que la Federal Reserve serait une banque privée, etc. Mon amie Ellen Brown est longuement citée.
Bonjour Paul,
sur le titre de l’article, nous sommes évidemment d’accord, « créationnistes » comme anti-créationnistes. Les US, sous le système actuel, ne pourront jamais rembourser leurs dettes. C’est impossible pour la Grèce, Holbecq l’a montré pour la France. Peut être que nos explications divergent, mais nous disons tous que, sans révolution monétaire, les dettes ne seront jamais rembousées.
Sur le fait que cet artcile vous conforte dans votre thèse, les quelques lignes que j’ai lue me semblent aller plutôt dans le sens de ce qu’écrit M. Allais et ses « disciples ».
La seule différence entre les US et l’Europe, sur ce point, et elle est de taille, c’est que la Féderal Reserve est possédée par un consortium de banques privées, et que la BCE ne l’est pas.
Sinon M0, qui représente la monnaie centrale, c’est à dire les billets et pièces en circulation, plus la monnaie scripturale bancaire, a la même définition des deux côtés de l’atlantique.
M1, qui reprèsente la somme « espèces en circulation » plus « monnaie fiduciaire » a aussi la même définition.
C’est la Federal Reserve qui crée les espèces (currency) de même que c’est la Banque Centrale européenne qui crée les billets, les euros papier. Là dessus, tout le monde est d’accord.
Quant à M1, c’est justement là qu’est la question: est-ce une variable « endogène » au système, ou est-elle exogène, est-ce que ce sont les banques privées qui ont leur mot à dire, en octroyant ce nouveaux prêts, ou non.
Les banques privées ne créent pas l’argent, c’est sûr, mais est-ce qu’elles créent la monnaie?
Cordialement, B.L.
Que dit Ellen Brown que par exemple Schumpeter (et les « créationnistes » également) ne disent pas ?
http://www.webofdebt.com/excerpts/introduction.php
En fait un passage donne raison à Paul et l’autre, celui qui le suit peut être interprété comme pour donner raison aux créationnistes. Fort instructif:
When you go over to your local bank and deposit $100, they do not keep your $100 in the bank. Instead, they keep only a small fraction of your money there at the bank and they lend out the rest to someone else. Then, if that person deposits the money that was just borrowed at the same bank, that bank can loan out most of that money once again. In this way, the amount of « money » quickly gets multiplied. But in reality, only $100 actually exists. The system works because we do not all run down to the bank and demand all of our money at the same time.
According to the New York Federal Reserve Bank, fractional reserve banking can be explained this way….
« If the reserve requirement is 10%, for example, a bank that receives a $100 deposit may lend out $90 of that deposit. If the borrower then writes a check to someone who deposits the $90, the bank receiving that deposit can lend out $81. As the process continues, the banking system can expand the initial deposit of $100 into a maximum of $1,000 of money ($100+$90+81+$72.90+…=$1,000). »
So much of the « money » out there today is basically made up out of thin air.
In fact, most banks have no reserve requirements at all on savings deposits, CDs and certain kinds of money market accounts. Primarily, reserve requirements apply only to « transactions deposits » – essentially checking accounts.
The truth is that banks are freer today to dramatically « multiply » the amounts deposited with them than ever before. But all of this « multiplied » money is only on paper – it doesn’t actually exist.
Sur cet article,
Nous perdons beaucoup au fait que vous lisiez si peu sans que cela vous gêne pour exprimer une opinion : vous savez ce que dit cet article en n’en ayant lu que quelques lignes, de la même manière que vous rédigiez des pages entières d’objections à mon livre « L’argent, mode d’emploi » sans même l’avoir lu. Cette attitude cavalière vient renforcer le sentiment que d’autres que moi ont déjà exprimé ici : que vous êtes ici pour nous vendre quelque chose et que votre prétention d’engager un dialogue n’est rien de plus qu’un procédé rhétorique.
Mon démontage de l’argumentation fallacieuse de Schumpeter se trouve aux pages 150 à 153 de « L’argent, mode d’emploi » (Fayard 2009).
Je comprends mieux l’excellent livre de Paul Jorion que votre billet. Je relis son livre avec la lenteur nécessaire à une bonne incorporation. Pourrais-je dire que le livre « l’Argent, mode d’emploi » peut trouver un résumé de la pensée de Paul dans les pages 50 et 51 ? Sans me tromper ?
Petit rappel : http://www.nationspresse.info/?p=63489
Quant à parler de l’ignorance de la vitesse de la circulation monétaire chez Helmut Creutz, c’est vouloir être plus royaliste que le roi. Croyez-vous que Creutz, fidèle de la pensée de Silvio Gesell, ignore cela ?
Vous auriez pu signaler aux lecteurs de votre billet que vous avez extrait le graphique de Creutz à la page 170 de son livre « Le Syndrome de la monnaie », chapitre 12 : la « création monétaire » par les banques, question : comment fonctionne la « surmultiplication de la création monétaire » ?
Rendons à César …
Jean-Louis M. a eu raison d’insister.
Les questions de définition, ou de sémantique, dont nous nous plaignons parfois (sur la différence entre monnaie et argent) ont effectivement été abordées fort précisément par Paul, entre les pages 48 et 51 de « argent, mode d’emploi ».
Paul distingue trois concepts théoriques:
« argent » (les espèces), les « reconnaissances de dette » (peut être la monnaie scripturale) et « la fortune ressentie ».
Paul écrit, fort justement, qu’on utilise la monnaie sans toujours préciser ce qu’elle est, en la qualifiant de « notion pré-systématique ». Difficile d’être en désaccord sur ce point.
Le point central est alors le suivant: si l’argent, concept à la fois théorique et concret [les espèces, billets ou pièces, sont bien concrètes, tangibles] a les trois caractéristiques d’une monnaie – au sens des thèses économiques habituelles [moyen de paiement universel – du moins à l’intérieur d’une certaine communauté – unité de compte et réserve de valeur) la monnaie scripturale a aussi- EN GENERAL, quand tout va bien – ces mêmes trois caractéristiques: c’est donc bien une « monnaie », au sens économiste et pratique du terme.
En cas de panique bancaire, il peut se faire que la monnaie scripturale ne soit plus une « monnaie » parfaite, mais cela a aussi des répercussions sur l’argent au sens de Paul.
En fait, la grande question est donc de faire en sorte qu’il n’y ait pas trop de reconnaissances de dettes – et donc de dettes – émises, par rapport à l’état général de l’économie,et que, de plus, ces dettes soient émises aux bonnes personnes pour de bons motifs.
Chacun consent que la seule vraie richesse, c’est la capacité de production des hommes, capacité qui doit respecter les ressources limitées dont nous disposons, et qui doit être mise au service du bien commun, et en particulier des plus démunis. Une réforme, voire une révolution, monétaire est donc indispensable pour cela, nous le savons bien.
Deux questions donc: quelle révolution faut-il faire, et comment la provoquer, voire l’imposer.
C’est ce que nous propose Brieuc dans l’un de ses derniers commentaires, puisque, en dehors de l’interprétation de certains termes – ambigus comme Paul et d’autres l’ont écrit – il n’y a pas de réelles différences sur ce point entre Paul et les « créationnistes-destructionnistes », dès lors que l’on ne mélange pas « argent » et « autre chose ».
B.L.
J’aurais du employer le mot « schéma » plutôt que « graphique » !
Je peux résumer Monsieur Jorion, s’il vous plait ?
Notre système monétaire est fait de telle façon qu’il n’existe pas assez d’argent pour servir tout le monde tout simplement parce que nous sommes aujourd’hui et que les sommes en jeu reposent elles sur demain.
Voici un extrait du Crash Course de Chris Martenson que j’ai traduit en Français.
Je pense cela rejoint l’explication de Paul Jorion … du moins pour cet extrait-là, car Chris Martenson y parle de création (et destruction) monétaire et non de « multiplication » de crédit/dette.
Bourdon dit :
9 février 2010 à 12:11
a écrit:
« »Il me semble donc que la banque est une activité à part, son rôle est lui aussi particulier, il sert l’intérêt collectif…
(mon commentaire:
oui sur le papier, mais pourquoi – offrir – aux banques et à leurs actionnaires, et sur un plateau d’argent, c’est le cas de le dire, tout l’actif d’un pays ou d’un espace économique considéré? Au nom de quoi? Alors que l’on voit bien que la banque ne peut fonctionner et faire des bénéfices QUE grâce à tout les ACTIFS du ou des pays où elle exerce. D’où l’urgence de confier la création de la monnaie à une entité monétaire (publique ou privé importe peu car il y a avec cette dialectique privé-public, ici déplacée, trop de risque d’égarer le débat comme d’habitude) et les banques avoir une couverture à 100%-monnaier)
En fait je pense que le problème des banques est vicié à la base, c’est une entreprise différente des autres, elle participe de l’intérêt général, CE QUI EXPLIQUE D’AILLEURS L’AIDE QU’ELLES ONT RECUES DES ETATS, ce faisant ce n’est pas tant ce qu’elles font en interne qui est dérangeant, c’est que d’une part, la totalité des bénéfices qu’elles font devrait revenir au collectif, ensuite qu’elles ne devraient pas avoir la possibilité de jouer pour elles en spéculant comme elles le font. » »
enzobreizh dit :
9 février 2010 à 16:05
a écrit:
@ Bourdon
« »Je pense que vous tenez le point central de tout le probléme, la monnaie , à mon sens, est un bien public au même titre que l’eau, l’air, ……. » »
Absolument!!
La question de la nationalisation, ou non, de la banque est de peu d’importance à mon sens, ce qui compte est un fonctionnement avec un bon rendement et des objectifs constants.
Je laisse une fois de plus la parole à Louis Even:
– Les travailleurs du pays créent les richesses. Les banques font la comptabilité financière pour permettre aux citoyens d’échanger les richesses. Cette comptabilité financière, c’est l’argent.
Les Français (et les citoyens des autres pays) sont, de droit, propriétaires des richesses qu’ils créent. Mais les banques volent aux Français (et aux autres) leurs richesses. Les banques se constituent elles-mêmes propriétaires de l’argent qu’elles fabriquent. Les banques inscrivent à leur propre actif ce qui devrait être l’actif de la société, l’actif du pays. En même temps, elles inscrivent au passif du pays toutes les richesses du pays. Cette dernière opération se fait quand les banques prêtent du crédit basé sur les richesses et qu’elles inscrivent ce crédit au passif des emprunteurs, qui sont les particuliers, les entreprises et les gouvernements.
Les banques volent aux Français (et aux autres) l’actif du de la France (et des autres pays), en inscrivant cet actif à leur actif à elles et au passif du pays, dans leur comptabilité financière. Les banques volent le crédit de la société. Elles volent le crédit social.
Les banques sont des faussaires. Elles pratiquent une fausse comptabilité de l’argent. Elles volent l’actif national, l’inscrivent au passif de la nation. Cela constitue la dette nationale, et cela fait naître des taxes voleuses.
Les banques peuvent effectuer cette opération de vol, parce que tout l’argent qu’elles créent, elles le créent sous forme de prêts aux individus et aux gouvernements. Tout l’argent qui vient au monde dans le pays est créé par les banques et sous forme de dettes. C’est de l’argent-dette. Les banques devraient créer de l’argent libre de dettes, et le placer au crédit et non pas au débit de la nation.
La dette nationale est la plus grande supercherie et la plus grande escroquerie de l’histoire. La dette nationale, c’est le capital national volé par la banque. La dette nationale devrait être convertie en capital national, en capital social, en crédit social.
Et les intérêts sur la dette devraient être convertis en dividendes sociaux. De cette façon, les taxes disparaîtraient. Et les dividendes les remplaceraient. Les taxes qui sont imposées, quand on pourrait avoir un dividende. –
Voilà, une grande idée.
Monsieur Voyer,
Vous enfoncez des portes ouvertes. Cela fait plus d’un an que des « créationnistes » essayent de vous dire que les banques ne créent pas de l’argent (nous sommes TOUS d’accord là-dessus), mais de la MONNAIE. Cette monnaie est éffectivement une dette, une dette qui passe de compte en compte, et est utilisées comme moyen de paiement.
Franchement, j’en arrive à ne plus voir ce qui oppose « créationnistes » et « jorio-creutziens », à part des différences de sémantique, et le refus des « jorio-creutziens » de voir que les piles de dettes, garanties par une petite fraction de la « valeur » de ces dettes, titrisées et mises en pension à la BC, que cette pile de dette EST notre monnaie moderne! La pyramide de dettes que nous utilisons comme monnaie repose sur le pointe de la quantité d’argent qui est détenue par les banques comerciales auprès de la banque centrale. D’où les risques systémiques de bank run (tout le monde veut de l’argent à la place des dettes qu’il « possède » sur son compte en banque) et de credit crunch (les remboursements de dettes dépassent les créations de nouvelles dettes : le différentiel est une disparition nette de monnaie).
Je ne perçois pas comment le monde « tout est argent » de MM. Jorion et Creutz peut expliquer ces deux risques systémiques, ni d’ailleurs les envolées des masses monétaires avec le temps.
Mais peut-être est-il temps, en effet, de passer à la suite : qu’est-ce qui peut être proposé de concret et de fonctionnel pour l’avenir? Le crédit social, de Douglas? La monaie fondante de Gessel? Le crédit mutuel des SEL?
cher Paul
je pense que vous avez mal interprété ce que je dis.
a) j’ai lu et relu votre livre – du moins les 100 pages centrales que vous m’avez indiquées
b) je dis que l’article que vous citez, qui est excellent, peut être interprété de deux façons, et que c’est tout à fait instructif.
Une interprétation de ce papier vous donne raison, une autre, en particulier du passage où il est dit que la monnaie scripturale peut grossir énormément (The truth is that banks are freer today to dramatically « multiply » the amounts deposited with them than ever before.) est ce que les créationnistes soutiennent.
Puis, à nouveau une phrase que vous ne renierez pas: » But all of this « multiplied » money is only on paper – it doesn’t actually exist. » C’est effectivement « sur le papier ». Les billets, les espèces correspondantes n’existent pas, nous en sommes d’accord.
MAis LA question est: si cette monnaie scripturale n’avait aucun sens, pourquoi se préoccuper des dettes correspondantes.
En ce qui concerne votre jugement à mon égard, je le regrette.
Je ne cherche ni à vous attaquer, ni à vous ennuyer. Je dis que, au delà d’un problème d’interprétation sur le véritable impact de cette monnaie scripturale, qui se comporte « comme de l’argent » sans en être, il y a toute la question d’une véritable réforme du système monétaire.
Je n’ai rien à vendre, ni à gagner, et je vois donc pas pourquoi je m’engagerais dans une discussion rhétorique avec quelqu’un comme vous, qui a l’immense mérite de vouloir faire bouger les choses dans un pays où les « élites » ne semblent rien vouloir entendre.
Je pense que nous avons le même objectif, étant à peu près de la même génération: faire en sorte que le monde ne continue pas à courir droit à la catastrophe, et que nos enfants et nos petits enfants ne puissent pas se demander un jour pourquoi nous n’avons rien fait.
Si vos remarques sur les dettes et les créances en face sont évidemment justes, je ne comprends pas pourquoi vous accablez Helmut Creutz qui ne dit que ça! le schéma que vous reproduisez est pris hors contexte, le contexte disant justement ce que vous dites!
Le créances et les dettes sont des grandeurs parfaitement égales et symétriques, leur somme est toujoures nulle!
Quant au « jeton », à savoir la masse monétaire circulante, il est évident que ce jeton opère à chaque dépôt sur un compte une nouvelle créance et génère autant de « dette » de la part de la banque auprès du déposant. La banque prêtera évidemment à son tour, ce qui implique que le déposant prête, via la banque, à un tiers emprunteur, c’est tout.
Non, le contexte et le schéma de Creutz disent que les banques prêtent une partie des dépôts à vue pour créer de nouveaux crédit tout en disant au déposant que son dépôt est toujours intact. C’est évidemment faux.
Les banques créent à chaque moment de nouveaux crédits sans toucher aux dépôts à vue (votre « compte courant »): La « même monnaie » (scripturale.. ou « pseudo monnaie si vous voulez) n’est pas comptabilisée 2 fois… relisez l’extrait de Schumpeter posté ci dessus (P.J. n’a évidemment rien démonté puisqu’il n’avait pas lu » Théorie de la monnaie et de la Banque » mais seulement « l’histoire de l’analyse économique » dans lequel Schumpeter ne rentre pas dans ces détail de l’expansion du crédit )
Par contre les banques peuvent prêter l’épargne déposée dans ce but, les dépôts à terme.
Bon, j’avais dit que je n’intervenais plus … 🙁
Ce débat devient fatigant. Ce qui compte c’est que l’argent réel est pompé. Il est attiré comme par un aimant vers ceux qui en ont déjà trop, à commencer par ceux qui le créent. Et je ne parle pas que de l’argent qui existe aujourd’hui, l’argent qui existera est aussi pompé en avance pour des décennies (la dette de l’Etat c’est ça).
Que les reconnaissances de dettes servent de monnaie mais ne soient pas du vrai argent, qu’est-ce que cela change? Reconnaissances de dettes ou argent, tout cela est créé par le système bancaire (que les banques soient privées ou centrales) et non pas par l’Etat. Autrement dit, lorsque les Etats sont devenus démocratiques, on leur a confisqué le pouvoir de créer la monnaie. Et ce point est important: lorsque les Etats sont devenus démocratiques, pas avant. On a laissé au peuple l’Etat, mais on (la classe possédante) a vite retiré à la sauvette à ce dernier le vrai pouvoir.
Et le peuple n’a toujours pas compris l’arnaque.
bon résumé
Mais qui a dit le contraire d’Ellen dans « Web of Debt » dont voici la présentation traduite par Google.. ????
Je suis extrêmement étonné par les réponses à mon billet. Sans doute m’exprimé-je trop peu clairement, donc j’ai réécrit tout le texte figurant sous les tableaux et je le présente ici comme une réponse générale.
_________________________________________________________________
Comme ce Journal-Bilan ci-dessous est peu orthodoxe, je dois donc expliquer comment le lire : première ligne à droite j’indique que le compte du client X (l’ajusteur mécanicien) est crédité par le débit du compte Compensation ; troisième ligne à gauche j’indique que le compte du client Y est débité par le crédit du compte Compensation. Si ça peut faciliter votre compréhension, vous pouvez remplacer Compensation par Trésorerie, comme je l’ai fait pour la banque C, qui ce jour là n’avait pas de candidat pour un prêt.
Ce qui apparaît, c’est qu’à chaque mouvement, le compte du client bénéficiaire du prêt est soldé, mais que la créance demeure, elle ! Donc plutôt que production de monnaie, il y a d’abord production de dettes. Une fois le prêt utilisé, c’est à dire viré dans une autre banque, sur un autre compte, la dette demeure. Et ça fait une sacrée dette au total, tandis que la somme prêtée est extrêmement modeste : au plus elle fait 90. Cette modeste somme n’est, évidemment, pas prêtée partout en même temps comme l’insinue frauduleusement ce stupide schéma, elle circule. Il court, il court le furet. Si le dépôt d’origine est un vrai dépôt (par exemple le salaire d’un ajusteur-mécanicien P3 de la SNCF), le dépôt est effectivement prêté mais pas plus que pour 90 %, ce qui me paraît extrêmement raisonnable. Où est le scandale ? Il est dans la production de dettes. Et pourquoi tant de dettes ? Parce que les ajusteurs P3 ne gagnent pas assez pour vivre décemment. Que dire des autres ouvriers et employés ou même des comptables. Non seulement ils n’épargnent pas, mais ils doivent emprunter. J’entends parler ici ou là de politique keynésienne. Où est-elle cette politique ?
On note également que contrairement à l’idée reçue, la créance ne circule pas. Elle demeure et comment !
On voit aussi que c’est bien le dépôt qui permet le prêt et non l’inverse. Et le prêt ne produit pas des dépôts, mais des dettes. Quand même, s’il vous plaît. Un peu de sérieux.
Ce qui manque surtout dans le schéma faux, c’est l’évidence de la circulation (et non pas l’évidence de la création). Ce qui n’a rien d’étonnant. Or, puisque, à chaque mouvement le compte du client bénéficiaire du prêt est soldé, il n’y a pas du tout d’empilement vertigineux et créatif d’argent. Comment pourrions nous voir cela dans le tableau faux puisque l’avoir du client emprunteur ne paraît même pas. À quoi cela sert-il de présenter des bilans, qui sont des coupes synchroniques dans les comptes alors que l’on prétend examiner un mouvement à travers le temps, diachronique. N’auriez vous pas remarqué que dans le mot « Journal », il y a jour. À chaque jour, suffit sa peine. L’invention du Journal est ce qui donne son nom à la partie double et non pas le fait qu’il y ait contrepartie, débit et crédit, ce qui fut inventé un siècle plus tôt que le Journal. Quand je pense que l’on trouve ce schéma dans tous les manuels d’enseignement ! Heureusement, j’ai échappé à cela. Au contraire, dans mon schéma, on voit parfaitement qu’il n’y qu’un seul jeton qui circule et qui, de plus, va s’amenuisant. Ainsi, la somme prêtée est extrêmement modeste, un salaire d’ajusteur suffit. Il y a seulement empilement vertigineux de dettes. Ce qui est euphémiquement nommé, dans le schéma faux, « Crédit » est en fait le redoutable mot de « Créance » ce mot terrible qui amène un beau jour l’huissier à votre porte muni d’une reconnaissance de dette signée de votre main. Et ça, ce n’est pas de l’argent. Et cette reconnaissance de dette ne circule pas, contrairement à l’idée reçue, elle s’empile, sur place, dans chaque banque tandis que le jeton prêté ne fait que passer, comme dans le conte de La dame de Condé, mais à l’envers : plus le jeton passe, plus il laisse de dettes derrière lui. Et cette créance sur le client, c’est un actif, c’est une valeur. Voilà donc comment on crée de la valeur, avec un simple salaire d’ajusteur mécanicien ! Vous avez donc vu qu’il ne faut pas beaucoup d’argent pour créer beaucoup de « valeur ». Tout s’explique donc.
Les réserves, maintenant. Le soir du jour du mouvement, puisque le compte de l’emprunteur est soldé, la banque peut ajuster ses réserves et il lui revient un peu de trésorerie pour le lendemain. 10 pour banque A, 9 pour la banque B, 8 pour la banque C, etc. soit au total 55 quand nous arrivons à la banque J. Voilà autant de trésorerie qui va pouvoir repartir pour un tour et faire de nouvelles dettes, d’ordre 2, plus petites.
Conclusion : les crédits ne font pas les dépôts, ils font les dettes. Ça n’a rien de surprenant. Tout le monde sait ça. Donc les dépôts sont bien une des trois ressources des banques, tandis que les dettes, elles, font… le bénef, il ne faut pas tout confondre.
Je pense avoir répondu à la question de Cyril at Jorion’s. Ce n’est pas l’argent qui manque, ça dépend pour qui, évidemment.
Encore un point. Creutz, en bas de la page qui précède celle où figure le mauvais schéma qu’il critique sévèrement, écrit ceci :
Creutz est trop bon et commet de ce fait une petite erreur dont il n’est pas responsable, mais qu’il faut imputer au schéma que je qualifie de « stupide », c’est à dire sans doute écrit dans un état de stupeur. Cette erreur est d’affirmer que cet enchaînement « ne peut se faire aussi longtemps… ». C’est une petite erreur car c’est pire que cela. Cet enchaînement ne peut pas du tout se faire tant que le déposant ne dispose pas de son avoir, c’est à dire tant que son compte n’est pas soldé. Et cela n’apparaît pas du tout dans le bilan, et pour cause puisque le compte du déposant étant soldé, il ne peut plus apparaître au bilan, seul demeure le solde créditeur de l’ajusteur mécanicien. Donc le mauvais tableau n’est pas faux comptablement, mais méthodologiquement. C’est une erreur de méthode que de concevoir un tel tableau dans ce cas. Ce tableau n’est pas seulement stupide, il est vicieux puisqu’il induit en erreur un lecteur aussi averti et chevronné que Creutz.
Conclusion : La banque A reçoit de la trésorerie par l’intermédiaire de son client X, ajusteur mécanicien, elle décide d’« employer » aussitôt cette trésorerie parce que justement elle en a l’occasion avec le client Y qui est très demandeur, où est le problème ? Elle reçoit 100, elle prête 90. Où cela mérite-t-il création de monnaie ? Si toutes ces opérations se font avant la compensation, dans la journée, la banque A sera, sur cette transaction, en position créditrice de 100 et en position débitrice de 90. Le prêt est donc financé. Où est le problème ? Notez encore que si son client Y est si pressé de faire un emprunt, c’est qu’il en a besoin peut-être pour aller éteindre une autre dette, ailleurs. Où est le problème ? À titre d’exemple et pour changer un peu, j’ai supposé que la banque C n’avait pas, elle, d’emploi pour sa nouvelle trésorerie.
Voici donc maintenant le problème de la banque A : le client X, qui est un ouvrier, est endetté jusqu’au cou. Il faut payer la maison, la ou les voitures, la tondeuse à gazon etc… Voilà donc pourquoi il était si pressé et a remis lui-même son chèque au guichet de la banque, car il savait très bien que le 4 ou le 5 du mois, les money grabbers seraient là et prélèveraient automatiquement sur son compte. Quelle est la situation de la banque A ? Elle est parfaitement débarrassée du client emprunteur Y puisque le prêt était financé. Mais c’est avec le client X qu’elle a un problème le 5 avril, puisque la trésorerie de la banque n’est plus capable d’honorer son engagement envers X. Que va-t-elle faire ? Comme d’habitude, elle va emprunter, sauf, évidemment si sa position en compensation est très créditrice. Où voyez vous de la création de monnaie ?
A brieuc Le Fèvre, ( 9 février 21:52 )
Oui, il serait grand temps ! D’autant que la proposition à terme inéluctable vient d’être rappelée par « Toute Neuve » ce 9 février 20:34, à savoir la proposition formulée par Ellen Brown pour les US mais valable pour n’importe quel peuple :
Qui n’est pas d’accord ? ( je vous laisserai en débattre entre vous si un désaccord se manifeste).
S’il y a accord, Paul J., vous seriez certainement un des mieux placés pour proposer les mesures concrètes capables de réaliser ce changement, qui irait je crois bien au delà de l’interdiction des paris sur l’évolution des prix.
Cordialement.
Jean Jégu.
Certains d’entre nous ici s’inquiétaient de votre absence prolongée.
Nous voilà rassurés. 🙂
Avez-vous lu le billet de Paul : « les mesures que je préconise » ?
En plus de l’interdiction des paris sur la fluctuation des prix y figure en effet ceci :
Les banques ne sont pas d’accord 😉
L’argument des banques contre toute « restriction », c’est que :
– ça freinerait la croissance puisqu’elles ne peuvent plus prêter autant (Arf, mais d’une part elle ne prêtent pas, d’autre part on doit sortir de la spirale de surendettement à tous niveaux : privé, entreprises, états)
– ça leur couterait plus cher et qu’elles devront donc répercuter le surcoût sur les clients, déposants et/ou emprunteur (comme si elles ne vampirisaient dejà pas assez l’économie « réelle »)
– elles ne pourront plus « fournir la liquidité » aux marchés (la bonne blague, on en veut pas de leur liquidité qui alimente la spéculation)
En fait, si on oblige les banques à mettre 100% des DAV en réserve, ça les transforme en simple « coffre fort », elles ne peuvent plus rien prêter, sauf à explicitement emprunter à (long) terme.
Voir aussi les propositions de Maurice Allais qui préconise entre autres de séparer banques de dépot (interdiction de prêter et de découvert), banques de prêt (obligation d’emprunter au même terme/échéance que les prêts accordés ou plus long terme) et banques d’affaires (investissement uniquement, interdiction de spéculer…).
Evidemment, tout ça sent le sapin pour les banques.
J-P Voyer
L’orgueil précède souvent la chute.
Vous raisonnez en flux comptable brut alors que la réalité du système monétaire fonctionne en flux net.
PROUT
SNIF – BEURK 😉
Banque de France – Système de paiement de masse
Banque de France – Les moyens de paiement scripturaux
Banque Nationale de Belgique – CEC
Compensation – Wikipédia
Comme certains ont l’air et l’art d’ignorer la réalité des transferts interbancaires, des chambres de compensation, du netting, j’ai même fait un schéma qui peut se lire comme un journal des opérations (j’espère ne pas avoir fait d’erreur).
Les créances de A sur B et les créances de B sur A s’annulent dans la chambre de compensation. Merveilleux. Quelle surprise ! Je n’y aurais jamais pensé. Donc aucun paiement n’est nécessaire (sauf les flux nets quand les créances ne sont pas égales). Donc il n’est nullement besoin de paiement. Donc il n’y a pas besoin de monnaie. Donc il n’y a pas création de monnaie… à moins que vous affirmiez que les créances sont la monnaie (l’esclavage c’est la liberté, le travail rend libre, la guerre est la paix etc).
Dernière précision : dans les chambres de compensation des marchés, ce sont les chambres de compensation qui assurent la bonne fin tandis qu’ici, c’est la Banque de France.
Donc seule existe la monnaie centrale, qu’elle soit scripturale ou fiduciaire. Excellente démonstration. Merci.
JPV
@J-P Voyer
Je vous invite à bien lire les références que je donne. Vous semblez confondre transaction (échange des ordres de paiement) et règlement (des soldes nets) qui sont deux opérations distinctes et différées comme précisé par la BdF et la BNB.
Mon schéma contient peut-être des erreurs, mais pas pour ce qui est des soldes nets à régler (compensation multilatérale). Le fait irréfutable est que les 3 banques ont accordé 1800 de nouveaux crédits qui ont été dépensés et échangés contre des marchandises bien réelles et que seul 100 doit être réglé entre les banques X et Z. Le cas de la banque Y est « remarquable » car il n’y a aucun règlement (solde net 0), alors même qu’elle a accordé 600 de nouveaux crédits. Les banques échangent les ordres de paiement et connaissent les montants, donneurs d’ordre, bénéficiaires… mais un ordre de paiement n’est pas toujours réglé immédiatement?
Je me suis peut-être trompé pour le règlement de 100 entre X et Z (réserves et prêt interbancaire). Je ne suis pas plus banquier central que vous, j’essaie juste de comprendre comme ça marche réellement, sans tomber dans des travers simplificateurs qui séparent les opérations individuelles et par ce fait nient la réalité des chambres de compensation.
Non monsieur, je ne confonds pas ce que vous dites. Lisez plutôt d’abord les trois billets que j’ai publiés sur ce blog, nous en reparlerons après.
@fujisan: votre schéma est faux dès le départ.
Prenons la banque Y. Deux cas de figure:
– Les clients viennent-ils de déposer 600 (au total)? Si oui, le passif est correct, mais l’actif est incorrect (ces clients ne doivent rien à la banque).
– Les clients viennent-ils de se voir accorder un crédit de 100 chacun (600 au total)? Si oui, l’actif est correct, mais c’est le passif qui incorrect (la banque ne doit rien à ces clients, leur DAV est à 0).
– Le troisième cas est absurde et rigolo. C’est celui où les clients viennent de déposer 100 chacun et font en même temps un emprunt de 100 chacun. C’est ce cas-là que votre schéma représente comptablement.
J’oubliais de préciser que dans le premier cas, le livre est équilibré car il y aurait 600 de trésorerie au passif. Dans le deuxième cas, la banque ne pourra faire le crédit de 600 (ai total) que si elle fait un emprunt de 600 (ou trouve des déposants) qui se retrouvera à l’actif.
Je n’ai pas lu votre schéma, pourquoi devrais-je le faire puisque je sais très bien, comme tout le monde, que le but de la compensation est de réduire au minimum les mouvements de fonds.
Pourquoi donc devrais-je le lire ? Vous remarquerez que vous oubliez simplement de dire où je commettrais l’erreur que vous me reprochez. Je suis, de ce fait dans l’impossibilité de vous opposer le moindre argument. Pour cela il faudrait que je sache où j’ai commis une erreur. Ce que j’attends et que j’ai mentionné à plusieurs reprises ici, c’est que l’on me montre mes erreurs. Vous faites exactement comme le bénéficiaire du PROUT. Vous vous contentez d’accuser gratuitement. Le PROUT n’est pas occasionné par cette légèreté qui consiste à faire des procès d’intentions plutôt que des critiques, mais à le faire, de plus, de manière désobligeante (comme vous d’ailleurs, qui sont ces « certains » qui sifflent sur nos têtes. Vous méprisez tellement les gens qu’il vous répugne de les nommer ?)
Comment pourrais-je ignorer que les transactions et les règlements sont séparés puisque M. Jean Bayard me l’a déjà fait remarquer il y a plus de quinze jours.
JPV
@Moi
Est-ce que cela invalide son argumentaire (flux brut/flux net) car au final c’est ce qui compte?
@J-P Voyer
Votre schéma n’est pas faux, il est simplificateur, car il ne considère que trois simples dépôts et crédits isolés et espacés, comme si les banques ne faisient qu’une seule et unique opération par jour.
Mais voilà la réalité des opérations pour la petite Belgique avec +- 10,5 millions d’habitants (Source : rapport annuel du Centre d’Echange et de Compensation)
4,2 millions d’opérations par jour en Belgique.
Je répète : 4,2 millions d’opérations par jour en Belgique.
Et non 3 opérations isolées et espacées dans le temps.
Certes, une partie seulement sont des opérations liées à de nouveaux crédits/dettes, mais il y a des centaines voire miliers de nouveaux crédits accordés tous les jours. C’est ce que mon schéma tente de montrer (avec peut-être des erreurs).
@Moi
Dans le deuxième cas, la banque ne pourra faire le crédit de 600 (ai total) que si elle fait un emprunt de 600 (ou trouve des déposants) qui se retrouvera à l’actif.
C’est bien ça. Et la banque va ipso-facto trouver des déposants qui ne sont autres que les commerçants chez lesquels les emprunteurs achètent des marchandises bien réelles avec leur crédit tout frais tout neuf. Comme ils paient par voie scripturale, les commerçants n’ont pas d’autres choix que de déposer cette monnaie à leur banque.
C’est un peu simplificateur mais assez explicatif. En réalité, il y a des milliers de nouveaux crédits accordés tous les jours, des milliers de commerçants et des dizaines de banques. Les DAV des commerçants sont statistiquement répartis entre ces banques selon leur part de marché respective. De même les crédits accordés qui sont statistiquement répartis selon les parts de marché des mêmes banques. Pour simplifier, je n’ai considéré dans mon schéma que 3 banques couvrant chacune 1/3 du marché. J’aurais pu en mettre 50 avec des parts de marché variables sans que le principe ne change. Afin de montrer la compensation, j’ai un peu déséquilibré les crédits accordés, la banque X « chauffe » un peu trop le crédit, alors que Z est un peu « refroidi ». Ce jour là du moins, car sur une plus longue période, cela devrait s’équilibrer selon leur part de marché respective.
@fujisan: « Et la banque va ipso-facto trouver des déposants qui ne sont autres que les commerçants chez lesquels les emprunteurs achètent des marchandises bien réelles avec leur crédit tout frais tout neuf. »
Cela ne se peut pas. La banque doit avoir l’argent au moment de faire le crédit, c’est-à-dire avant que le commerçant ne vende sa marchandise à l’emprunteur de la banque. Sans quoi la transaction d’achat ne s’effectuera pas, on n’arrivera même pas à la compensation journalière entre banques.
Elle ne peut pas faire crédit en espérant que cet argent reviendra sous forme de dépôt (d’ailleurs la plupart des banques, à commencer par Goldmann Sachs, n’ont même pas de dépôts).
Et de toutes façons, un livre comptable est toujours équilibré. On ne peut pas ajouter un crédit à l’actif en espérant qu’en fin de journée des dépôts arriveront au passif pour équilibrer les comptes.
D’où sortent vos DAV au passif des banques au départ de votre schéma? Je crois comprendre que ce ne sont pas des dépôts, donc c’est quoi?
@Moi dit La banque doit avoir l’argent au moment de faire le crédit, c’est-à-dire avant que le commerçant ne vende sa marchandise à l’emprunteur de la banque. Sans quoi la transaction d’achat ne s’effectuera pas, on n’arrivera même pas à la compensation journalière entre banques.
…
On ne peut pas ajouter un crédit à l’actif en espérant qu’en fin de journée des dépôts arriveront au passif pour équilibrer les comptes.
La BNB dit Pendant la journée CEC comptable, les établissements de crédit peuvent consulter continuellement leur position de trésorerie.
Les banques n’ont pas besoin « d’espérer », elles le savent continuellement combien elles devront payer et aussi combien elles vont recevoir avant même que les soldes nets ne soient réglés d’un coup en fin de journée. Elles peuvent anticiper en conséquence. Il devrait en être de même en France (CORE – STET) et ailleurs, même si ce n’est pas annoncé.
Mais, en général les banques se gardent aussi un petit « matelas » de réserves exédentaires et de fonds propres au delà des exigences règlementaires qui sont minimalistes.
Notez que je pars du principe qu’en début de journée la banque a les réserves (2% des nouveaux crédits monétisés) et fonds propres (8% des nouvelles créances accordées) suffisants pour couvrir ces nouveaux crédits.
D’où sortent vos DAV au passif des banques au départ de votre schéma? Je crois comprendre que ce ne sont pas des dépôts, donc c’est quoi?
Ce sont les nouveaux crédits monétisés par les banques commerciales (en monnaie privée). Cela n’apparait peut-être pas explicitement sur les extraits du DAV de l’emprunteur. C’est peut-être dans un compte d’attente au passif, mais quoi qu’il en soit actif = passif à tout moment par définition. Différentes banques ont différentes approches comptables. Par acquit de consience j’ai regardé les extraits bancaires pour le seul et unique emprunt jamais réalisé par ma TPE pour un achat d’immeuble et le financement de travaux. Pour le coup, la banque avait ouvert une ligne de crédit dans un autre DAV créé pour la circonstance, les paiements étaient débités (le compte en négatif).
@fujisan:
« Pendant la journée CEC comptable, les établissements de crédit peuvent consulter continuellement leur position de trésorerie. »
Leur position de trésorerie auprès de qui? Précisez. Ce n’est pas de leur trésorerie dont vous parlez, car les banques savent évidemment à tout moment quelle est leur trésorerie propre. Vous parlez d’un compte (un nostro) que les banques auraient auprès d’un autre établissement.
« Les banques n’ont pas besoin « d’espérer », elles le savent continuellement combien elles devront payer et aussi combien elles vont recevoir avant même que les soldes nets ne soient réglés d’un coup en fin de journée. »
Combien elles devront payer à partir d’où? Combien elles vont recevoir où? Là encore vous ne semblez pas parler de la banque en propre mais d’un compte qu’elle aurait ailleurs. Ce qui est effectivement le cas. Ce compte peut-il être débiteur? Si oui, qui lui fait crédit?
« Par acquit de consience j’ai regardé les extraits bancaires pour le seul et unique emprunt jamais réalisé par ma TPE pour un achat d’immeuble et le financement de travaux. Pour le coup, la banque avait ouvert une ligne de crédit dans un autre DAV créé pour la circonstance, les paiements étaient débités (le compte en négatif). »
Vous mélangez tout. Là vous nous parlez du compte de votre TPE, d’ailleurs sans préciser si c’était avant ou après que vous ayiez utilisé l’argent mis à disposition par la banque. J’en déduis que ce compte en négatif représente le moment APRES que vous ayiez utilisé l’argent. Or dans votre schéma vous montrez (de manière erronée) le moment AVANT l’utilisation du crédit.
Et d’autre part, quel est le rapport avec le bilan de la banque? Un compte client c’est une chose, le bilan de la banque c’est autre chose.
Si vous voulez mon avis, vous ne maîtrisez pas du tout le B-A-BA de la comptabilité.
@Moi
La position de trésorerie des banques auprès du CEC (Centre d’Echange et de Compensation). Pour la France, ce devrait être auprès de CORE – STET.
J’emploie intentionellement le futur car les soldes nets auprès de la chambre de compensation ne seront réellement réglés qu’en fin de journée. Mais avant de régler le solde net, en cours de journée les banques savent non seulement combien elles devront payer aux autres banques, mais aussi combien elles vont recevoir des autres banques.
Ce compte peut-il être débiteur? Si oui, qui lui fait crédit?
Oui, ce « compte » de la banque auprès la chambre de compensation peut-être débiteur en cours de journée. Il ne sera réglé qu’en fin de journée. Peut-on ici parler de « crédit » pour quelques heures et sans intérêts? La chambre de compensation impose-t-elle des limites à ne pas pas dépasser? Je n’en sais rien.
Là vous nous parlez du compte de votre TPE, d’ailleurs sans préciser si c’était avant ou après que vous ayiez utilisé l’argent mis à disposition par la banque. J’en déduis que ce compte en négatif représente le moment APRES que vous ayiez utilisé l’argent.
Oui, il s’agissait d’une ouverture de crédit (un découvert autorisé, si vous préférez), un compte bancaire créé pour l’occasion avec montant initial de 0 et non le montant du prêt accordé. A chaque paiement de mon entreprise (achat, entrepreneur, artisants, justificatifs à l’appuis), la banque tirait sur la ligne de crédit, ce compte était débité (en négatif). Le contraire pour les remboursements que mon entreprise a fait.
Ceci dit, je me demande toujours où exactement sont repris les DAV débiteurs dans le bilan bancaire quand elle ouvre une ligne de crédit (découvert autorisé ou non) et que son client tire sur sa ligne de crédit (compte débiteur, chez l’entreprise du moins). Pour le coup, si les DAV débiteurs sont regroupés avec tous les autres DAV créditeurs au passif de la banque, c’est mélanger torchons et serviettes.
Et d’autre part, quel est le rapport avec le bilan de la banque? Un compte client c’est une chose, le bilan de la banque c’est autre chose.
Ah bon? Un DAV à l’actif d’une entreprise ou d’un particulier n’aurait-il toujours son équivalent au passif de la banque?
@fujisan: d’abord, je vous dis « chapeau » de me répondre posément. J’écris souvent à la va-vite, sans me relire, et là en me relisant je remarque que le ton que j’emploie est parfois un peu déplacé. Je vous remercie de ne pas y prêter attention.
« Oui, ce « compte » de la banque auprès la chambre de compensation peut-être débiteur en cours de journée. »
Bizarre. Il faudrait comprendre exactement les modalités.
« Ceci dit, je me demande toujours où exactement sont repris les DAV débiteurs dans le bilan bancaire quand elle ouvre une ligne de crédit (découvert autorisé ou non) et que son client tire sur sa ligne de crédit (compte débiteur, chez l’entreprise du moins). »
Les DAV débiteurs des clients sont des crédits pour la banque. Ils sont à l’actif. C’est que vous appellez « crédit » dans votre schéma. Lorsque la banque ouvre une ligne de crédit, il ne se passe rien tant que le client ne tire pas dessus (cela n’apparaît pas au bilan).
Lorsque la banque fait un prêt, elle crédite le DAV du client mais porte aussi ce montant à son actif. C’est pour cela que je demande « quel rapport? ». Le DAV du client n’est pas un seul compte dans le bilan de la banque (elle ouvre une multitude de comptes pour chaque prêt: un compte encours, un compte reprenant le remboursement intérêts, un compte pour le remboursement capital, etc). Le client, lui, ne voit qu’un compte.
Le compte client est une chose, le bilan de la banque autre chose. Du point de vue de la banque, il y a un compte client au passif (contenant les dépôts), un compte client-prêt au passif (du montant global du prêt versé au client et il diminue au fur et à mesure que le client le dépense), un compte remboursement intérêt à l’actif (montant des intérêts du prêt, commence à 0 et il augmente au fur et à mesure du remboursement des intérêts), un compte encours à l’actif (montant du prêt et il diminue au fur et à mesure du remboursement du capital du prêt), etc. Vous voyez que lorsque le client sort de l’argent il tire sur le compte client-prêt, et diminue d’autant le passif du point de vue de la banque. Il déséquilibre ainsi les comptes et cela est compensé par un emprunt (qui ira couvrir le trou au passif). Lorsque le client rembourse, il déséquilibre aussi le bilan et cela est compensé par l’augmentation du capital au passif et la diminution de son emprunt.
Tout ceci pour dire que je peux me tromper sur l’un ou l’autre point de détail (n’étant pas comptable) mais pas sur le principe: la banque n’invente pas l’argent. Ce qu’elle prête, elle doit aller le chercher quelque part. Soit en utilisant les dépôts des clients, soit en se refinançant par un emprunt. Lorsque l’argent qu’elle a prêté ne revient pas, elle a un souci car elle doit se refinancer d’autant (nouveaux dépôts ou nouveaux emprunts). Et si elle n’arrive pas à se refinancer, kaputt.
J’ajoute que de par mon travail (dans une très grosse banque qui n’a pas à proprement parler de dépôts clients), j’ai pû vérifier certaines choses à la lecture de Paul Jorion et constaté qu’il disait vrai (je n’y réfléchissait même pas auparavant).
Chaque sortie de fonds (prêts) est couverte par des entrées (emprunts).
@Moi
Merci pour les précisions. Si je comprends bien, les mouvements qui apparaissent sur un extrait de compte du client, n’est pas le reflet des mouvements dans les livres de la banque. Si j’ai bien compris, un extrait avec un solde débiteur sur un DAV, ne serait pas un compte débiteur au passif de la banque, mais un compte créditeur à l’actif de celle-ci.
Nous touchons là peut-être le noeud du « problème ». Il y a différents types d’établissement financiers. Certains sont plus orientés vers les prêts (plutôt à LT) ou les investissements et sont continuellement à la recherche de liquidités pour couvrir leurs prêts. D’autres sont plus orientés vers l’épargne, l’assurance-vie, la collecte de fonds et sont continuellement à la recherche de placements. D’autres enfin sont assez équilibrés, autonomes, les méga-bancassureurs, les méga-banques universelles « qui ne dorment jamais » ;-).
On ne peut faire une généralisation à partir d’un seul type d’établissement financier. Ce serait une déformation du fonctionnement du système bancaire dans son ensemble.
PS: Je me souviens maintenant qu’une banque d’épargne belge proposait dans les années 1980-1990 des comptes d’épargne dont le taux était lié au BIBOR moins quelques points (le LIBOR / EURIBOR belge de l’époque). Cela me semble un exemple parfait d’une banque qui collectait l’épargne pour la prêter à d’autres sur le marché interbancaire.
NB Je ne suis pas comptable moi-même. Je suis un simple petit « patron » qui s’est occupé de la compta journalière de sa TPE et fait appel à un expert comptable pour les clôtures de fin d’année.
J-P Voyer a raison.
Il a essayé de rentrer dans le coeur de la comptabilité, mais même ce qu’il montre est trop simplifié pour que l’on puisse comprendre ce qui se passe.
Pour le comprendre il faudrait rentrer dans le coeur de tous les livres de comptes :
-livre des achats
-livre des ventes
-livre des fournisseurs
-livre des clients
-livre des investissements
-livre de caisse
-livre des réserves
-livre des emprunts
-livre des créances
-etc,etc….
Dans tous ces livres il y a des comptes :
-compte achats consommables
-compte achats matériel
-compte achat mobilier
-compte achat immobilier
-comptes amortissements
-comptes clients
-comptes fournisseurs
-comptes emprunts
-comptes créances
-compte caisse
-compte trésorerie
-etc,etc………..
C’est en suivant de débit en crédit, de crédit en débit, tout au long de ces comptes que l’on peut voir la circulation des sommes inscrites.
C’est exprès que je parle de « sommes ».
Parce que si au début de la création de la comptabilité on pouvait parler d’argent ou de monnaie, aujourd’hui il devient de plus en plus rare que ces sommes concernent véritablement de « l’argent ».
Sauf lorsque vous retirez un peu de « liquide » au distributeur, ou lorsque par extraordinaire vous remettez un peu de « liquide » à votre banque ou si vous payez quelqu’un avec ce même « liquide ».
La grande majorité de ces « sommes » ne concernent que des dettes ou des créances, de la banque vis à vis de vous, d’un employeur vis à vis de vous, de vous vis à vis de la banque, de vous vis à vis d’un commerçant, etc……
En remontant la liste des comptes suivis par une somme donnée vous pourriez voir qu’elle provient à chaque fois d’une dette, ou d’une créance, suivant de quel côté on se trouve.
Nous vivons tous sur la dette.
C’est pourquoi j’avais ailleurs fait le commentaire suivant :
à savoir que pour moi le plus grand scandale c’est que justement les banques n’ont rien créé du tout !
Ni le principal ni les intérêts !!!!!!!!!!!
Nous sommes assis sur une énorme, une phénoménale cavalerie !!!!!!!
Et il est tout à fait exact de dire que toutes ces dettes ne pourront être remboursées!
« Nous sommes assis sur une énorme, une phénoménale cavalerie !!!!!!!
Et il est tout à fait exact de dire que toutes ces dettes ne pourront être remboursées! »
Oui. Et qui dit dette, dit forcément créance (l’autre côté du miroir, du bilan bancaire). Comme la bulle de surendettement mondiale à tous niveaux doit inéluctablement éclater, un défaut de paiement, une faillite… entraine obligatoirement une réduction correspondante du côté dépots, épargne, assurance-vie… La question est : qui va perdre/payer. Pour l’instant les états font tout leur possible pour que ce soit le (futur) contribuable, en comblant avec de la dette publique toute perte par défaut/faillite personnelle ou d’entreprise. Mais cela ne fait qu’ajouter encore plus de dette sur la montagne de dettes existantes.
Et si pour changer, la caste politique arrêtait de mépriser et infantiliser la polulation, de faire diversion avec de faux débats, voire de discutailler du sexe des anges?
Et si pour changer, la caste politique arrêtait d’imposer ses vues à elle, de défendre encore et toujours les puissants et riches?
Et si pour changer, la caste politique sourde et aveugle, enfermée dans sa tour d’ivoire, écoutait non les lobbies et spécialistes doctrinaires mais les citoyens qu’elle ose prétendre représenter?
Et si pour changer, on mettait la politique au service de la population ?
Et si pour changer, on arrêtait la guerre économique permanante que tous les prétendus représentants de la population lui ont imposé de force voire contre son gré? (Et oui, tous les partis prétendus démocratiques ont voté les « bons » Traités de Maastricht et Lisbonne avec ses gardiens de la doctrine de la foi ordolibérale).
Et si pour changer, on mettait l’économie et la finance au service de la population?
Et si pour changer, on osait la paix économique?
Et si pour changer, on osait la démocratie?
C’est trop en demander?
On peut toujours rêver…
à Pierre-Yves D.
Merci sincère pour votre sollicitude.
Il serait en effet excellent de débarrasser les banques centrales de l’idéologie monétariste , de supprimer les stock options et de prendre les autres mesures proposées par Paul. Mais, oui ou non, Paul constate-t-il comme tout le monde que les crédits bancaires constituent la source essentielle de nos moyens de paiement – ce que beaucoup appellent notre monnaie – et souhaite-t-il, comme Ellen Brown le dit nécessaire, » rendre le pouvoir de création monétaire au gouvernement et au peuple qu’il représente » ?
J’ai peine à le dire, mais je ressens tout le reste comme des tergiversations.
Le but étant défini, il resterait tant à examiner pour l’atteindre dans l’ordre et sans créer de désastre que Paul, et beaucoup d’autres ici, y trouveraient sans aucun doute matière à exercer leur humanisme et leur talent.
Sincèrement vôtre.
Jean jégu.
« Débarrassons les banques centrales de l’idéologie monétariste ».
L’idéologie monétariste est sûrement une mauvaise chose, pour les banques centrales comme pour toute autre institution. Comment fait-on pour cela? Traquer l’idéologie, ce n’est déjà pas simple chez des personnes, alors, pour des institutions? La seule piste me semble être de changer le système monétaire. B.L.
M. Voyer,
Sur les schémas que vous proposez, il manque tout de même une partie majeure, qui est celle qui va transformer la « dette » de la banque envers l’emprunteur en « monnaie » : c’est la contrepartie inscrite au contrat d’emprunt par l’emprunteur.
Sur cette contrepartie contractuelle, la dette de la banque n’est plus contrebalancée par l’argent dont dispose la banque, mais par l’engagement du client emprunteur à rembourser sa propre dette envers la banque. Sur le schéma comptable de l’emprunt, la dette du client (créance de la banque) est équilibrée par la créance du client (dette de la banque).
Avec cet engagement, et la garantie apportée au contrat, la banque va pouvoir abonder son compte d’exploitation, colonne « actif », ce qui compense plus que largement la dette qui reste inscrite au compte courant du déposant initial, une fois le compte BC soldé par la compensation.
C’est là qu’est la nouvelle monnaie :dans la rémanence de la dette de l’emprunteur, signifiée par une créance de la banque inscrite à l’actif de son compte d’exploitation. Cette créance a une durée de vie limitée, et la dette correspondante circule comme monnaie jusqu’au terme du crédit.
Les banques privées créent la monnaie de l’économie de toute la collectivité, sur l’engagement de la collectivité à créer de la richesse supplémentaire dans le futur. C’est très bien, le mécanisme est excellent, car il permet de disposer maintenant de la monnaie représentant des échanges futurs, et donc d’amorcer la production de biens dont ces mêmes échanges auront besoin. Par contre, elles le font pour leur propre compte, et accaparent tout à la fois le droit de décider pour quel futur la monnaie sera produite, et celui d’en récolter les dividendes (une part importante de l’accroissement effectivement obtenu de la richesse collective, sous forme d’intérêts)
Tout ceci devrait bel et bien relever du domaine public.
@ fujisan 10 février 2010 à 22:20
Je vous croyais allergique au travail, et pourtant vous en avez fourni un très utile, en montrant comment s’opèrent les compensations grâce à ce tableau sur l’évolution des comptes des banques X,Y,Z.
Merci !
C’est une construction qui n’a nécessité que peu de matières premières non renouvelables. Si on traitait la satisfaction de tous nos besoins essentiels sans puiser davantage dans ce qui nous reste sur la planète, cela laisserait de l’espoir. C’est possible à condition qu’on réussisse très rapidement à faire en sorte que les près de 7 milliards d’individus dont nous faisons partie, soient plus attirés par des biens intellectuels et spirituels que par les biens matériels dont on leur donne envie.
Cela implique un travail colossal de la part de ceux qui, détenant un savoir, et une vision messianique, seraient en mesure, en s’appuyant sur les moyens modernes de communication, de convertir la planète entière à une nouvelle religion, celle de l’économie des ressources matérielles.
Qui, après Jésus, Mahomet et les autres, sera le nouveau messie ?
Il lui faudra beaucoup de courage et de persuasion pour montrer aux puissants et aux autres à quel point nous sommes près du gouffre et que plus on crée de dettes plus on accélère notre extinction.
Les spécialistes des effets de levier dans la finance, devraient être endoctrinés les premiers afin qu’ils se convertissent et exercent leur pouvoir multiplicateur de richesses matérielles virtuelles sur celui des richesses spirituelles dont la communauté des hommes a un urgent besoin.
Là, ils auraient bien mérité un bonus. Sous quelle forme serait-il octroyé ? En durée à vivre peut-être.
Perso je distingue travail salarié (et souvent aliénant) et activité librement choisie (et souvent gratifiant).
Les spécialistes des effets de levier dans la finance, devraient être endoctrinés les premiers
« Donnez-moi un point d’appui, je soulèverai le monde » Archimède 😉
« Si on traitait la satisfaction de tous nos besoins essentiels sans puiser davantage dans ce qui nous reste sur la planète, cela laisserait de l’espoir. C’est possible à condition qu’on réussisse très rapidement à faire en sorte que les près de 7 milliards d’individus dont nous faisons partie, soient plus attirés par des biens intellectuels et spirituels que par les biens matériels dont on leur donne envie. »
C’est beau comme du Gandhi dis :
« La civilisation, au vrai sens du terme, ne consiste pas à multiplier les besoins, mais à les limiter volontairement. C’est le seul moyen pour connaître le vrai bonheur et nous rendre plus disponible aux autres. Il faut un minimum de bien-être et de confort ; mais, passé cette limite, ce qui devait nous aider devient source de gêne. Vouloir créer un nombre illimité de besoins pour avoir ensuite à les satisfaire n’est que poursuivre du vent. Ce faux idéal n’est qu’un traquenard. Il faut savoir imposer une limite à ses propres besoins, physiques et même intellectuels, sinon la nécessité de les satisfaire devient recherche de la volupté. Nous devons nous arranger pour que nos conditions de vie, sur le plan matériel et culturel, ne nous empêchent pas de servir l’humanité, mission qui doit mobiliser toute notre énergie.
@ fujisan
D’abord merci pour votre explication des flux nets à M Voyer, il n’a pu vous opposer aucun contre argument.
Par contre vous écrivez: « un défaut de paiement, une faillite… entraine obligatoirement une réduction correspondante du côté dépots, épargne, assurance-vie… »
Pouvez vous préciser pourquoi la suppression d’une créance à l’actif de la banque suite à une faillite entraîne automatiquement une réduction d’un DAV ou autre. Moi j’aurais dit plutôt que cela entraînait au passif de la banque une baisse de ses fonds propres.
Oui, mais les fonds propres ne vont pas en négatif, sinon c’est la faillite. Et vu les fonds propres minusculissimes (effet levier gigantissime) des banques, il ne faut pas grand chose…
Ce que je veux dire, c’est que le montant de richesse correspond à un montant équivalent de dettes. S’il y a des riches, c’est qu’il y a des endettés et vice-versa. Les deux vont de pair, sont les deux faces de la même chose (qu’on passe ou pas par l’intermédiaire d’une banque ne change pas grand chose). Moins d’endettés, c’est obligatoirement moins de riches. Et plus de riches, c’est obligatoirement plus d’endettés. C’est surtout cela que montre les bilans des banques et assureurs.
Reconnaissant qu’on est dans une crise de surendettement généralisé, qu’une grande partie des dettes doit inéluctablement disparaître, ça signifie obligatoirement qu’un montant équivalent de « promesses de richesse » (dépôts, épargne, assurance-vie…) doit aussi disparaître. Toute la question est de savoir trier le bon grain de l’ivraie, d’avoir un minimum de justice sociale et choisir qui va perdre ses belles « promesses de richesse » qui ne reposent en fait que sur une montagne de dettes impayables.
« Les riches ont des angoisses, les pauvres ont des inquiétudes. » Louis Scutenaire
PJ propose de soulager l’angoisse de ceux qui ont de l’argent « en trop » à ne savoir qu’en faire pour retirer les inquiétudes de ceux qui ont de l’argent « en trop peu ». Malheureusement nos « bons » gouvernements font tout leur possible pour que les riches restent angoissés et les (futurs) contribuables encore plus inquiets.
Si on ne veut pas admettre que les banques ont le pouvoir de monétiser les reconnaissances de dettes de ses clients emprunteur (monétiser dans « leur monnaie », la monnaie crédit agricole ou la monnaie Deutchbank ou..), c’est essayer de comprendre le fonctionnement du système bancaire comme on essayerait de comprendre le fonctionnement d’une montre en regardant bouger les aiguilles. C’est l’ensemble du système banque centrale + banques commerciales) qui est créateur d’expansion du crédit. Comme l’écrit Schumpeter » Le processus de création des dépôts, souvent qualifié de « création de crédit », est fondamental pour comprendre la monnaie et la banque. Un examen complet de ce processus essentiel permet de percevoir la nature des dépôts à vue, des dépôts à terme ou d’épargne, la fonction des réserves et le rôle de la banque centrale.
Le problème de la création de crédit est habituellement présenté au néophyte sous l’aspect du paradoxe du système totalement « prêté », dans lequel les dépôts sont un multiple des réserves – un multiple égal à l’inverse du ratio de réserves – et dans lequel la banque individuelle, dont les dépôts sont aussi un multiple des réserves, ne peut pas, sur la base d’une augmentation donnée de ses réserves, étendre ses dépôts plus que d’un montant égal aux réserves extra excédentaires. La banque individuelle est dépourvue du pouvoir de « multiplier » les dépôts, bien que d’une manière ou d’une autre le système ait ce pouvoir et en réalité la banque individuelle, dans l’équilibre final, semble avoir multiplié les dépôts. »
Un grand Merci quand même à Paul d’avoir publié le billet invité de Monsieur Voyer!
Enfin quelqu’un qui démontre, comme Paul, H.Creutz et moi-même, que les banques ne créent pas un centime via le crédit!
Si j’ai envoyé les « créationnistes en CP pour qu’ils apprennent à calculer, je les enverrais maintenant plutôt devant le tribunal correctionnel pour tromperie et escroquerie!
Comment justifier que les banques (hormis la banque centrale avec de l’encre et du papier spécial!) « créent de la monnaie? Les banques ne le disent pas, et la loi l’interdit!
Chaque dépôt en banque est un prêt à la banque, souvent rémunéré avec des intérêts. Et si la banque emprunte ainsi auprès du public, c’est dans le simple but de faire l’intermédiaire entre les épargnants-prêteurs et les emprunteurs ayant besoin de fonds.
Dettes et créances sont, évidemment jumelles, leur somme est toujours nulle.
Le fait qu’il y a des personnes disposant d’une épargne abondante vient de l’inégalité des revenus qui se transforme peu à peu en inégalité fortune.
Par ailleurs, l’épargnant ne dépense pas ce que l’emprunteur dépense à sa place.
Il n’y a dans ce fonctionnement circulaire tout simplement aucune place pour la « création de monnaie via le crédit »!
Les « créationnistes », au nom de leur ahurissantes constructions, ne veulent simplement pas voir que la banque reçoit autant qu’elle prête et se contentent de ne voir que ce que les banques prêtent! On les comprend, ils ne sont pas fortunés mais simplement asservis au grand capital et fascinés des grands chiffres et perdent toute capacité de raisonner simplement. Le « grand capital » ne dit pas (mais le fait) que les fonds proviennent des dépôts presque exclusivement, car cela révèlerait peut-être à quel point les fortunés sont fortunés.
J’ai interrogé le directeur de la caisse d’épargne à Bordeaux qui m’a parfaitement confirmé cela!
Pour tout prêt, la banque se soucie toujours comment elle peut le financer ou refinancer!
Et si la banque n’avait pas impérieusement besoin de dépôts pour prêter à son tour, on ne voit pas pourquoi elle rémunèrerait l’épargne, y compris des gens modestes.
Il est vrai aussi que la banque prend une marge en demandant davantage pour les prêts qu’elle ne paye pour les dépôts évidemment, car la banque est une entreprise et doit payer son fonctionnement.
Dans ce contexte, il est évident aussi que la banque ne prête guère (sauf à la marge et en étant acculée) ses fonds propres mais quasi exclusivement les dépôts des épargnants.
Si la banque cessait de prêter, elle ne pourrait plus rémunérer les épargnants, les épargnants retireraient leur argent en liquide (essayeraient de le faire, c’est impossible évidemment en même temps pour tous), et la vie économique s’arrêterait tout simplement. Donc les banques veulent prêter ais ne peuvent plus prêter aux insolvables, d’où le problème actuel!
C’est à ce niveau-là que la monnaie liquide, valeur refuge ultime, dysfonctionne gravement, car, destinée à circuler, elle cesserait de circuler si son détenteur n’était plus rémunéré par l’intérêt.
Or, l’intérêt du capital et l’intérêt des interêts du capital font que les fortunés auront toujours davantage de créances et, symétriquement, les dettes augmentent d’autant.
A la fin, devant l’insolvabilité croissante, nous aurons toujours la crise systémique tout simplement parce que la monnaie dysfonctionne gravement dès le départ. Car la crise systémique est simplement le fait que les créances ne sont plus remboursables et que la ruine des débiteurs implique des pertes massives pour les prêteurs, ce que l’on ne veut pas du fait de la « confiance » des créanciers -épargnants que l’on veut et doit sauver – au besoin en injectant de la monnaie centrale.
Pourquoi délirer avec des constructions comptables sans queue ni tête quand les choses se présentent finalement si simplement?
Non, les banques ne créent pas de monnaie en prêtant car elles empruntent autant, c’est tout!
Encore un point: Parce que le prêteur sousconsomme par rapport à ses avoirs il en résulte que l’emprunteur surconsomme en dépensant à la place du prêteur. Il en résulte encore que le crédit n’anticipe aucun avenir mais fait qu’au présent la totalité des biens, services et biens d’équipement trouvent acheteur, autrement dit, les prêts sont une nécessité pour le bon fonctionnement présent de l’économie.
L’ »anticipation »est seulement dans la tête des acteurs économiques qui y croient, mais le crédit ne peut pas faire acheter aujourd’hui ce qui n’existe que demain, mais seulement des promesses, des promesses d’un remboursement futur moyennant quoi les fonds retourneront au prêteur dans un futur toujours incertain.
Le crédit n’achète que des biens au présent!
Monsieur Joannes
– Va falloir renvoyer Schumpeter au CP ou en prison, n’est ce pas ? …
– les banques ne créent pas « de l’argent » (imprimé), mais « leur monnaie » (électronique): ensuite elles ont besoin d’assurer leurs besoins en monnaie centrale (argent imprimé demandé par le public, réserves obligatoires, soldes négatifs de compensation, en notant qu’il n’y a plus aucun solde de compensation si on considère l’ensemble du réseau bancaire) en laissant en dépôt des obligations solides (reconnaissances de dettes des Etats sous forme d’OAT, IBAN,etc.) à la banque centrale qui leur fournit donc cette monnaie centrale
– Vous faites l’erreur que dénonce Schumpeter dans l’extrait ci dessus http://www.pauljorion.com/blog/?p=7821#comment-55510 : celle de ne considérer qu’une banque isolée (enseigne bancaire.. du bilan duquel il est impossible de « voir » l’expansion générale du crédit) et non l’ensemble du système bancaire
– Il est normal qu’un directeur d’agence bancaire considère qu’il doive couvrir ses crédits par ses dépôts ( http://tinyurl.com/ygbrbtq ), car il regarde le bilan d’une agence et non pas de l’ensemble consolidé du système bancaire commercial
– Vous oubliez la double casquette des banques : monétisent des reconnaissances de dettes (c’est le « faire crédit ») en plus de prêter des épargnes disponibles (rôle d’intermédiaire) en écrivant « si la banque n’avait pas impérieusement besoin de dépôts pour prêter à son tour, on ne voit pas pourquoi elle rémunèrerait l’épargne, y compris des gens modestes. »
Vous avez raison en écrivant :
– « Si la banque cessait de prêter la vie économique s’arrêterait tout simplement ». Mais rien à voir avec « elle ne pourrait plus rémunérer les épargnants ». Si la banque cessait d’émettre du crédit, il n’y aurait plus aucune monnaie (scripturale) lorsque les crédits seraient remboursés, tous les emprunteurs « finaux » devraient les intérêts qu’ils ne pourraient plus payer et seulement quelques pourcents de la monnaie que nous utilisons resteraient utilisables (l’argent central) … je ne vous dis pas les problèmes de règlements des gros montants. Mais on ré inventerait vite la monnaie scripturale, en espérant que cette fois on laisserait son émission au collectif (l’Etat)
– « l’intérêt du capital et l’intérêt des intérêts du capital font que les fortunés auront toujours davantage de créances et, symétriquement, les dettes augmentent d’autant. » Oui. car les plus fortunés peuvent « obtenir du crédit »
Le problème est que vous mélangez « la banque » et « le système bancaire » .
« Schumpeter au CP » ? Je démonte dans « L’argent, mode d’emploi » (Fayard 2009 : 150-153), l’un de ses « raisonnements » qui oblige en effet à poser la question sérieusement. Vous me répondrez : « Il n’est pas seul parmi les économistes ! » Ce n’est pas une excuse.
Schumpeter au CP. Avec Botul-Henri Lévy comme copain de classe !
@Johannes
« On les comprend, ils ne sont pas fortunés mais simplement asservis au grand capital et fascinés des grands chiffres et perdent toute capacité de raisonner simplement. »
sympa pour ceux qui ne sont pas de votre avis: vendus donc idiots 😉
Juste un point les créationnistes que vous accusez sont aussi des destructionnistes: si la monnaie scripturale existe (même si ce n’est pas un concept « théorique » au sens où Paul Jorion l’entend page 49 ou 50 de son livre) et si elle représente 83 à 85% de M1) c’est le solde « net » des reconnaissances de dettes et des remboursements.
Il y a création « scripturale » – fantasmagorique si vous le voulez – lors de l’ouverture d’un crédit, et destruction (« réelle » ou « fantasmagorique) lors du remboursement. D’où le fait qu’il faut s’attaquer aux « créationnistes-destructionnistes », pour être parfaitement cohérent.
Cordialement, B.L.
Sur les questions de création monétaire, je n’ai jamais compris pourquoi il y avait tant de délires. Votre schéma est bien peu différent de celui qu’on trouve dans les manuels scolaires… Ha si vous faite apparaitre la dimension temporelle! Ceci dit, on peut considérer que le schémas des manuels d’éco n’a jamais prétendu être réaliste, c’est juste l’équilibre vers lequel on tend quand t tend vers plus l’infini.
Je n’ai d’ailleurs jamais compris pourquoi on s’obsédait à écrire banque A puis banque B etc. A l’échelle macro ca ne change rien de ne considérer qu’une seule banque ce qui est équivalent à considérer l’agrégé de plusieurs banques.
Vous dites que l’on ne connait pas la vitesse de convergence. J’ai un élément de réponse. Si chaque année les banques doivent publier des bilans respectant le ratio de réserve de 8%, sachant qu’elles ont utilisé tout l’argent disponible dans leur passif et qu’elles n’ont pas de compensation (quel est l’intéret de garder des reserves au dela du ratio legal? Surtout qd on présente un bilan à des actionnaires!), la création monétaire a été épuisé en au moins un ans.
Vous dites qu’il n’y a pas de création monétaire mais de la création de dette. Par définition l’argent est une dette! Si vous avez un billet de cinq euros c’est qu’il a été prêté par la banque centrale à une banque et que par un chemin complexe il est arrivé dans votre poche. L’argent, c’est juste du papier qu’une banque centrale a imprimé et ensuite prêté. Par conséquent le dépot initial de la baque A (de 100) n’est pas moins une dette que les avoirs du client Y puisque c’est la banque centrale qui a déposé ces 100.
La seule vrai question que vous posez, c’est pourquoi les banques ont le pouvoir de création monétaire?
1) C’est une facon de rémunéré les employés de la banques qui doivent allouer au mieux cet argent
2) Il serait difficile à imaginer que la BCE ait la capacité de prêter elle même à tous les particuliers
3) Il est tout a fait possible d’envisager d’autres acteurs et de fixer des règles sur les taux pratiqués car la concurrence entre banques ne semble pas fonctionner
Pourquoi un mécanicien SNCF a besoin de s’endetter?
Tout simplement parce qu’il ne produit pas assez de richesse par rapport à celle qu’il consomme. Rien ne l’empeche de consommer moins et mieux, ou d’apporter plus de valeur ajouté dans ce qu’il produit…
Enfin, si vous voulez qu’on crée vraiment des jetons au lieu de créer des dettes, il suffit d’imposer un ratio fractionaire de 100% et de demander à la BCE d’imprimer 10 fois plus de billet. De toute facons cette distinction entre jetons et dettes est ridicule puisque les jetons ne sont rien d’autre qu’une dette contracté à la BCE…
Examinez votre raisonnement : ce n’est pas une démonstration, c’est un postulat. Si l’argent a été prêté par la banque centrale, 1) quelle est la maturité du prêt ?, 2) quel est le montant des intérêts ?
La raison pour laquelle il n’y a maturité ni intérêts est simple : c’est parce qu’il ne s’agit pas d’un prêt. Tout ceci est fort bien expliqué dans mon ouvrage « L’argent, mode d’emploi » (Fayard 2009) ; il oblige bien sûr à revoir certains vieux schémas.
Autre postulat: je résume les propos de Jean, le mécanicien s’endette par ce qu’il ne produit pas assez de richesse ou de plus value. La messe est dit.
Renversons le postulat, le mécanicien s’endette par ce qu’on lui donne pas assez de richesse en partageant sa plus value. Circulez, il n’y a rien à voir est aussi un autre postulat dans le tout « sécuritaire ».
La crise devrait vous démontrer, que le rapport richesse/plus value de votre postulat, est simpliste et non pas simplement d’évidence.
L’argent : c’est la dette de l’homme envers la société.
1) Maturité, synonyme : durée de vie.
2) Montant des intérêts : le travail de l’homme + la préparation de sa descendance pour qu’elle accepte sans rechigner la même dette.
Dur dur de sortir du cadre 🙂 !?
Paul Jorion
Ok, il faut que la banque possède l’argent pour chaque crédit qu’elle accorde mais si ce crédit est compensé par un autre crédit d’une autre banque, cet argent n’aura pas été utilisé par la banque et pour pourtant deux nouveaux dépôts dans chacune des banques auront été créés.
Dans la durée si le marché bancaire reste équilibré, les crédits seront remboursés avec ces dépôts.
Vous voyez bien que de leur création jusqu’à leur disparition (si tout se passe bien) ces crédits n’auront pas nécessité de monnaie centrale en dehors des fuites et des réserves obligatoires.
Je vous accorde que cet exemple est caricaturale (le marché n’est pas si bien équilibré que cela) mais l’idée est là et je ne conteste pas que si le marché bancaire se déséquilibre surgissent de gros problèmes.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous n’admettez pas cela, d’ailleurs s’il en était différemment je me demande bien à quoi servirait les chambres de compensation.
« cet argent n’aura pas été utilisé par la banque et pour pourtant deux nouveaux dépôts dans chacune des banques auront été créés »
C’est exact. Mais uniquement dans les comptes. Il n’y a pas d’argent créé.
La banque A possède un billet de 100 en caisse que le marchand X est venus déposer. Elle fait un crédit de 100 à Y.
La banque B est dans la même situation, le marchand X’ est venus déposer 100 et elle a ouvert un crédit de 100 à Y’.
Y achète pour 100 auprès du marchand X’ et au même moment Y’ achète pour 100 auprès du marchand X.
La banque A et B ne s’échangent pas d’argent grâce à la compensation. Mais rien n’a été créé. Elles ont toujours chacune un seul billet de 100 en caisse.
Si Y ne rembourse pas son emprunt et que le marchand X vient entretemps essayer de vider son compte (qui est à +200), la banque A répondra ceci à X: « Monsieur, revenez demain. Aujourd’hui nous ne pouvons vous donner que 100. » Et la banque A essayera de vite trouver 100 pour le lendemain (en faisant par exemple un emprunt auprès d’une autre banque). Si elle n’y réussit pas, la banque A fait faillite et X a perdu 100.
Autrement dit, lorsque vous déposez votre argent à la banque (commes les marchands X et X’), vous le prêtez à votre banque, qui va le re-prêter à quelqu’un d’autre. Ce que vous voyez sur votre extrait de compte, n’est pas l’argent dont vous disposez, ni même l’argent dont dispose la banque. C’est l’argent que la banque vous doit (une reconnaissance de dette) et qu’elle s’engage à vous livrer plus ou moins quand vous le demandez (essayez par exemple de vider votre compte qui contient 50 mille euros pour voir si la banque vous les donne de suite; à coup sûr, elle vous demandera de revenir dans un ou deux jours).
Contrairement à ce que vous dites,
1) la banque centrale applique des taux banques (taux directeur US aujourdh’ui de 0,25% par exemple).
2)Les maturités dépendent de l’organisation de la BC. Il y a des opérationde financement hebdomadaires à échéance 1 semaine, d’autre trimestriel à échéance 3 moi, opérations de financement exceptionel..
D’ailleurs, je vous signale au passage qu’un depot n’est rien de plus qu’une dette à taux 0% et maturité stochastique pour une banque.
Ainsi la monnaie n’est rien de plus qu’un bout de papier qui appartient à la banque centrale et que l’on possède temporairement et auquel on fait confiance tant que la banque centrale a une politique crédible.
Enfin, la raison pour laquelle il s’agit d’un pret et non d’un don de la banque centrale au banque est que la force de rappelle que procure un pret est indispensable pour la banque centrale pour exercer son pouvoir de destruction monétaire (bizarement, vous n’évoquez jamais la destruction monétaire…).
Au lieu de critiquer les vieux schemas, vous devriez peut être visiter la BCE pour savoir comment elle fonctionne. Et aussi lire les vieux schemas jusqu’au bout, car je suppose qu’après avoir évoqué la création monétaire, les ouvrages que vous critiquez présente la destruction monétaire, mais ca vous n’en parlez pas (peut être parce que dans cette partie là on insiste bien sur la force de rappel dont dispose la banque centrale pour detruire de la monnaie?).
@moi
J’aime être précis donc je résume en comptabilité simplifiée ce que vous dites:
Situation comptable des banques A et B avant que les crédits octroyés ne soient dépensés
*****Banque A
ACTIF
Caisse=100 espèces
Créance Y=100
PASSIF
DAV Y=100
DAV X=100
*****Banque B
ACTIF
Caisse=100 espèces
Créance Y‘=100
PASSIF
DAV Y‘=100
DAV X‘=100
——————————————————
Y achète pour 100 auprès du marchand X’ et au même moment Y’ achète pour 100 auprès du marchand X.
*****Banque A
ACTIF
Caisse=100 espèces
Créance Y=100
PASSIF
DAV Y=0
DAV X=200
*****Banque B
ACTIF
Caisse=100 espèces
Créance Y‘=100
PASSIF
DAV Y‘=0
DAV X‘=200
Vous écrivez:« La banque A et B ne s’échangent pas d’argent grâce à la compensation. Mais rien n’a été créé. Elles ont toujours chacune un seul billet de 100 en caisse. »
Si, les deux banques ont fait augmenter de 200 le M1 scriptural soit un total pour l’exemple ci dessus de 400 M1 scripturale pour 200 dans la caisse des deux banques.
Avec 400 on peut acheter plus de chose qu’avec les 200 du départ.
Les 200 qui ont été crée ne sont pas de la monnaie fiduciaire mais de la monnaie scripturale qui comme vous le savez est une reconnaissance de dette MAIS aussi un moyen de paiement quand TOUT VA BIEN.
Il est bien évident que lorsqu’il y a des défauts de remboursement ou que le marché interbancaire se déséquilibre (fuites) ça ne fonctionne plus mais qui dit le contraire?
Mais pendant des années ce système a bien fonctionné et les crédits accordés ont pu être remboursé avec les dépôts qu’ont généré ces mêmes crédits avec un ratio de liquidité de 20% pour les banques (à ne pas confondre avec le ratio de solvabilité).
Je ne comprends pas ce qu’il y a de compliqué la dedans alors pourquoi toutes ces contorsions dialectiques?
@jean.
« Je n’ai d’ailleurs jamais compris pourquoi on s’obsédait à écrire banque A puis banque B etc. A l’échelle macro ca ne change rien de ne considérer qu’une seule banque ce qui est équivalent à considérer l’agrégé de plusieurs banques. »
Vous avez bien raison. Je pense effectivement que les mécanismes monétaires sont plus clairs avec une « macro-banque » ou un système bancaire global intégrant l’ensemble des banques commerciales « de second rang » (et laissant en dehors, bien sûr, la banque centrale, banque « de premier rang ») B.L.
@Paul Jorion dit:
Certes les billets de banque n’ont ni maturité/échéance, ni ne portent d’intérêts eux-mêmes. Mais d’où viennent-ils? Quelle est la contrepartie? La banque commerciale « achète » les billets à la banque centrale en « payant » en monnaie centrale avec son dépôt (réserves excédentaires) auprès de la même banques centrale.
Et comment est créée la monnaie centrale contre laquelle sont échangés les billets de banque? La monnaie centrale est créée ex-nihilo par la banque centrale quand elle « achète », monétise des créances (en principe des bons du Trésor) auprès des banques commerciales.
Donc derrière tout billet de banque se trouvent des créances/dettes (bons du Trésor) qui ont bel et bien une maturité et portent intérêts.
Je crois avoir compris le postulat de Monsieur Jorion, effectivement de ce point de vue là, il n’y a pas de création d’argent mais une création toujours plus grande de dépendance et d’impôts car pour moi les intérêts de toutes ces montagnes de dettes ne sont qu’un impôt des plus pauvres vers les plus riches, une sorte de Dîme de notre époque.
Effectivement ce n’est pas plus de richesse que créait le système monétaire comme il est fait mais seulement plus de dépendance à tel point que plus il y a de créances à l’actif des banques moins il y a d’argent en définitive. J’emploie le terme argent mais je devrais employer le terme pouvoir d’achat.
Soit l’interprétation de Jorion où les banques ne créent pas de monnaie.
Admettons que j’ai 1000 euros sur mon compte, qui d’après l’argent mode d’emploi, est propriété de la banque.
Ma banque prélève 900 euros pour le prêter à un autre client, soit X.
Cependant, sur mon relevé de compte, il y a toujours bel et bien écrit 1000 euros.
N’y-a-t’il pas un faux en écriture ?
Non la banque reconnaît qu’elle vous doit 1.000 €. Ce qui n’est pas faux : c’est vrai !
Un courrier que je viens de recevoir à propos d’un commentaire modéré me révèle que plusieurs des intervenants qui contestent les billets de Jean-Pierre Voyer ne sont en réalité qu’une seule et même personne utilisant divers pseudos. L’« effet de masse » dans l’opposition est donc une tactique… et une illusion.
A Jean :
« Pourquoi un mécanicien SNCF a besoin de s’endetter?
Tout simplement parce qu’il ne produit pas assez de richesse par rapport à celle qu’il consomme. Rien ne l’empeche de consommer moins et mieux, ou d’apporter plus de valeur ajouté dans ce qu’il produit… »
Et si c’était tout simplement parce que sa rémunération est inférieure à la valeur qu’il produit ?
S’il demandait une rémunération supérieur il serait virer puis remplacer pr qqn qui travaille au même tarif.
Pourquoi?
Tout simplement parce que vous ne prendrez plus le train si les billets sont deux fois plus chers et que 100 000 chomeurs sont aussi qualifié que le mécanicien. (offre et demande…)
@ Louise 12 février 2010 à 13:01
Si des concurrents s’implantent, c’est bien qu’ils envisagent de gagner leur vie. On pourra comparer les salaires et avantages des uns et des autres dans quelques temps. En attendant le bilan SNCF ne semble pas extraordinaire, et l’actionnaire, si souvent décrié (dans ce cas c’est nous) n’est pas extraordinairement payé au détriment de ses employés.
http://www.ifrap.org/SNCF-bilan-et-avenir-du-systeme-ferroviaire-francais,0881.html
Paul Jorion
Dans la zone euro, les banques assurent 75 % du financement de l’économie (canal du crédit), contre 10 %, aux Etats-Unis où c’est le marché financier (canal des taux d’intérêts) qui finance à 90% de l’économie, les banques dans ce cas ne jouant qu’un rôle d’intermédiaire.
Rappel pour les lecteurs.
Le canal des taux d’intérêt:
Il existe, sur les marchés financiers, un grand nombre de taux d’intérêt, dont chacun correspond à une durée et une catégorie d’emprunteurs déterminés. On peut les représenter par une « courbe des taux », qui définit, pour une catégorie d’emprunteurs donnée, le taux des emprunts à chaque maturité (trois mois, six mois, un an, deux ans, dix ans…et jusqu’à trente ou quarante ans)
Le canal du crédit:
Tous les agents économiques, ménages ou entreprises, n’ont pas directement accès aux marchés financiers.
Beaucoup dépendent du crédit bancaire. Le canal du crédit bancaire est donc important pour la transmission de la politique monétaire. Ce canal est complémentaire de celui des taux. Les taux d’intérêt déterminent le coût des ressources que les banques se procurent sur les marchés monétaires (à court terme) ou financiers (à long terme). Ainsi, plus leurs ressources sont chères, moins les banques sont incitées à prêter et plus elles prêtent à taux élevé ; la demande de crédit, dans ce cas, diminue…
On a l’impression que vous ne tenez compte que du canal des taux d’intérêt, peut-être parce que vous avez vécu aux USA ?
PS: En ce qui me concerne il n’y a qu’un seul CHR
« »Ce qui est euphémiquement nommé, dans le schéma faux, « Crédit » est en fait le redoutable mot de « Créance » ce mot terrible qui amène un beau jour l’huissier à votre porte muni d’une reconnaissance de dette signée de votre main.
C’est alors » Mort à crédit »
Et il n’y a jamais eu qu’un seul Oppossùm
L’un dit
« Admettons que j’ai 1000 euros sur mon compte … Ma banque prélève 900 euros pour le prêter à un autre client … Cependant, sur mon relevé de compte, il y a toujours bel et bien écrit 1000 euros.
N’y-a-t’il pas un faux en écriture ? »
Il lui est répondu :
» Non la banque reconnaît qu’elle vous doit 1.000 €. Ce qui n’est pas faux : c’est vrai ! »
Je dirais que la banque fournit un « relevé » de ce qui a été déposé sur le compte, et ce relevé décrit ce qu’elle tient à votre disposition : allez donc les retirer ou les virer et vous constaterez qu’elle n’a rien prêté .
Si tout le monde allait les retirer ensemble en espèce , elle craquerait, mais pas parce qu’elle a particulièrement prêté le dépôt global, mais parce qu’elle n’a pas d’emblée dans ses coffre la valeur des dépôts , en billet sonnants et trébuchants.
Soyons cool : si par ‘devoir’ on entend ‘avoir à la disposition de’ , on peut admettre que la banque vous doit 1000.
Mais si on entend ‘devoir’ comme ‘devoir’ à la suite d’un prêt où l’on cède l’usage de la chose (ou la chose elle même) selon des modalités de durée, d’usage et de prix, alors c’est un abus de langage.
Sinon prêter et déposer seraient synonymes .
Je résume : La banque tient à ma disposition 1000 € .
Il est possible qu’elle ait prêté 900 € à Paulo . Il est même possible qu’elle lui ait même fournit les 1000 € de billets que j’ai déposés : je m’en fous car j’ai déposé une valeur et cette valeur est bien sur mon compte , d’ailleurs j’aurais pu déposer un chèque d’un autre client de la banque, donc de la pure valeur.
J’ai mes 1000 € en dépôt.
Paulo a ses 900 , mais s’il provenait de mon compte je devrais le voir indiqué : la comptabilité est bonne fille mais elle est impitoyable et ce qu’elle crédite d’un côté elle le débite de l’autre.
Je veux bien concéder que pour ses besoins de trésorerie elle utilise les espèces déposées par l’un, pour l’autre.
Je pose donc comme principe que Paulo n’a pas pris 900 € de mon compte : où les a-t-il pris ? C’est le problème de la banque , pas le mien. D’ailleurs je ne trouve aucune trace , nulle part, et à aucun moment de ce transfert.
D’ailleurs tant que la réalité du jeu des comptes à comptes et/ou bien des sorties et entrées en trésorerie pure ne s’est pas réalisé -si besoin était-, qui peut dire où se trouve cette monnaie ? Si ce n’est à la fois, au » travers » et « par » cette comptabilité elle même ?
Et lorsqu’elle s’est réalisee , du moment que les choses ont été ‘compensées’ correctement, qui peut alors dire ce qui s’est passé … sinon les comptes eux mêmes ?
Et ces comptes ne disent pas un prêt d’Oppossùm à Paulo.
Et qu’est-ce qui justifie de dire davantage, que « mon dépôt aurait été prêté à Paulo » , plutôt que « Paulo ‘considère’ à tort que la banque lui a prêté ma monnaie mais qu’en fait il n’en est rien » … et qu’au fond le prêt n’a pas eu lieu ? … (même si j’admets qu’il s’est bien « passé » quelque chose)
Je dirais même qu’il semble que Paulo ait été victime d’une illusion lui laissant croire que la banque lui aurait prêté ma monnaie.
Mais alors ? que s’est-il donc réellement passé … ? (suspens …)
Mais non ! Si vous les réclamez elle va se dire « Zut ! » et va devoir les trouver quelque part. Les vôtres, ça fait longtemps qu’ils sont dans la nature. Pourquoi diable les tiendrait-elle à votre disposition – ce n’est de l’intérêt de personne ? Et si votre compte est rémunéré, comment ferait-elle pour le rémunérer ?
Il y a chez ceux qui croient à la « création monétaire » par les banques commerciales, un mélange d’indignation devant ce « scandale » et en même temps un immense respect pour des institutions dont on imagine qu’elles se préoccupent avec philanthropie du bien-être de leurs clients. C’est plus simple que ça : ce sont des machines froides à faire de l’argent.
Sapir, sur Marianne 2, revient une fois de plus – et heureusement – sur la question de la dette, et DONC des intérêts.
La BCE prête à un « petit » taux (moins de 1%) et les banques reprêtent à un taux plus important. Pendant ce temps, on continue à se chamailler sur la « réalité » de la monnaie scripturale, est-elle une « vraie » monnaie, a t-elle les apparences d’une monnaie sans en être une. Pendant ce temps là, les grecs – et d’autres – vont crever.
Voilà ce qu’écrit, partiellement, Sapir:
La Grèce doit emprunter à 6%
Par ailleurs, pour aider la Grèce, il faudra bien que l’Allemagne et la France s’endettent un peu plus, et ce au moment ou l’on nous promet un nouveau tour de vis de rigueur budgétaire. En fait, ce sont les conditions de financement de la dette publique qui sont, aujourd’hui, l’une des causes principales de son augmentation.
Il faut en effet savoir que son augmentation est pour une large part due à ce qu’il nous faut emprunter à plus de 3% (3,45% en moyenne) alors que l’on n’attend pas, même dans les rêves les plus fous de Mme Lagarde, une croissance au-dessus de 2%.
Or, dans le même temps, les banques se refinancent auprès de la BCE (comme d’ailleurs auprès de la Réserve Fédérale américaine et des autres Banques Centrales des pays développés) à des taux oscillant entre 1% et 0,5%. Serait-ce du fait de la meilleure qualité des dettes privées par rapport à la dette publique ? Poser cette question, c’est y répondre, et par un immense éclat de rire. …
@Bruno Lemaire
Oui c’est préoccupant.
Pour le reste 0.5% ou 1% c’est pour des emprunts à court terme (quelques jours).
@CHR
beaucoup de court terme, cela finit par faire du long terme
Mais, vous avez raison, ce n’est pas pareil: donc le bénéfice est moins évident, cela « passe mieux » dans l’opinion.
@CHR: « Si, les deux banques ont fait augmenter de 200 le M1 scriptural soit un total pour l’exemple ci dessus de 400 M1 scripturale pour 200 dans la caisse des deux banques. »
On s’en fout du M1, c’est juste un indicateur statistique. C’est comme le PIB, il compte aussi les catastrophes, pourtant ça n’enrichit pas le pays.
« On s’en fou… »
Je vous ai expliqué de maniere précise pourquoi votre raisonnement était erroné selon moi. Je peux me tromper mais si j’ai faux il faut le démontrer sinon c‘est qu’en fait vous n‘avez rien à dire.
« Mais pendant des années ce système a bien fonctionné et les crédits accordés ont pu être remboursé avec les dépôts qu’ont généré ces mêmes crédits »
Vous connaissez cette blague juive sur les deux diamantaires Salomon et Moïse qui se revendent à chaque fois le même diamant par téléphone, chaque fois un peu plus cher?
A la fin, Moïse (qui possédait le diamant depuis le départ, lequel n’avait jamais bougé de chez lui) vend le diamant à un troisième et Salomon de s’écrier: « tu es fou de l’avoir vendu, un diamant qui nous enrichissait tant! ».
@Moi,
Tout est statistique, à ce compte là. Le fait que dans M1, il y a 85% de scriptural et 15% d’espèces, on peut s’en ficher aussi. Le fait que M1 soit passé, en 20 ans, de 26% à 45% du PIB, comme ni M1 ni le PIB n’ont d’importance, on s’en fiche aussi. Le fait qu’il y ait une croissance négative du PIB en 2008, avec pas mal de chômeurs en plus, c’est aussi une statistique. Je ne pense pas qu’il faille s’en foutre.
@moi
Vous vous en sortez avec une pirouette humoristique mais ce n‘est pas suffisant.
Votre position est peut être un peu délicate si j’en crois votre commentaire du 24 avril 2009:
« Moi dit :
24 avril 2009 à 09:43
@Paul Jorion: tout cet article me semble vague et je ne comprends pas cette notion de « véritable flux monétaire ».
A et B ont un compte dans la banque X
C et D ont un compte dans la banque Y
A achète un bien à C et le paie par carte de crédit.
D achète un bien à B et le paie par carte de crédit.
Les deux biens ont une valeur équivalente.
Où est le « véritable flux monétaire » puisque la banque X et Y vont se dire entre elles « on est quittes » lors de la compensation? La seule chose qui a eu lieu c’est un flux de créance de A(X) à C(Y) et de D(Y) à B(X).
En toute logique, les économistes disent qu’ici la monnaie scripturale a servi de monnaie pour les transactions A-C et D-B. »
Deux solutions:
Ou vous êtes de mauvaise foi ou vous savez aujourd’hui répondre à votre propre interrogation de l’époque.
En ce qui me concerne je partage toujours votre interrogation de l’époque donc peut on connaître votre explication d’aujourd’hui à votre problème d‘hier?
Si votre réponse est claire et logique, je m’incline.
@Bruno Lemaire: « Tout est statistique, à ce compte là. »
Non, tout n’est pas statistique. Le PIB, M1, les chiffres du chômage, ça c’est des statistiques. Et quand je dis que je m’en fous, c’est que les statistiques, c’est juste ça. On y met ce qu’on veut et on leur fait dire ce qu’on veut. La réalité c’est autre chose. Tenez, actuellement M1 et les autres baissent, cela signifie-t-il de la destruction d’argent? Non évidemment, cela signifie juste qu’on se rend compte qu’il n’y avait pas d’argent derrière ces chiffres. C’est comme si ces indicateurs comptaient les billets de loterie comme étant tous gagnants du gros lot. Puis, quand les boules sortent, on se réveille et y’en a plein qui ont juste un billet de loterie perdant, c’est-à-dire du vent.
@CHR: j’ai lu « l’Argent Mode d’emploi » et j’ai vu la lumière. Alleluiah! Gloire au Seigneur! Je vous conseille de faire de même. Plus sérieusement, la monnaie scripturale peut servir de monnaie, effectivement. Mais cette monnaie n’est pas de l’argent, elle doit être convertible en argent. Un échange de reconnaissance de dettes, en fait de la monnaie, mais ce n’est pas un véritable flux monétaire. Lisez le bouquin, c’est mieux expliqué que je ne saurais le faire et cela m’évitera de la fatigue.
Paul,
» Je résume : La banque tient à ma disposition 1000 €.
Mais non ! Si vous les réclamez elle va se dire « Zut ! » et va devoir les trouver quelque part. Les vôtres, ça fait longtemps qu’ils sont dans la nature. Pourquoi diable les tiendrait-elle à votre disposition – ce n’est de l’intérêt de personne ? Et si votre compte est rémunéré, comment ferait-elle pour le rémunérer ? »
C’est vrai que je n’ai pas été précis dans le « réclamez » :
– Si je le réclame en espèce , oui elle dit ‘zut’ ma banque , car la monnaie fiduciaire lui coûte.
– Si je les lui réclame en lui demandant d’assurer un virement sur le compte d’une autre banque, elle dit encore un peu ‘zut’ , mais suppose que statistiquement elle ne fera que de la compensation : c’est nettement moins chère .
– Si le virement est fait sur un compte à la même banque , elle se contente de noter , c’est gratuit.
En fait ‘tenir à ma disposition’ est un peu trompeur : c’est une vieille formule du temps où la défiance naturelle dans le signe monétaire était équilibrée par l’engagement du bien économique lui-même qui tenait lieu de monnaie , à savoir l’or (ou autres …)
A présent , cela signifiera plus simplement que ma banque s’assure de me fournir un peu de fiduciaire pour mon pain, et qu’elle assure les virements que je lui ordonne (et même si la monnaie scripturale n’a pas entièrement cours forcé, la justice la considère bien , du moment que le transfert de valeur est noté sur les relevés, comme un paiement réalisé)
Que demander d’autre à ‘tenir à ma disposition’ ? Je ne peux pas exiger la chose ou le service lui même ou bien un container de valeur indestructible . Le reste n’est que ‘trésorerie’
Bref , derrière le ‘tenir à ma disposition’ , il n’y a rien , rien du tout , (ou bien un concept philosophique de monnaie) , sinon une comptabilité qui est la monnaie elle-même ! (sous forme de chiffres calibrant et représentant la ‘valeur’)
(Je ne parle plus du support , éventuellement les espèces qui ont pu être déposés et qui sont, elles, effectivement utilisés à autre chose, puisque la banque vous les a transformé en Sa Monnaie sur votre compte.)
Quant aux intérêts éventuels que les banques concèdent aux dépôts, leur financement est largement assuré par l’aisance que leur donne beaucoup de dépôt par rapport aux autres banques, et par les nombreux prélèvement divers qu’ils s’autorisent à faire pour des tas de motifs, et dont vous savez qu’ils constituent, en temps normaux, une très grosse partie de leur bénéfice ! Bref , pas ‘besoin’ de faire travailler les dépôts (comme je l’ai longtemps cru)
PS/ Et je me demande -mais là je vais beaucoup plus loin- (mais je n’en suis pas sûr) si l’idée de Bayard de monnaie stockée dans des dépôts-parkings n’a pas une certaine pertinence.
Je ne dis pas que l’encours dormant des dépôts , ne soit pas un stock de monnaie qui ne servirait pas … mais je ne vois pas comment , car ce stock , et J. Bayard le dit , je crois, aurait besoin d’une re-création monétaire pour exister et circuler à nouveau : mais là entre ces deux stock de valeur , il y a un néant comptable, donc un néant de règles, donc la liberté de faire et dire ce qu’on veut . Ou d’imaginer ce qui pourrait ou devrait être. Une sorte de duplication par sublimation de la valeur (… ne respectant que très approximativement un principe de conservation des valeurs 😉 ? )
@ Paul Jorion
« ..les banques commerciales,……ce sont des machines froides à faire de l’argent. »
ce terme de » faire » recouvre quoi exactement , d’où va sortir cet argent ?
vous faites allusion à quel mécanisme ?
merci de votre réponse
« Faire de l’argent », c’est une expression française qui veut dire « gagner de l’argent », « rapporter ». « Faire » ne veut pas dire ici « fabriquer ».
Dans ce cas-ci : « les banques sont des machines froides à faire de l’argent » veut dire : « les banques rapportent de l’argent à leurs propriétaires, actionnaires, dirigeants ».
La phrase « les banquiers font de l’argent » veut dire « les banquiers sont riches ». On peut imaginer qu’une personne peu familière avec l’expression « faire de l’argent » ait cru que cela voulait dire : « les banquiers fabriquent de l’argent ».
Bon, reprenons!
Progressons-nous?
1)Tout d’abord, comme le dit Paul aussi, le billet de la BCE n’est en aucune façon une dette, c’est une dotation « régalienne »!
Sa couverture est ce que je peux acheter avec, et la Banque centrale veille autant qu’elle peut à la stabilité de son pouvoir d’achat sans y parvenir parfaitement. Ce qui est trompeur, c’est le taux Refi qu’applique la BCE, car ce n’est pas vraiment un taux d’intérêt coimme le taux monétaire du marché, mais un instrument de politique monétaire pour établir au mieux la quantité de monnaie centrale à émettre; en baissant, le refinancement central est plus facile et la quantité augmente en principe, et inversement.
2)Le prêteur achète en moins ce que l’emprunteur achète en plus. A partir de là, il est techniquement impossible d’imaginer une augmentation de la quantité de monnaie faisant demande de biens, services et biens d’équipement par le biais du crédit. Ce qui revient à dire que les banque ne peuvent en aucune façon augmenter la quantité de monnaie circulante sans faire appel à la banque centrale!
3)Les « monétisations », s’agissant des prises en pension à la banque centrale, peuvent effectivement augmenter le numéraire circulant, mais les conditions sont plutôt draconiennes. Les autres « monétisations » sur le marché des capitaux ne sont que des actions d’achat-vente qui n’augmentent en rien la quantité circulante.
4)La monnaie effectivement circulante est le revenu, c’est-à-dire les sommes qui reviennent en circulant. Il est vrai que très peu de billets suffisent, car les techniques bancaires opèrent des règlements via les virements. Mais dans ce cas aussi, une somme est toujours attribuée à un seul détenteur à la fois, et un achat par virement implique une baisse du compte de l’acheteur et une hausse de celui du vendeur jusqu’à ce que le vendeur achète à son tour à un tiers. Là aussi, aucun mécanisme ne peut montrer, ni avec une banque ni avec mille du système bancaire, que la masse circulante augmente. On peut juste admettre que les techniques bancaires sont pratiques et augmentent, surtout à distance, la disponiilité de l’argent, donc une meilleure circulation, mais rigoureusement sans aucune augmentation d’argent circulant.
5)Le dysfonctionnement est causé par l’insolvabilité croissante des débiteurs, ce qui veut dire en clair que les créanciers ne peuvent pas récupérer les sommes prêtées! Pour « garder » leur confiance, la banque centrale a dû émettre des quantités colossales de monnaie centrale comme « couverture » d’une dette irrécupérable!
6)Or, jsuqu’à 90% de la monnaie liquide ne circule plus du tout, car elle est thésaurisée: Ces chiffres ont été publiés par la Bundesbank en juin 2009, je n’invente rien!
7)La raison de ce dysfonctionnement est le fait que la monnaie liquide est bien la valeur refuge ultime, et pour qu’elle revienne encore un tant soit peu en banque pour circuler encore (10% en valeur de cette masse, esentiellement les coupures de 5,10,20, et 50 euros – les billets de 100,200 et 500 euros dorment et sont totalement inutiles à la circulation, on ne le voit pratiquement jamais!), les banques proposent un intérêt aux épargnants, afin de pouvoir prêter ensuite aux emprunteurs un peu plus cher. La capacité de sollicier un intérêt pour que la monnaie circule simplement (ce qui est quand même sa seule raison d’être) se répercute sur toutes les promesses de liquide que la banque engage auprès des épargnants et aussi sur toutes les promesses qu’engagent les emprunteurs auprès des banques. C’est pourquoi les comptes d’épargne sont rémunérés, sinon: big problem et retrait liquide massif!
8)Le fait que le billet peut être thésaurisé est bien la racine de l’intérêt et donc du capitalisme. Cette mécanique obtient inéluctablement que les fortunes épargnées grossissent symétriquement avec avec les dettes selon une croissance exponentielle, et le résultat en sera toujours une crise systémique dès que trop de débiteurs deviennent insolvables inéluctablement.
9) La seule issue possible de cette impasse serait supprimer la possibilité de la thésaurisation en imprimant aux billets une date limite comme aux yaourts, et nous n’aurions plus alors ni intérêt monétaire ni crise systémique, mais nous aurions une économie de marché sans crise possible!
Petit problème de calcul
Comment est calculée la compensation multilatérale ? Supposons qu’il y ait 500 banques en France. La compensation multilatérale de ces 500 banques qui semble un problème très compliqué est en fait très facile. La compensation multilatérale est effectuée par 499*500 (soit 249 500) compensations bilatérales. Le programme de la machine qui exécute ce calcul doit tenir sur une page de 70 lignes. La machine doit effectuer ce calcul en quelques seconde. Ils ne faut pas se fier aux apparences.
Hum, le programme informatique peut même bcp plus court que 70 lignes (en fonctionnant par récursivité, comme le sait évidemment Paul Jorion et tous ceux qui ont un peu « touché » aux langages informatiques)
Sur la compensation multilatérale, je ne sais pas si cela se passe ainsi: mais, avec 500 banques, il y a un tout petit plus 😉 que 500 fois 499 échanges. B.L.
La question semble interessante, j’espère que nous ne serons pas déçus par la réponse!
Bruno Lemaire
Sur les taux: 1000 Euros prêtés à 1% à échéance d’une journée et réempruntés pour le jour suivant au même taux et ceci pendant un an ça coûte énormément plus cher que 1000 Euros prêté à échéance d’un an à 6%, non?
Pour traiter la compensation de 500 banques il suffit de deux tableaux de 500 lignes et de 500 colonnes. Toutes les banques sont remettantes et tirées. Sur la ligne… 15 par exemple, la banque remettante n° 15 dépose sur la ligne N° 15 dans les colonnes des banques tirées, ses créances, par exemple colonne(23)=colonne(23)+créance n°1.123.456 ;
colonne(125)=colonne(125)+créance n°1.123.457 ; colonne(498)=colonne(498)+créance n°1.123.458, etc. et ainsi pour toutes les banques remettantes de indice 1 à indice 500 ;
Après trois milliards six cent mille et trois transactions traitées, il ne reste plus qu’à additionner les cases d’une même ligne d’une part et les cases d’un même colonnes d’autres part pour obtenir, pour chaque banque sa position remettante et sa position tirée, et donc sa position par simple soustraction des totaux.
On a également la position de chaque banque par rapport à chaque banque dans un second tableau de même dimension en soustrayant par exemple tableau(ligne15, colonne472) et tableau(ligne472, colonne15) et en reportant positif, nul ou négatif (avec un changement de signe évidemment pour l’une des banques) dans le deuxièmes tableau où les nombres ne sont plus seulement des nombres réels positif + zéro, mais réels positifs ou négatifs ou zéro, selon le résultat de la soustraction.
Ça marche encore avec un trillion de transactions.
JPV
Je confirme: il y a bien n(n-1) compensations bilatérales. Vous avez encore une fois « parcouru » ma note et vous avez confondu compensation bilatérales (entre deux banques) et transactions de 0… à un milliard.
JPV
Je précise encore: il y a nécessairement moins que 500*500 compensations bilatérales puisqu’il n’y a que 500*500 cases dans le tableau. Et le nombre des compensations est donc de (500*500)-500 cars jusqu’à nouvel ordres une banque ne se compense jamais avec elle-même.
JPV
L’usage, en programmation, est de donner aux variables des « armoiries » parlantes. Ainsi, j’appellerai le premier tableau flux_brut( , ) et le second flux_net( , ). Je fais d’une pierre deux coups.
JPV
Une dernière, monsieur, puisque vous me cherchez: la récursion amuse beaucoup les étudiants puisque un tri Hoare-Sedgevic s’écrit en trois lignes au lieu de trente, mais dans l’industrie les fonctions récursives sont déconseillées car il y a toujours un risque de saturation de la pile, ce qui peut être gênant pour un aéroplane. Ensuite, un tri Hoare est beaucoup plus rapide sous sa forme itérative car les empilages-dépilages (les appels de fonctions et retour) consomment du temps machine. Enfin il est un théorème qui dit que toute fonction récursive peut être écrite sous forme itérative tandis que l’inverse n’est pas vrai. D’où, en pratique, le peu d’intérêt des fonctions récursives.
JPV
J-P Voyer
c’est trés interessant tout ça mais c’est pour démontrer quoi dans le problème qui nous occupe?
Bruno Lemaire pardon pour ma remarque sur les taux, j’ai écrit une bêtise comme on me la fait remarquer les taux sont annualisés.
@ P.Jorion
merci de votre réponse…
soit , vous dites donc : « les banques rapportent de l’argent à leurs propriétaires… »
cet argent qu’elles « rapportent » , sachant que votre thése est qu’elles ne le « créent » pas , elles le « rapportent » d’où , dans la mesure où elle se doivent de respecter une « balance nulle » vis à vis de leurs clients (emprunteurs-épargnants).
c’est ce mécanisme auquel je fais allusion dans ma question quelque peu « naïve » , j’en conviens .
cordialement
@sentier198
D’où ?
Mais de l’exploitation des richesses, de l’exploitation des salariés, de l’exploitation des consommateurs, et de la dette des états !
Joli système de vases communicants, n’est-ce pas !
@ Martine Mounier
certes , mais ce n’est pas ma question…..
ma question est : où figure cet argent sorti de l’économie pour être thésaurisé?
que peut-on nommer dans tout ce fatras ?
de quels moyens dispose-t-on pour dire , il est « immobilisé là » , et, » parce que tel mécanisme a été utilisé. »
pourquoi utilise t-on toujours des solutions indirectes pour essayer le mobiliser (avantages fiscaux , inflation organisée , monnaie fondante ,voire changement de monnaie…) ?
@ Johannes Finckh
vous dites :
« ….La seule issue possible de cette impasse serait supprimer la possibilité de la thésaurisation.. »
vous n’allez pas me faire croire que vous croyez vraiment que la solution à ce problème réside dans une mesure touchant à la simple « forme » (du papier « fondant »).
le rapport de l’être humain à la perte sera un formidable levier qui poussera certains (particulièrement en difficulté du fait d’une structure psychologique que vous savez identifier) à imaginer d’autres solutions pour « contourner » cet obstacle à l’accumulation.
les temps historiques que nous traversons ne sont plus à « rapiécer » un système par des « rustines » aussi élégantes que possible et les « méthodes » de Gesell le sont.
il s’agit d’imaginer , créer autre chose concernant les rapports humains …les méthodes d’organisations sociales , dont fait partie la circulation des signes d’échanges (la monnaie….) viendront d’elle-même , après.
merci de votre avis.
cordialement
à sentier,
Je rappelle: 90% est thésaurisé déjà!
Si, effectivement, la monnaie ne pouvait QUE circuler, je ne vois pas quel autre objet serait en mesure de bloquer les échanges d’une façon aussi efficace que la monnaie liquide elle-même!
l faut tout de même se représenter le fait que le billet est émis pour … ne pas circuler!
Comment allez-vous résoudre une énormité aussi massive?
La correction gesellienne paraît « mince », mais, en fait, elle va très loin, car, elle heurte une mentaité pluseurs fois millénaire!
Dites-moi donc plus précisément ce qui vous vient à l’esprit quand vous déclarez quil y aurait d’autres moyens de « contourner » l’obstacle de l’accumulation!
Vous évoquez le rapport à la « perte », en fait, la perte est bien au coeur de l’expérience de la vie qui passe, évidemment!
Or, la perversité du signe monétaire comme a-temporel et sur la face duquel la perte n’est pas répercutée – sa valeur nominale est fixe- ne pourra jamais engendrer des échanges équitables et installe d’emblé le capitaliste (celui qui a trop d’argent) en position de force, en position de faire chanter l’emprunteur et de lui extorquer l’intérêt, la vraie signification de la dite plus-value de Marx.
Tant que cela sera ainsi, la perversité du capitalisme subsistera, car toute l’économie capitaliste est une déformation perverse qui désorganise de plus en plus les échanges économiques possibles.
Cela touche aussi au fait que le marché est autre chose que le capitalisme et que nous vivons dans un système de marché soumis à la contrainte capitaliste. Je maintiens qu’une correction de l’émission du numéraire pourvu d’une date limite par exemple avec un échange payant du numéraire et restitution de la masse au niveau central serait LE moyen d’en finir avec le capitalisme!
Le fait est que c’est vraiment aussi simple que cela, et le vrai scandale est le fait que les économistes ne comprennent décidément pas le fonctionnement de la monnaie parce qu’il est trop simple!
Il n’y a pas plus aveugles que ceux qui ne veulent pas voir et qui nient jusqu’à lévidence, et qui sont de la plus parfaite mauvaise foi – que le capitalisme, ce n’est que ça!
C’est comme nier que la terre est uns sphère qui décrit une orbite autour du soleil, afin de « bétonner » encore le système du disque terrestre et de la sphère célèste, beaucoup plus compliqué et totalement dépassé et évidemment faux! Les économistes en sont toujours là!Et la croyance délirante à la « création de monnaie via le crédit » prouve qu’ils croient toujours au père Noël!
J-P Voyer dit:
Les crédits font à la fois les dettes de l’emprunteur ET les dépôts en banque. Sans oublier que ce qui est dette pour l’un est créance pour la contrepartie, c’est les deux faces de la même chose. Quand la banque accorde un nouveau crédit, il y a quatre « choses » créées. Pour la banque, la créance sur l’emprunter ET le « dépôt » temporaire de l’emprunteur correspondant, lequel « dépôt » sera dépensé par voie scripturale et donc obligatoirement re-déposé par le vendeur du bien acheté par l’emprunteur. Les deux autres autres « choses » créées sont l’autre côté du miroir, la situation du point de vue de l’emprunteur (une dette) et du vendeur (un dépôt obligatoire). On peut se demander à l’infini ce qu’est la monnaie pour une banque : une dette (au passif: DAV, dettes interbancaires, obligations…) ou une créance (à l’actif: créance sur les clients, interbancaires et … même sur la BC à savoir les réserves). La monnaie pour une banque, c’est les deux à la fois, votre honneur: dette ET créance. L’un ne va pas sans l’autre.
Dans À propos de « La monnaie – Schémas d’écritures » de Jean Bayard, par Jean-Pierre Voyer, J-P Voyer dit:
Mais les trésoreries des entreprises et particuliers bougent, elles! Quand un particulier paye par virement sa facture d’électricité n’est-il pas quitte? EDF pourrait-il se retourner contre son client si la banque d’EDF faisait faillite par la suite? Non, bien sûr! Le client a irrévocablement payé, à EDF de se débrouiller avec sa banque à lui. Ces paiements sont donc bien « réels » pour ce qui concerne les entreprises et particuliers. En quoi la trésorerie d’une banque serait à ce point différente de celle d’un particulier ou d’une entreprise? Simplement parce qu’on refuse de reconnaître qu’un DAV et un prêt interbancaire est de la monnaie (scripturale càd privée) pour les banques alors que tous les autres agents l’utilisent quotidienement pour payer?
Après tout, si seule la monnaie de BC était du bel et bon « argent », alors les entreprises et particuliers n’auraient aucune trésorerie du tout (à par les caisses). Tous leurs DAV ne seraient que des créances sur les banques, mais des créances tellement particulières qu’elles servent de moyen de paiement dans 99,9999999% des cas.
Pour moi, un billet de banque ou une pièce, n’est qu’une forme, une représentation de monnaie qui a certes un status différent, mais n’est utilisé que pour une part minusculissime des paiements. C’est lui accorder bien trop d’honneur que de se limiter à cette définition. Ce sont des « reliques barbares » au même titre que l’étaient l’or et l’argent anciennement. Il y a encore des fétichistes « en faveur du solide, du tangible », mais Coyotte Will est déjà au dessus du vide. 😉
Reconnaissons que la très grande majorité de la monnaie et des paiements est sous forme scripturale et ne sort jamais du système bancaire. Et reconnaissons surtout que les banques commerciales ont capturé, accaparé un quasi monopole sur la monnaie telle qu’on l’utilise en très grande majorité, à savoir sous forme de monnaie scripturale, càd privée. Vu les réserves et ratios minusculissimes, les BC ne pèsent presque rien face aux banques commerciales qui jouissent d’un immense effet levier.
Espèces = 15% monnaie scripturale = 85% (relativement à l’agrégat statistique M1) On en revient toujours à cela (plus au fait que 95% des « vraies » transactions – en valeur – se dénouent « en scriptural »).
@ J-P VOYER
a propos de calcul..
j’avais déjà évoqué içi il y a quelques mois à propos de « cavalerie » , la nécessité de sortir d’une approche arithmétique (comptable) et de passe à une approche algébrique …
j’ai écris ce truc sur un autre site :
………………………………………..début du commentaire………………………..
quand X. dit « l’emprunteur dépense en plus ce que le prêteur dépense en moins, là aussi »…
aspect synchrone : quand est-il lorsque le préteur a , lui-même , emprunté pour le prêter (en espérant jouer sur les taux ,peut-ètre mais peut-ètre autre-chose) ?
c’est pour celà que j’évoque souvent les fonctions récursives.
c’est comme cela que fonctionne les machines de Ponzi,à l’extrème.
au niveau x , un préteur prète q=f(x) à un emprunteur .
au niveau x+1 , l’emprunteur prète lui même q’=f(x+1).
si f(x+1)=f(x)-i (i=interet) , on a quelque-chose qui ressemble à une récursive…
il faut intégrer le temps dans i : i=it(t)
et définir f(0).
{bon , c’est juste une image , comme l’ampli de tout à l’heure..}
vous-échappe-t-il que l’on ne voit pas grand monde poser ce problème de la monnaie de façon formalisée , ce qui pourtant devrait pouvoir permettre de savoir où ca passe ,comment ca fonctionne et de se confronter à une réalité..
prendre un peu de distance avec la passion.
c’est comme cela que cela pourrait devenir réfutable et éventuellement vérifiable.
………………………….fin du commentaire
qu’en pensez-vous ?
à fujisan:
Vous n’avez toujours pas compris que c’est le revenu qui achète – et son bénéficiaire n’achète à nouveau que quand ce revenu lu « revient » à nouveau.
En toute simplicité, comme je l’ai toujours écrit, c’est bien le revenu disponible qui fait fonction de monnaie circulante, évidemment, car c’est ce revenu qui achète les marchandises et les biens d’équipement, etc.
La monnaie liquide n’est est qu’une petite partie, car les règlements par virement sont devenus sûrement majoritaires. Ceci dit, en tant que « promesses » de tant de monnaie en billets sur simple demande du titulaire du compte, la monnaie fiduciaire centrale garde son côté « clé de voute » du système sans laquelle tout s’effondre, c’est simple, non?
Et il est clair aussi que les variations au niveau du numéraire ont un impacte fort que l’on constate dès qu’il viendrait à manquer et que la banque centrale cempensera toujours autant que possible, y compris en injectant des centaines de milliards non destinés à circuler mais à être thésaurisés – pour rassurer les épargnants – créanciers face à des des créances irrécupérables!
A quoi ça sert, toutes ces masses créées et destinées à être ainsi inutiles?
Le système est bel et bien grippé à cause du fait que la monnaie liquide est largement destinée à ne pas circuler! Et les banques, en un sens, en nous habituant à fonctionner largement par virements, « sauvent » ce qui peut être en diminuantla proportion du numéraire circulant – mais cela donne encore plus dimpact aux variations de sa masse circulante.
jf dit : Ceci dit, en tant que « promesses » de tant de monnaie en billets sur simple demande du titulaire du compte, la monnaie fiduciaire centrale garde son côté « clé de voute » du système sans laquelle tout s’effondre, c’est simple, non?
Bravo, vous démolissez vos propres idées sur la monnaie fondante! Il n’y aurait selon vous aucune monnaie qui puisse exister sans ces « reliques barbares » que sont ces vilains bout de papier? Sous quelle forme pensez vous que Hebecker ou Unterguggenberger introduiraient aujourd’hui leur monnaie fondante? Des vilains bouts de papier ou des cartes électronique (scripturale) bien plus pratiques? Il y a bien les Chiemgauer qui utilisent un vilain bout de papier comme support. Mais voyez le SOL. Et aussi le système WIR, une monnaie scripturale privée utilisée en Suisse depuis 1934. Etc.
Vu que l’on n’achète qu’au présent les biens, services et biens d’équipement réellement existants, il est tout à fait exclu que la masse monétaire varie au présent via le crédit bancaire, car nous aurions alors des variations de prix très fortes, inflationnistes et déflationnistes, ce qui n’s manifestement pas le cas! Car un même bien pourrait être demandé sinon par plusieurs ayants droits, celui qui porte le billet et celui qui paie par CB etc. Or, c’est l’un ou l’autre toujours.
Et: l’emprunteur achète bien à la place du prêteur qui, parce qu’il prête, achète moins!
Elémentaire, non?
Ah, cette circulation monétaire…
Pour Johannes, seule l’épargne – les économies de l’un – font les crédits – les dépenses de l’autre. Elémentaire, n’est ce pas…Ce postulat a la vie dure, même face aux faits.
@jf
Vous n’avez toujours pas compris que c’est le revenu qui achète – et son bénéficiaire n’achète à nouveau que quand ce revenu lu « revient » à nouveau.
Vous oubliez une dimension essentielle dans le crédit : le temps.
Vu que l’on n’achète qu’au présent les biens, services et biens d’équipement réellement existants…
Et les avances alors? Quand on contracte un prêt pour financer la construction d’une maison, ça ne financerait pas la construction d’un bien qui n’exiterait pas sans ce prêt? Les revenus des entrepreneurs, artisants, marchands de matériaux… qui construisent cette maison ne seraient-ils pas inexistants sans ce prêt? Idem pour une entreprise qui contracte un prêt pour investir et se développer.
Quand aux services c’est encore plus évident. Par nature, un service est « créé » et « consommé » sur l’instant. Ce n’est pas un bien que vous prenez sur l’étagère du supermarché pour le mettre dans votre caddie! Si vous arrivez à « défaire et revendre » votre opération chirurgicale ou l’entretient de votre voiture, je vous tire mon chapeau 😉
il est tout à fait exclu que la masse monétaire varie au présent via le crédit bancaire, car nous aurions alors des variations de prix très fortes, inflationnistes et déflationnistes, ce qui n’s manifestement pas le cas!
Zut alors. Je dois me tromper, moi qui croyais que la bulle immobilière était justement alimentée par un excès de crédit.
Car un même bien pourrait être demandé sinon par plusieurs ayants droits, celui qui porte le billet et celui qui paie par CB etc. Or, c’est l’un ou l’autre toujours.
Ici vous parlez demande. Vous oubliez qu’il n’est pas nécessaire que l’argent soit déjà sur la table ou dans votre poche pour que la demande s’excerce. Vous n’avez pas répondu à ce post.
PS Concernant la remarque de PJ, j’ai oublié de préciser que j’ai toujours posté sous le même pseudo.
Les avances? Je maintiens mon point de vue, évidemment! pour construire une maison, le prêt préfinance évidemment cette maison-là, maios, en même temps, le prêteur n’a pas pu utiler les fonds pour autre chose, car il finance bien cette maison et le travail actuel! Quant aux ouvriers qui créent en bâtissant, il ne font pas autre chose pendant ce temps-là, par exemple, ils bricent chez eux seulement les weekends.
quant au chirurgien, c’es t même chose. Penda
Pendant qu’il ouvre mon ventre, il n’ouvre pas le vôtre!
C’est ainsi pour tous les services! Quan un service est payé, ce n’est pas un autre qui, alors, ne se fait pas en même temps.
C’est comme au supermarché, quand il n’y aplus de sucre, on ne peut l’acheter!
Quant à la bulle immobilière comme toute bulle, cela ne prouve rien d’autre que davantage de liquidités arrivent sur ce marché et d’autant moins ailleurs.
Une transaction ne se fait que contre un réel échange d’argent sous forme liquide ou par virement. Tout le reste est littérature et fanatisie. On peut bien supposer ou « anticiper » une demande sans en avoir les fonds, mais l’échange ne se fait qu’au présent, ou ne se fait pas.
Quant à la dimension du temps, vous pensez bien que je ne l’oublie jamais et moins que personne! Justement, c’est cela qui me fait insister sur le présent.
Un projet qui se réalise ou qui sera réalisé dans le futur implique toujours qu’un autre ne se fait pas et, qu’au présent, je détourne les fonds nécessaires pour les orienter en n’achetant justement pas autre chose. Ainsi, un père de famille renonce au voyage des vacances quand il cnstruit sa maison.
Crire que le crédit finance l’avenir est une absurdité matérielle, le crédit oriente sans doute en réalisant des projets à la place d’autres.
Anticiper une croissance n’est qu’un voeux pieux, elle se réalise, elle aussi, seulement quand tous travaillent un peu plus et quand la banque centrale accompagne ce mouvement avec les moyens nécessaires, ce qu’elle fait évidemment.
Or, malgré tous les moyens « avancés », nous ne sommes plus en croissance, justement parce que nous avons davantage de chômage. Et ce chômage résulte du fait que l’argent avancé ne l’est qu’en apparence, car il circule beaucoup moins bien, et la moindre circulation a aussi un effet déflationniste. C’est cela qui produit aussi les énormes thésaurisations (où sont les billets de 500 euros dûment émis pour près de 200 milliards d’euro par la BCE?), et cet argent qui ne retourne pas en banque ne financera aucun crédit. Tout ce que ni le détenteur du trésor ni l’emprunteur n’achètent donc pas est ce que l’on appelle de l’invendu, éventuellement sollicité par de l’argent nouvellement émis, mais pas forcément. L’argent nouvellement émis nourrit surtout la spéculation, moyen de rtirer davantage de liquidité de la circulation économiquement efficace.
@ Johannes FINCKH
« …Dites-moi donc plus précisément ce qui vous vient à l’esprit quand vous déclarez quil y aurait d’autres moyens de « contourner » l’obstacle de l’accumulation!… »
absolument rien , car je ne suis pas particulièrement « angoissé » à l’idée de manquer , de perdre ,de mourir ….
j’interroge l’histoire humaine pour constater l’imagination dont il a fait preuve encore récemment pour « contourner » les règles , les lois , les limites afin de continuer à thésauriser.
j’interroge mon expérience de la subjectivité humaine , pour en arriver à considérer avec vous que « …Il n’y a pas plus aveugles que ceux qui ne veulent pas voir et qui nient jusqu’à l’évidence, et qui sont de la plus parfaite mauvaise foi …. »
reste la question de définir les mauvais objets .
car vous dites : « …serait LE moyen d’en finir avec le capitalisme!.. » ,peut-étre,
mais pourrez-vous en finir ,de cette manière, avec notre angoisse du manque ?
de notre tendance à accumuler ?
de notre tendance à construire des dispositifs pour contourner les règles anti-cumuls?
non , vous le savez bien.
je ne sais pas si je vous éclaire sur mon point de vue…
cordialement.
Merci à sentier d’accepter ce débat, j’y réponds très volontiers.
Il ne me semble pas avoir trouvé à redire contre le fait de « thésauriser » au sens où chacun doit être laissé libre d’accumuler ce qu’il veut, sauf une chose, à mon sens, le signe monétaire lui-même. Car le signe monétaire a, en pricipe’ une seule raison d’être pour être signe monétaire justement, c’est celui de CIRCULER, d’aller de main en main.
En toute rigueur, un signe monétaire qui ne circule pas n’est plus du tout monnaie mais un objet de collection. Mais en détournant la monnaie liquide de la son usage circulant, la vie économique est gravement endommagé!
Accepter un signe monétaire qui circule peu et mal c’est comme construire des routes interdites à la circulation des citoyens! Vous saisissez l’enjeu? Nous nous offrons le luxe d’avoir un signe monétaire « mal fichu »!
Un signe monétaire thésaurisable est une perversité sans nom, et c’est bien la racine du capitalisme qui nous asservit depuis si longtemps.
Finir avec le capitalisme suffirait amplement à mon bonheur. Quant à l’angoisse du manque en général, notre tendance à accumuler, je ne m’y oppose en rien, j’aaurais même tendance à l’encourager pour tout ce qui n’est pas le signe monétaire lui-même, ca cela n’entrave en rien la vie économique, bien au contraire, cela motive.
En clair, le problème n’est absolument pas comparable d’accumuler des lingots d’or ou des signes monétaires, évidemment, car l’accumulation de tout autre bien libère au contraire le signe monétaire qui, lui , ne circulera que mieux dès lors.
Je crois, par contre, que des limitations, déjà existantes mais que l’on pourrait sans doute améliorer, pour la propriété foncière agricole ou en terrains à bâtir devraient être maintenues, des taxes par exemple, car une pénurie générée dans ce domaine aurait des conséquences sociales délicates.
Mais, principalement, résoudre l’équation du problème posé par le capitalisme en instituant un signe monétaire qui circule mieux, c’est déjà pas si mal, non?
@ johannes finckh
ok, sur le signe monétaire qui doit circuler…pour étre efficace
bien entendu que si l’on consomme , la monnaie va circuler…..car comme vous le dites « l’accumulation de tout autre bien libère au contraire le signe monétaire.. »
mais en quoi un usage de la monnaie « fondante » par exemple va empêcher que certains accumulent des biens ( lingots d’ors , bien immobiliers , ressources en matières premières indispensables , outils de production , moyens de communication , services divers (santé,éducation…) …etc ….et ainsi » maitriserons » les prix des biens et des services ) au détriment de l’intérêt général ?
quel sera son impact également sur le niveau des salaires ? ou plutôt la répartition revenu du capital-revenu des salaires ?
j’ai une idée de ce qu’est le Capitalisme qui semble-t-il n’est pas identique à la votre , c’est peut-être là la difficulté.
je ne le réduit pas à la thésaurisation de signes monétaires , mais à la propriété privée des moyens de production macroéconomique , à la capacité de faire du profit avec le capital ainsi possédé …
c’est l’extension du Capitalisme sous sa forme néo-libérale imaginée par l’homme depuis un bout de temps (mais surtout avec la « flambée » de la mathématique appliquée (Nash et cie) survenue après la seconde guerre mondiale) qui a permis d’utiliser les produits financiers comme capitalisables.
ils risquent tout simplement de s’autodétruire dans les quelques années qui viennent…c’est déjà ca…..
enfin , face à la catastrophe écologique et énergétique qui nous guette , vous voir écrire « »…..notre tendance à accumuler, je ne m’y oppose en rien, j’aurais même tendance à l’encourager pour tout ce qui n’est pas le signe monétaire lui-même, ca cela n’entrave en rien la vie économique, bien au contraire, cela motive. » , je ne partage pas votre « consumérisme » , à moins que tout simplement j’interprète mal vos propos.
pour ma part , ce n’est pas le Capitalisme Formel qui me pose le plus de problèmes , mais c’est le fait que de nombreuses personnes ayant compris qu’il est possible de « motiver » l’être humain à consommer en utilisant cette « fragilité » qu’est l’angoisse du manque , de la perte , en ont fait un véritable business très lucratif , pour le moment .je pense ,par exemple ,à :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays
au plaisir de débattre
cordialement
à sentier: justement, il n’y a, comme moyen premier de mobilieser les fonds thésaurisés actuellement, que l’intérêt proposé à celui accepte de ramener les fonds en banque.
Et c’est cela qui génère le capitalisme. Il s’agit, là aussi, d’un « moyen indirect », mais est spécialement source de problème.
La dite « monnae fondante » dont j’ai souvent exposé le fonctionnement, serait un signe monétaire différent, carrément non thésaurisbale sans risques sérieux pour celui qui s’y risque. Ce signe monétaire que je rebaptise maintenant signe monétaire marqué par le temps (SMT) en le distinguant de l’actuel signe monétaire durable (SMD), serait en fait une « monnaie directe » et « purifiée », car uniquement circulante, d’où sa remarquable efficacité pour équilibrer les écanges économiques et pour en finir avec l’accumulation capitaliste, événement totalement pervers et toujours causal des risques systémiques et sociaux.
on se fiche que ceux qui ont des billets sous leur matelas les gardent sans les faire circuler. La banque centrale a tous pouvoirs d’en diffuser d’autres.
Petit problème de calcul
Comment est calculée la compensation multilatérale ? Supposons qu’il y ait 500 banques en France. La compensation multilatérale de ces 500 banques qui semble un problème très compliqué est en fait très facile. La compensation multilatérale est effectuée par 499*500 (soit 249 500) compensations bilatérales. Le programme de la machine qui exécute ce calcul doit tenir sur une page de 70 lignes. La machine doit effectuer ce calcul en quelques seconde. Ils ne faut pas se fier aux apparences.
Pour traiter la compensation de 500 banques il suffit de deux tableaux de 500 lignes et de 500 colonnes. Toutes les banques sont remettantes et tirées, remettantes sur les lignes, tirées sur les colonnes. Sur la ligne… 15 par exemple, la banque remettante n° 15 dépose sur la ligne N° 15 dans les colonnes des banques tirées, ses créances, par exemple : colonne(23) = colonne(23) + créance n°1.123.456 ; colonne(125) = colonne(125) + créance n°1.123.457 ; colonne(498) = colonne(498) + créance n°1.123.458, etc. jusqu’à épuisement de ses créances ; et ainsi de suite pour toutes les banques remettantes de indice 1 à indice 500.
Après trois milliards six cent mille et trois transactions traitées, il ne reste plus qu’à additionner les cases d’une même ligne d’une part, ligne n° 135 par exemple, et les cases d’une même colonne d’autre part, colonne n° 135 dans ce cas, pour obtenir, pour chaque banque (ici la banque n° 135) sa position remettante et sa position tirée, et donc sa position par simple soustraction des totaux.
On a également la position de chaque banque par rapport à chaque banque dans un second tableau de même dimension en soustrayant par exemple les cases tableau(ligne_15, colonne_472) et tableau(ligne_472, colonne_15) et en reportant le résultat de la soustraction, positif, nul ou négatif (avec un changement de signe évidemment pour l’une des banques) dans le deuxième tableau, dans les cases tableau_2(ligne_15, colonne_472) et tableau_2(ligne_472, colonne_15), où les nombres ne sont plus seulement des nombres réels positif ou zéro, mais réels positifs ou négatifs ou zéro, selon le résultat de la soustraction.
Ça marche encore avec un trillion de transactions (private joke).
Conséquences :
La chambre de compensation ressemble à un Colisée où des millions de gladiateurs (les créances) se précipiteraient et s’entretueraient gaillardement. Seuls quelques uns ressortiront. Les autres sont anéantis. Ainsi beaucoup de créances son anéanties sur place, ce qui explique que l’on puisse faire autant d’achat avec si peu d’argent dans les trésoreries des banques sans exiger aucun supplément de monnaie.
Félicitation M Voyer, on voit bien la différence entre flux brut et flux net mais maintenant il faut en tirer toutes les conséquences sur le sujet qui nous occupe.
La prétendue science économique est une métaphysique
c’est à dire une pathologie
Ma spécialité de grammairien est la grammaire du mot « valeur ». Quand je lus Wittgenstein ils y a une dizaine d’années, je découvris, à ma grande surprise, que tel M. Jourdain faisant de la prose sans le savoir, j’étais grammairien sans le savoir et que j’avais résolu en 1976 la pathologie grammaticale du mot « valeur » après quinze ans d’efforts, une pathologie vieille de deux siècles.
Une grammaire est l’ensemble des règles qui constituent une institution, un usage, et qui les constituent dans la mesure où les règles sont suivies. La grammaire de l’institution langage n’est qu’un cas particulier parmi tous les usages possibles. La thèse de Wittgenstein est que l’usage ne se trompe jamais (Lévi-Strauss quant à lui disait que la tradition avait toujours raison). Les règles sont suivies sans aucun problème et en toute ignorance de ce qui est ainsi accompli. Par contre, l’interprétation de ces grammaires est presque toujours fausse et a pour nom celui d’une maladie : la métaphysique. À ce titre, la « science » économique est un bon exemple de cette pathologie de l’interprétation, elle est une métaphyqique. C’est pourquoi Wittgenstein dit toujours regardez l’usage. La guérison intervient brusquement lorsque la grammaire est comprise. C’est difficile, la grammaire. Peut-être y a-t-il parmi vous beaucoup de grammairiens qui s’ignorent.
JPV
La « science économique » n’existe effectivement pas, bon nombre d’économistes commencent à le murmurer. On peut cependant tenter d’aborder de façon scientifique – avec humilité, logique et discernement, et avec le moins possible d’idéologie – les problèmes économiques de notre temps. La « science économique » n’est pas (encore?) là, mais les problèmes, eux, sont bien là.
Lisez ce que j’ai écrit à sentier 198 et vous aurez une idée de ce qu’il en reste des « sciences » économiques quand on leur applique un minimum de raisonnement!
Tant que la circulation monétaire, parce trop SIMPLE, n’est pas comprise et que l’on délire sur la soi-disant création monétaire via les banques qui ne devient pas davantage possible parce que répétée ad nauseam par l’université, il n’y a pas moyen d’avancer!
J’appelle solennellement les créationnistes d’enfin reconnaître que l’empereur est nu!
Il doiventabandonner la partie car rien ne peut être sauvé!
J’ai d’autres exigences d’abandon, les anticipations,les agregats monétaires, etc…
Problème inaperçu
Il y a en France un bon million et demi de PME. Ces petites entreprises assurent leur trésorerie par des autorisations de découvert (allant de 15 000 euros à 150 000 euros ou plus) souvent verbales et, hélas, souvent révocables ad nutum. L’effet de ces autorisations de découvert est exactement le même que celui de la mystérieuse écriture qui crée de la monnaie : crédit du compte Client par débit du compte Créance sur les clients.
Les chèques que tirent ces petites entreprises sur leur banque ne se distingue en rien des chèques que tirent les clients crédités. Ils partent tous dans l’arène de la compensation et là, rien ne distingue un chèque tiré grâce à un découvert et un chèque tiré grâce à un crédit.
Autre bizarrerie, tandis que les crédits apparaissent au bilan, au passif, dans le solde Comptes clients créditeurs, les chèques résultant d’un découvert ne paraissent pas au bilan puisqu’il sont noyés, à l’actif, dans le regroupement ????.
Ma question est (il faut tout expliquer tant est grand le nombre des malcomprenants) : Pourquoi n’entend-t-on jamais de hauts cris : « Création de monnaie ! création de monnaie ! » quoique l’effet des deux procédés soit strictement le même. Pourquoi n’y a-t-il de masse monétaire M2034
JPV
Entre la création monétaire par les banques (des banques vers la sphère économique) et le crédit mutuel entre acteurs économiques (comptes fournisseurs ou compte clients), il y a la même différence qu’entre la création monétaire bancaire et la simple transformation « épargne vers financement ».
Dans le premier cas, il y a augmentation de la masse monétaire, Dans le second, non.
Auriez-vous l’obligeance d’expliquer ce que vous venez de dire si ce n’est trop vous demander. Vos paroles sont pour moi du chinois.
JPV
@JPV
Lorsque un agent économique à capacité de financement (une « fourmi » qui aurait épargné) prête une partie de ses disponibilités à un agent économique à besoin de financement (une « cigale » qui voudrait consommer plus qu’elle ne possède, ou un entrepreneur qui aurait besoin d’un financement supplémentaire), il y a simplement transfert d’une monnaie existante, d’une épargne.Il n’y a pas augmentation de la masse monétaire, simplement un transfert de compte à compte, ou de main à main: M1 reste constante.
C’est pareil lorsqu’un fournisseur fait crédit à un client.
En revanche, lorsqu’une banque octroie un nouveau crédit, il y a augmentation de la masse monétaire (augmentation de M1). B.L.
Il me semble qu’accorder une autorisation de découvert est pour une banque, accorder un crédit à son client. Pourquoi alors M1 n’augmente-t-elle pas ? C’est tellement accorder un crédit, c’est tellement « de l’argent » que pour vous cautionner en banque votre sleeping partner (venture capitalist en bon français) vous demande 50 % des parts de votre société pour prix de ce menu service. Vous noterez que le sleeping partner ne sort pas un centime et que sa caution est orale, car il est un très gros client de la banque de grands comptes qui autorise le découvert. La banque lui rend ce service gratuitement et pour lui faire plaisir. Grand avantage pour vous, la banque vous fait à vous, tout petit entrepreneur, les mêmes conditions qu’à votre caution. Vos frais financiers sont dérisoires à la fin de l’année. Et vous dormez sur vos deux oreilles, vous ignorez pendant quinze ans ce qu’est un problème de trésorerie ; vous vous consacrez totalement à votre tâche, en quinze ans vous écrivez plus d’un million de lignes de code informatique. Quinze ans plus tard, vous vendez votre boîte, le 4 février 2000 alors que le Nasdaq s’effondre en mars 2000. Coup de chance, gros Loto. Votre sleeping partner a multiplié sa mise par 20, en quinze ans. Son demi-million de caution (il n’a pas sorti un sou) est devenu 10 millions de plus-value.
Vous ne répondez pas à ma question : pourquoi le crédit accordé par la banque n’influe-t-il pas sur la masse M1. Comment ce crédit le pourrait-il d’ailleurs puisque le compte courant de la petite boîte est toujours à découvert, pendant quinze ans et que son solde est perpétuellement débiteur. Il ne peut donc figurer dans la somme des soldes créditeurs des clients de banques.
Vous ne répondez pas à ma question qui est : pourquoi cette autorisation qui fait exactement le même effet, dans le monde, que la ligne d’écriture magique, ne figure dans aucune masse monétaire. Suis-je assez clair ?
JPV
à sentier 198 qui m’écrit ceci:
@ johannes finckh
ok, sur le signe monétaire qui doit circuler…pour étre efficace
bien entendu que si l’on consomme , la monnaie va circuler…..car comme vous le dites « l’accumulation de tout autre bien libère au contraire le signe monétaire.. »
mais en quoi un usage de la monnaie « fondante » par exemple va empêcher que certains accumulent des biens ( lingots d’ors , bien immobiliers , ressources en matières premières indispensables , outils de production , moyens de communication , services divers (santé,éducation…) …etc ….et ainsi » maitriserons » les prix des biens et des services ) au détriment de l’intérêt général ?
REponse jf:
L’usage de la « monnaie fondante » n’empêche pas, en principe, diverses accumulations, bien entendu. J’ai signalé que crtaines règles devront s’appliquer aux biens existants en quantité limite, afin de maintenir la paix sociale, mais cela relève de l’ordre public déjà maintenant. Par exemple, le non-usage des terres agricoles ou le fait de laisser les logement vides à côté d’une pénurie et de gens mal-logés justifie amplement l’intervention des pouvoirs publics, mais ces pouvoirs ont déjà les moyens d’agir s’ils voulaient…
Plus avant ,en ce qui concerne l’accumulation de biens reproductibles aisément, il est évident qu’une telle accumulation ne fait pas forcément sens pour celui qui s’y aventure, et s’il n’y trouve pas un avantage matériel et financier ou spéculatif, il ne le fera guère, mais supposer qu’un tel très riche le ferait, il est évident que ses agissements libère en contrepartie autant de monnaie restant ainsi toujours circulante du fait de la nature désormais « fondante » du signe monétaire, dans notre débat. Alors, l’intérêt général ne me semble guère affecté par cette façon de faire, et l’accumulateur de ces biens, s’il veut récupérer une partie de sa mise, devra bien les remttre en vente avec le risque de ne pas récpérer autant qu’il investi, car les biens en question, dans la situation ici débattue, sont reproductibles à volonté. Alors, ces biens, d’une façon naturelle comme tous les biens produits, son quand frappés d’une dégradaton liée au temps, par exemple les 5% annuels évalués en moyenne pour un immeuble, car cela représente le coût moyen d’entretien coramment retenu et que l’on appelle amortissement. Dès lors, pour entretenir son patrimoine, l’accumulateur de biens immobiliers par exemple devra bien générer des revenus d’au moins 5% annuels, sinon, il est de sa poche. Alors, accumeler des biens, tout comme des signes monétaies « fondants », l’opération se révèlera coûteuse. Il en résulte, à mon avis, une autorégulation probablement suffisante et satisfaisante.
SENTIER 198
quel sera son impact également sur le niveau des salaires ? ou plutôt la répartition revenu du capital-revenu des salaires ?
REPONSE JF:
Excellente question, car cela me permet de développer ce point. Le capital monétaire, désormais confronté au signe monétaire marque par le temps (SMT) ou « fondant », se comporterait bien différemment qu’actuellement. C’est bien l’effet visé par ce projet SMT. Ne pouvant plus obtenir automatiquement l’intérêt monétaire net du fait que la rétention du SMT génère des frais équivalents de ces intérêts, il est sensible que les intérêts de l’épargne et du crédits iront inexorablement vers zéro, car chacun a envie de minimiser sa rétention de ces SMT. Comme je l’expose ailleurs aussi, il en résulte qu’une épargne en banque qui ne rapporte plus d’intérêts gardera, dans une ambiance sans inflation, pour l’épargnant encore de loin la meilleure façon de « sécuriser » son avoir, bien meilleure que l’achat de tout et de n’importe quoi. La non-inflation sera assez facile à obtenir avec le SMT, bien plus facile qu’avec le signe actuel durable (SMD) thésaurisable, car la totalité des SMT circuleront toujours à la même vitesse et que les rapports de prix seront STABLES dès lors que la banque centrale compensera toujours, cela ira avec ce projet SMT, la part « fondue », en versant ces sommes par exemple au gouvernement comme recette. Je précise que la quantité SMT est faible, la compensation centrale aussi, et que cette mesure technique n’a pas pour but de « taxer » mais celui de maintenir le SMT en mouvement. Ce sera une mesure peu coûteuse, compte tenu du volume de transactions opérées par chaque SMT.
Pour répondre dès lors sur l’impact sur les salaires, l’impact sera tout à fait considérable rapidement. En effet,dès que le SMT circulera sans intérêts, ces intérêts ne seront plus à répercuter sur les prix des biens ou à soustraire du profit productif.
Sachant que la rente du capital, les intérêts versés annuellement aux fortunes monétaires actuels, représentent 40% du PIB annuels au moins avec une tendance croissante, il est sensible que, quand cette rente diminuera grâce au projet SMT, ces sommes réapparaîtront dans le profit productif d’abord, car les frais financiers seront désormais fortement allégés. Les salariés doivent se contenter actuellement, de seulement 60% du PIB sous forme de revenu salarial, tendance décroissante à mesure que la rente du capital augmente. L’allègement massif des frais financiers pourrait permettre des investissements nouveaux devenus moins coûteux, et, par là, la création nette d’emplois. Le premier effet du SMT serait le retour, en quelques mois, au plein-emploi. Devant l’augmentation forte des volumes produits, on peut et on doit alors s’attendre à une offre abondante qui pourrait pousser les prix à la baisse, sauf si la banque centrale, qui y veille, ajuste au mieux la quantité de SMT circulants, en les augmentant par exemple. Davantage de salaires distribués n’implique néanmoins pas forcément davantage de consommation, car ces revenus distribués seront aussi largement utilisés pour opérer sur n large front le désendettement des plus endettés, car pour eux aussi, le refinancement de leur dette se révèlera beaucoup moins coûteuse en même temps que leurs salaires plus réguliers leur permettra de tenir mieux les engagements de remboursement. Remborsant mieux et plus facilement, le pouvoir d’achat des salariés augmentera sensiblement.
Pour aller plus loin, l’ambiance du plein-emploi obtenue en quelques mois permettra aux salariés davantage de salaires et de les obtenir, car le rapport de force face au patron leur deviendra beaucoup plus favorable.
En suivant ainsi la baisse de la rente du capital, les profits productifs baisseront à leur tour en faveur du salaire, et nous observerons dès lors un contexte dans lequel les investissements productifs n’iront plus vers davantage d’expansion, et la « formation brut de capital fixe » cessera d’elle-même de croître, se contentant de reproduire et de moderniser l’existant sans augmenter davantage le volume.
Il en résulte alors une ambiance de plein-emploi, de salaires élevés, de profits patronaux seulement équivalents au salaire du travail du patron (et non, comme maintenant, de « salaires » délirants, en fait, des positions rentières).
Et tout ce système s’autorégulerait sans problème dans un climat de CROISSANCE ECONOMIQUE NULLE, mais aussi sans décroissance, dès lors que la population est supposée stable.
Vous voyez donc, le SMT est non seulement « écolocompatible » mais il est absolument la condition nécessaire pour pavenir à un système favorisant le développement durable sans croissance.
C’es le capitalisme ambiant qui veut imposer la croissance, car, sans elle les problèmes sociaux seraient explosifs, comme nous le constatons déjà dans le climat de décroiossance actuel.
SENTIER 198:
j’ai une idée de ce qu’est le Capitalisme qui semble-t-il n’est pas identique à la votre , c’est peut-être là la difficulté.
je ne le réduis pas à la thésaurisation de signes monétaires , mais à la propriété privée des moyens de production macroéconomique , à la capacité de faire du profit avec le capital ainsi possédé …
c’est l’extension du Capitalisme sous sa forme néo-libérale imaginée par l’homme depuis un bout de temps (mais surtout avec la « flambée » de la mathématique appliquée (Nash et cie) survenue après la seconde guerre mondiale) qui a permis d’utiliser les produits financiers comme capitalisables.
ils risquent tout simplement de s’autodétruire dans les quelques années qui viennent…c’est déjà ca…..
REPONSE JF:
Vous avez raison, mais je précise que les dits « moyens de production »ne sont capital que circonstantiellement et auusi longtemps que la consommation des biens produits génère des profts supérieurs à la rente du capital financier. Dès que ces profits baissent, le moyens de productions cesseront d’être « capital », et ils peuvent devenir même des machines à perdre beaucoup d’argent: cf General Motors… La vraie signification de la plus-value de Marx est l’intérêt monétaire net, toute autre lecture n’est pas très réaliste. Selon ma définition, qui est quand même conforme à ce que nous observons depuis toujours, c’est que le capialisme est un système rentier lié au SMD, en fait, il s’agit de préler tout simplement la rente du temps dans la mesure où le temps est exclu du SMT, et la rente est alors payée par tous ceux qui ont recours au capitaliste finacier pour avoir le droit de vivre, de travailler etc. La perversité du capitalisme est bien celle-ci, et elle remonte, en fait, aux débuts mêmes de l’économie monétaire avec le SMD.
Le capitalisme industriel du 19ème siècle n’est qu’une époque historique particulière, liée aussi à l’usage de l’énergie bon marché.
SENTIER 198
enfin , face à la catastrophe écologique et énergétique qui nous guette , vous voir écrire « »…..notre tendance à accumuler, je ne m’y oppose en rien, j’aurais même tendance à l’encourager pour tout ce qui n’est pas le signe monétaire lui-même, ca cela n’entrave en rien la vie économique, bien au contraire, cela motive. » , je ne partage pas votre « consumérisme » , à moins que tout simplement j’interprète mal vos propos.
pour ma part , ce n’est pas le Capitalisme Formel qui me pose le plus de problèmes , mais c’est le fait que de nombreuses personnes ayant compris qu’il est possible de « motiver » l’être humain à consommer en utilisant cette « fragilité » qu’est l’angoisse du manque , de la perte , en ont fait un véritable business très lucratif , pour le moment .je pense ,par exemple ,à :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays
JF:
Oui, je ne suis pas spécialement « consumériste », mais ce consumérisme est un moindre mal quand il s’applique à des populations manquant de tout. Comme je l’ai exposé, le SMT créera cependant beaucoup plus facilement les conditions du développement durable et d’un système tès stable sans une croissance écoomique désormais insoutenable pour des raisons écologiques que notre SMD pervers.
Ai-je bien répondu à vos questions? Je dois vous quitter, ma femme est entrain de m’engueuler, car nous avons des amis à table, à+,
Bien cordialement, jf
au plaisir de débattre
cordialement
@ JF.
premier point…si je condense :
la monnaie fondante impliquerait en « cascade » une fonte automatique du capital (obligé de se refinancer avec une moins value systémique de ses fonds propres), et , ainsi l’irruption dans le champ des relations humaines du concept de « valeur fondante » ;
il n’ y aurait donc plus de souci à se faire sur la tendance » capitalisatrice » de notre espéce.
je comprends qu’alors vous puissiez dire plus haut que « …Finir avec le capitalisme suffirait amplement à mon bonheur… »
ok , mais , il y a un long chemin , faire accepter à tous un tel système….
deuzio : l’affaire des salaires :
dans un dispositif où il est socialement reconnu que tout à une « valeur fondante » , et que ce rapport à la perte (qui ne figure pas sur les SMD , comme vous le dites très justement) est « intégré » à l’organisation sociale …l’introduction d’un dispositif de signes monétaires du même type (monnaie fondante) ne fera aucun problème (de même que les dispositions proposés par P.Jorion,comme l’interdit sur la spéculation sur les prix ..).
mais , dans ce même paragraphe vous dites concernant les salariés : « ….le rapport de force face au patron leur deviendra beaucoup plus favorable…. » , ce qui veut dire , et qui me rassure , que vous n’évitez » pas le problème politique qui va pré-exister à l’introduction d’une organisation de la cité (polis) plus juste pour tout le monde.
pour ma part , je ne sais pas quel système d’organisation des échanges économiques pourront être mis en place une fois le principe d’un fonctionnement social rétablissant l’égalité de l’accès de tous , sans exception, aux denrées vitales (eau potable ,protéines,..) , aux énergies (chauffage ,transport ) , aux services (santé ,éducation…) .
et , je pense , un peu à l’image de ce rappel que fait JP Voyer à propos de Wittgenstein et de son idée de confronter la grammaire à son usage , qu’une fois accomplie cette tache politique les mesures s’énonceront d’elle-même , peut-ètre nous surprendront-elles…
et pourquoi pas une système de signes monétaires rendant clairement compte de la perte de valeur progressive de tout biens en ce monde , à l’image de notre vieillissement propre.
tercio : le capital …etc…
il est bien évident que si nous sommes dans un dispositif social où tout bien accumulé voit automatiquement sa valeur fondre , il n’y a plus de Capitalisme possible , donc ma remarque n’a plus de sens , dont acte.
quarto : écolo-energie……
dire que le « consumérisme » est un « moindre mal » est peut -être imprudent…
quand je parle de « consumérisme » , je parle du différentiel de niveau de vie entre les hommes qui peuplent cette planète et qui fait que plus d’un milliard vit largement en dessous du niveau de pauvreté , tandis qu »un autre milliard gaspille son argent à l’achat de biens particulièrement polluants et peut-être inutiles.
en y ajoutant , que le partage nécessaire des biens,ressources,services vitaux risque de devenir de plus en plus délicat du fait de la raréfaction des ressources en énergie en eau potable ,voire en denrées alimentaires associée à une augmentation de la population.
mais je rajoute à nouveau :, à moins que tout simplement j’interprète mal vos propos.
car votre réponse ne me parait pas très convaincante, désolé.
enfin ,et , je vois que je me suis mal exprimé car mon dernier paragraphe ….
…….pour ma part , ce n’est pas le Capitalisme Formel qui me pose le plus de problèmes , mais c’est le fait que de nombreuses personnes ayant compris qu’il est possible de « motiver » l’être humain à consommer en utilisant cette « fragilité » qu’est l’angoisse du manque , de la perte , en ont fait un véritable business très lucratif….
explique que je trouve les efforts intellectuels consacrés à l’analyse des processus financiers , monétaires,économiques très intéressant ,mais ++ secondaires+++ à la question réintroduite de façon récurrente du « comment mettons nous en place un dispositif » qui va immanquablement remettre en question les rapports humains , dans la mesure où il interdit toute possibilité de devenir un jour un rentier , au sens large du terme.
( pire , en exagérant le trait , je dirais qu’on vit dans un monde où l’on paye des salaires à des rentiers pour leur travail de rentier !!!)
je suis tout à fait d’accord pour dire que je suis hors sujet….
cordialement
Merci beaucoup pour vos fines remarques, je vais y répondre parce que cela devient passionnant!
Sentier198 écrit @ JF.
premier point…si je condense :
la monnaie fondante impliquerait en « cascade » une fonte automatique du capital (obligé de se refinancer avec une moins value systémique de ses fonds propres), et , ainsi l’irruption dans le champ des relations humaines du concept de « valeur fondante » ;
il n’ y aurait donc plus de souci à se faire sur la tendance » capitalisatrice » de notre espéce.
je comprends qu’alors vous puissiez dire plus haut que « …Finir avec le capitalisme suffirait amplement à mon bonheur… »
ok , mais , il y a un long chemin , faire accepter à tous un tel système….
Jf:
Vous avez peut-être raison, mais j’observe ceci:
– la « valeur fondante » est déjà omniprésente dans la vie, c’est la vie elle-même! Tous les biens produits n’ont qu’une durée limitée, même les pyramides d’Egypte…
Le seul objet, fabriqué par les hommes qui y fait exception d’une façon parfaitement fétichiste et donc perverse, c’est le SMD. Lui seul a donc introduit la « tendance capitalisatrice » dans le jeu économique. Il suffit donc de s’en débarasser pour que cela change.
Il faut distinguer soigneusement l’épargne de précaution qui fait que l’on entrepose la récolte jusqu’à la récolte suivante, et le fait de transformer en capital rentier le temps de la vie des autres comme le fait le SMD. N’oublions pas que le SMD entreposé, faisant fictivement et nominalement exception de la dégradation temporelle, est toujours autant de biens et services invendus, car la rétention du SMD implique que celui qui le retient n’achète pas autant qu’il a vendu et qu’il ne rachète pas ce que d’autres offrent. Le retour en banque pour sa remise en circulation, nécessité impérieuse pour boucler le circuit de la demande, se fait, comme je l’ai exposé, moyennant intérêts, et nous y sommes au capitalisme qui installe ainsi son odieux chantage pervers.
Le « long chemin » à parcourir serait celui que devront bien faire les experts économistes pour enfin thématiser cette question centrale, une chose qu’ils ignorent pour l’instant superbement, et ils rigolent bêtement. Car le citoyen de base sait très bien que rien ne dure indéfiniment. Beaucoup de capitalistes le savent aussi très bien, trop bien, mais comme ils sont les bénéficiaires de ce sytème pervers, je ne compte guère sur eux pour proposer le changement. Encore que quelqu’un comme George Soros l’a très bien dit, il n’est pas du tout dupe, et il n’est pas le seul! Bernard Liétar, ancien banquier central de la Banque centrale de Belgique et ayant participé à la mise en place de l’Euro, le sait très bien aussi comme en témoignent ses livres. Et il sait bienqu’il faut changer de paradigme économique, il me l’a écrit lui-même.
Or, ceux qui veulent toujours tout ignorer sont avant tout les univesitaires pour qui ces questions ne sont guère thématisées. Ils sont les complices les plus sûrs, les « idiots utiles », de cette perversité maintenue qu’est le capitalisme, en premier lieu les « créationnistes » qui inventent des choses qui ne sont pas comme la « création de monnaie via le crédit », moyennant quoi, ne voyant pas le problème vraiment où il est, ils ne peuvent que rater la solution, pourtant relativement simple. En embrouillant tout, ils avancent avec des théories savantes qui ne témoignent que le leur crasse ignorance des correlations pourtant plutôt simples. Mon père me disait: « mais ils ne peuvent tout de même pas être idiots à ce point pour ne point comprendre ces choses-là! » Et pourtant, il me me semble, hélas, que l’autorité des grands auteurs économistes du passé et celle de la gloire du prix Nobel les ont rendus complètement incapables de produire des enchaînements logiques, cohérentes et simples. Marx a dit…,Keyne a dit…, Schumpeter a dit … etc. Mais est-ce que l’on ne s’en fout pas un peu quand les choses s’imposent simplement d’une logique ausi massive? Le SMD impose sa logique perverse aussi longtemps qu’il est maintenu!
Conseillant ainsi MAL les politiques et commentant l’événement économique avec des concepts erronnés, ils bétonnent solidement le capitalisme et empêchent toute sortie possible. Car, pour eux, la mise en question du signe monétaire li-même, à la fois échangeur et RESERVE DE VALEUR, n’est tout simplement pas. Il s’agit pourtant de quelque chose d’aussi intenable que de dire que la Terre serait à la fois un disque plat et une sphère. Ou que les routes serient faites pour en interdire l’usage. Les économistes universitaires, toutes tendances confondus sont au même point que jadis les marxo-communistes, qui jetaient l’enfant du marché avec l’eau de bain sale du capitalisme, moyennant quoi, ils ont permis le retour triomphant d’un capitalisme échevelé depuis la chute du mur de Berlin.
Le long chemin que vous signalez est, à mon sens, surtout la nécessité de faire advenir ce discours économique nouveau dans les têtes des universitaires. Ils devront opérer des révisions déchirantes de tout le fatras universitaire accumulé depuis les mercantilistes jusqu’à aujourd’hui et foutre à la poubelle la plupart des grands textes.
Ils’agit d’une révolution intellectuelle majeure comparable à la révolutuion kopernicienne!
Mais, encore une fois, techniquement et pratiquement, c’est une simplification inouie et ne heurte certainement pas le bon sens populaire, elle est au contraire plutôt une libération et une réforme très démocratique.
SENTIER 198
deuzio : l’affaire des salaires :
dans un dispositif où il est socialement reconnu que tout à une « valeur fondante » , et que ce rapport à la perte (qui ne figure pas sur les SMD , comme vous le dites très justement) est « intégré » à l’organisation sociale …l’introduction d’un dispositif de signes monétaires du même type (monnaie fondante) ne fera aucun problème (de même que les dispositions proposés par P.Jorion,comme l’interdit sur la spéculation sur les prix ..).
mais , dans ce même paragraphe vous dites concernant les salariés : « ….le rapport de force face au patron leur deviendra beaucoup plus favorable…. » , ce qui veut dire , et qui me rassure , que vous n’évitez » pas le problème politique qui va pré-exister à l’introduction d’une organisation de la cité (polis) plus juste pour tout le monde.
pour ma part , je ne sais pas quel système d’organisation des échanges économiques pourront être mis en place une fois le principe d’un fonctionnement social rétablissant l’égalité de l’accès de tous , sans exception, aux denrées vitales (eau potable ,protéines,..) , aux énergies (chauffage ,transport ) , aux services (santé ,éducation…) .
et , je pense , un peu à l’image de ce rappel que fait JP Voyer à propos de Wittgenstein et de son idée de confronter la grammaire à son usage , qu’une fois accomplie cette tache politique les mesures s’énonceront d’elle-même , peut-ètre nous surprendront-elles…
et pourquoi pas une système de signes monétaires rendant clairement compte de la perte de valeur progressive de tout biens en ce monde , à l’image de notre vieillissement propre.
JF:
Nous sommes assez d’accord, mais je reste persuadé que la notion de notre mortalité n’est ignorée par personne… sauf que, psychiquement, nous nous « croyons » subjectivement immortels. Mais il faut bien vivre avec.
Essentiellement, il n’y a que le raisonnement capitaliste qui pose la rente capitaliste comme due indéfiniement, justement parce que le SMD est ce qu’il est et qu’il engendre ce système pervers. Le consommateur en général se « rêve » capitaliste et veut gagner au loto, mais cela n’arrive pas souvent.
SENTIER 198
tercio : le capital …etc…
il est bien évident que si nous sommes dans un dispositif social où tout bien accumulé voit automatiquement sa valeur fondre , il n’y a plus de Capitalisme possible , donc ma remarque n’a plus de sens , dont acte.
JF: Certains biens, l’or par exemple, résistent très bien au temps, et il me semble que la « fonte » par ailleurs comme réalité naturelle tout à fait réelle poussera, une fois e SMT adopté, vers l’invention du développement le plus durable possible, simplement parce que nous cherchons, y compris pour nous-mêmes, à prolonger notre vie et celle de nos objets.
SENTIER 198
quarto : écolo-energie……
dire que le « consumérisme » est un « moindre mal » est peut -être imprudent…
quand je parle de « consumérisme » , je parle du différentiel de niveau de vie entre les hommes qui peuplent cette planète et qui fait que plus d’un milliard vit largement en dessous du niveau de pauvreté , tandis qu »un autre milliard gaspille son argent à l’achat de biens particulièrement polluants et peut-être inutiles.
en y ajoutant , que le partage nécessaire des biens,ressources,services vitaux risque de devenir de plus en plus délicat du fait de la raréfaction des ressources en énergie en eau potable ,voire en denrées alimentaires associée à une augmentation de la population.
mais je rajoute à nouveau :, à moins que tout simplement j’interprète mal vos propos.
car votre réponse ne me parait pas très convaincante, désolé.
JF:
Peut-être suis-je plus »convaincant » en disant qu’en 1800, il y avait 1 milliards d’humains sur terre, souvent mal nourris et que nous serons 9 milliards, paraît-il, en 2050 et que la Terre peut, à mon avis, parfaitement nourrir 9 milliards de personnes, à condition de s’orienter vers un développement durable et d’organiser, ensuite, une stabilisation de la population sans doute, en nombre.
La surconommation et le gaspillage, ce sont des nécessités capitalises, car le capital productif, en régime de SMD, ne peut rester « capital » que quand les produits, du fait du gaspillage soutenu, restent rares et chers. En s’orientant vers un développement durable avec l’aide du SMT, le recyclage et la précaution des ressources redeviendront un comportement standard et réflexe comme avant 1800, où l’énergie fossile était peu utilisée et où l’industrialisation était moins répandue. Dans un tel contexte, les ressources en énergie (animaux et force humaine) étaient plus précieuses. Nous y reviendrons partiellement avec les énergies solaires et géothermiques renouvelables, mais les énergies fossiles sont encore trop bon marché…
Le pousse-au-gaspillage et le délire croissantiste sont le corollaire du SMD et de la perversité capitaliste. Il n’y a vraiment pas de raison de penser que cela resterait ainsi avec le SMT qui rend toute durabilité (extramonétaire) précieuse. Et le non-gaspillage redeviendrait un objetcif réflexe de chacun. Nous sommes déjà nombreux, au point que cela me semble même un trait humain universel, à ne pas aimer le gaspillage pour les objets que nous apprenons à aimer. Nous les jetons souvent seulement parce qu’il sont mal fabriqués. En régime de SMT, des politiques écologiques soutenables pourraient dès lors aussi être encouragées et initiées par les gouvernements, sans, comme pour le transport routier actuel par exemple ou le nucléaire, que le « chantage » à l’emploi et à la concurrence étrangère empêchent toute orientation fiscale et économique crédible.
SENTIER 198
enfin ,et , je vois que je me suis mal exprimé car mon dernier paragraphe ….
…….pour ma part , ce n’est pas le Capitalisme Formel qui me pose le plus de problèmes , mais c’est le fait que de nombreuses personnes ayant compris qu’il est possible de « motiver » l’être humain à consommer en utilisant cette « fragilité » qu’est l’angoisse du manque , de la perte , en ont fait un véritable business très lucratif….
explique que je trouve les efforts intellectuels consacrés à l’analyse des processus financiers , monétaires,économiques très intéressants ,mais ++ secondaires+++ à la question réintroduite de façon récurrente du « comment mettons nous en place un dispositif » qui va immanquablement remettre en question les rapports humains , dans la mesure où il interdit toute possibilité de devenir un jour un rentier , au sens large du terme.
( pire , en exagérant le trait , je dirais qu’on vit dans un monde où l’on paye des salaires à des rentiers pour leur travail de rentier !!!)
je suis tout à fait d’accord pour dire que je suis hors sujet….
cordialement
JF: Je pense, pour ma part, que les « rentes » comme par exemple les retraites ou les pensions d’invalidité pour soutenir les « faibles » et les « vieux » dont nous espérons en être un jour, restent évidemment légitimes et sont à distinguer de la rente capitaliste, je pens e que cela est aussi évident pour vous.
L’angoisse du manque et de la perte est effectivement au coeur de l’expérience humaine, mais pourquoi cela deviendra-til, en régime de SMD, une source rentière pour la minorité capitaliste pour aggraver encore le manque et la perte des autres? Aucune légimité n’existe pour cela! De plus, la peur du manque et de la perte n’est même pas épargnée ainsi au capitaliste lui-même! Le capitaliste agit comme il agit, « instrument de la joussance de son capital », pour paraphraser Lacan qui indique pour le pervers sadique par exemple qu’il se fait l’ »instrument de la jouissance de l’Autre », autrement dit, il viole et assasine les enfants parce qu’il ne peut agir autrement du fait de sa structure perverse, cela le dépasse manifestement. Le capitalisme est une mécanique perverse.
Je ne suis pas d’accord avec vous si vous pensez que l’analyse de la mécanique capitaliste perverse serait un problème « secondaire ». Car, encore une fois, le capitaliste qui réussit n’est pas un homme qui démérite, il est simplement logique et rigoureux dans un système pervers, tout comme l’est le sadique à sa façon, et nous autres « névrosés » avons des scrupules et des blocages moraux pour exploiter avec autant de sans vergogne les autres. Alors compter sur l’éventuelle « gentillesse » du capitaliste de bien vouloir cesser d’agir comme il agit n’a aucun sens sens, car son entourage l’obligera à agir en capitaliste ou à dsparaître pour le remplacer par un autre!
C’es pourquoi j’attends beaucoup plus du fonctionnement nouveau qu’imposerait le SMT pour résoudre ce problème.
On peut encore ajoter qu’une rente temporaire pour une inventio ou un autre mérite qui finit par devenir bien commun à terme implique justement aussi que le temps (le terme!) est présent, caontrairement, encore une fois, pour ce qui se passe pour le SMD!
Merci e m’avoir amené à vous écrire tout cela!
JF
@ JF.
beaucoup à dire sur votre longue réponse..mais peu de disponibilité ce soir.
j’y pourvoirais demain …. c’est promis
cordialement
@ JF.
bien le bonjour
concernant le premier item :
« …Lui seul a donc introduit la « tendance capitalisatrice » dans le jeu économique. Il suffit donc de s’en débarasser pour que cela change…. »
merci tout d’abord de m’apprendre que tout sur cette terre est « temporaire » ….etc…
il ne vous a pas échappé que ce que je questionne depuis prés d’un an que j’interviens sur le site ,c’est la « faisabilité » des mesures « techniques » proposés par les uns et les autres comme éventuelles solutions à nos « soucis » actuels.
que l’homme est « injecté » une tendance capitalisatrice ne me parait pas un bon diagnostic , car il fait intervenir une « extériorité » totalement irréelle.
la difficulté que semblent rencontrer les sociétés ayant essayé de mettre en place ce type de systéme monétaire (monnaie fondante en République de Baviére , par exemple) ne réside pas dans les aspects techniques mais politiques et quand vous dites « il suffit de s’en débarasser » , vous soulevez un probléme sans évoquer la moindre solution.
pour ma part, je suis passionné par la question du « comment s’en débarrasser » et trouve donc « secondaires » les aspects techniques , même s’ils sont à éxaminer sérieusement.
et , si j’évoque le rapport de l’homme à la perte , c’est parce que ce mot « débarrasser » me semble recouvrir une violence telle que l’histoire nous renvoie immanquablement à des tentatives de résolution de conflits uniquement par la force ,la contrainte,le forçage.
je souhaite autre chose pour l’humanité qu’une Niéme boucherie qui déplacera momentannéement le rapport de force mais ne s’attaquera pas au fond du problème , laissant à nouveau , petit à petit se réinstaller des inagalités sociales et des systémes de controle des flux économiques injustes.
quand à votre long discours sur l’incapacité des élites à rendre compte du probléme et à imaginer des solutions , je confirme que dans mon expérience professionnelle toute véléité de formuler des idées un peu originales a été « sanctionnée » par une « conservatisme » intellectuel qui a envahit le monde occidental depuis 50ans.
N’attendons rien d’eux ,et imaginons , créons hic et nunc.
………….je repart bosser…
à plus tard,cordialement
Continuation du dialogue avec SENTIER 198 qui écrit ceci:
@ JF.
bien le bonjour
concernant le premier item :
« …Lui seul a donc introduit la « tendance capitalisatrice » dans le jeu économique. Il suffit donc de s’en débarasser pour que cela change…. »
merci tout d’abord de m’apprendre que tout sur cette terre est « temporaire » ….etc…
il ne vous a pas échappé que ce que je questionne depuis prés d’un an que j’interviens sur le site ,c’est la « faisabilité » des mesures « techniques » proposés par les uns et les autres comme éventuelles solutions à nos « soucis » actuels.
que l’homme ait « injecté » une tendance capitalisatrice ne me parait pas un bon diagnostic , car il fait intervenir une « extériorité » totalement irréelle.
la difficulté que semblent rencontrer les sociétés ayant essayé de mettre en place ce type de systéme monétaire (monnaie fondante en République de Baviére , par exemple) ne réside pas dans les aspects techniques mais politiques et quand vous dites « il suffit de s’en débarasser » , vous soulevez un probléme sans évoquer la moindre solution.
pour ma part, je suis passionné par la question du « comment s’en débarrasser » et trouve donc « secondaires » les aspects techniques , même s’ils sont à éxaminer sérieusement.
et , si j’évoque le rapport de l’homme à la perte , c’est parce que ce mot « débarrasser » me semble recouvrir une violence telle que l’histoire nous renvoie immanquablement à des tentatives de résolution de conflits uniquement par la force ,la contrainte,le forçage.
je souhaite autre chose pour l’humanité qu’une Niéme boucherie qui déplacera momentannéement le rapport de force mais ne s’attaquera pas au fond du problème , laissant à nouveau , petit à petit se réinstaller des inagalités sociales et des systémes de controle des flux économiques injustes.
quant à votre long discours sur l’incapacité des élites à rendre compte du probléme et à imaginer des solutions , je confirme que dans mon expérience professionnelle toute vélléité de formuler des idées un peu originales a été « sanctionnée » par une « conservatisme » intellectuel qui a envahi le monde occidental depuis 50ans.
N’attendons rien d’eux ,et imaginons , créons hic et nunc.
………….je repart bosser…
à plus tard,cordialement
Réponse JF:
« Pas un bon diagnostic », est-ce que vous voulez signaler que le diagnostic serait faux ou simplement le fait que cela est un diagnostic désagréable au sens où cela serait une mauaise nouvelle?
En tout cas quand j’indique « qu’il suffit de se débarrasser » du SMD, il me semble que je propose depuis longtemps déjà, mais disons au moins un an sur ce blog (comme vous), comment on peut s’y prendre sans la moindre violence!
Vous évoquez la « république des conseils de Bavière » de 1919 où Silvio Gesell était pour la durée totale de deux semaines, ministre des finances dans un gouvernement qui se voulait communiste.
Anticommuniste résolu lui-même, il y avait été nommé par le dirigeant communiste putschiste, car les communistes ne connaissaient aucun homme se connaissant en matière financière, et Gesell avait carte blanche pour promouvoir ses mesures.
Or, le temps lui avait manqué et ‘opposition de la Reichsbank de Berlin était résolue. Les troupes impériales ont rapidement mis un terme à ce gouvernement munichois comme ailleurs aussi en Allemagne en 1919. Il est vrai que la légitimité de ce gouvernement était douteuse évidemment.
Puisque vous semblez connaître quelques éléments de l’histoire, intéressez-vous plutôt à l’expérience de Wörgl en Autriche de 1932 qi était un succès technique remarquable et remarqué, étouffé après 15 mois par les tribunaux autrichiens sur pression de la Banque Centrale d’Autriche avec l’argument du monopole d’émission.
Ou alors Lignières-en-Berry en 1958, finalement interdit par de Gaulle sur pression de la Banque de France.
Je répète, techniquement, la mise en place d’un SMT serait plutôt simple, et la banque centrale pourrait le faire du jour au lendemain si elle le voulait – il suffit que les banquiers centraux soient convaincus de la pertinence de la chose, ce qui n’est pas fait bien sûr.
Mais il ne saurait être question de violence, cela va de soi.
J’ai rédigé un ouvrage de 90 pages (ordi en caractères 12) que j’essaye de faire publier, j’attends la réaction d’un éditeur contacté. Si le texte vos intéresse, je vous l’envoie en l’état, vous y trouverez une analyse plus complètede ce que nous échangeons ici. Vos remarques sont précieuses.
J’évoque aussi à un endroit l’Allemagne du Haut moyen Age où des monnaies seigneuriales locales et régionales avaient cours sur un mode révocable: les bractéates. Les historiens noten pour les trois siècles entre 1150 et 1450 une prospérité inouïe partout où les bractéates circulaient, et la plupart des villes allemandes avaient été fondées pendant cette époque.
Le conservatisme des élites est le problème que je ne sais pas combattre tout seul, évidemment. Mais, il me semble que dire et redire les choses reste la seule voie, Galilée a finit par s’imposer malgré la menace du bûcher et son reniement contraint.
Pour la réalité économique et monétaire du capitalisme actuel, il est certain que le SMT ne sédurait pas ceux qui en profitent le plus, à savoir les plus riches, mais je reste consterné que les professeurs d’université qui, de par leur statut, ont obtenu qand même une certaine liberté de penser, restent si peu sensibilisés par ce problème que je considère comme central.
Si, pour le Hic et ninc, vous avez des idées qui pourraient se réaliser, allez-y. Mais sachez que les expériences de monnaie locale actuelles (une trentaine de « Regio » en Allemagne, beaucoup de « SELs » en France, les « LETS » en pays anglosaxons et diverses initiatives locales aux USA) restent des « jeux à la marchande » tant qu’aucune autorité crédible ne soutient pas résolument une telle expérience, cr, il faut qu’une monnaie ait statut légal, sinon, cela ne peut être monnaie.
Alors pour avancer vraiment, d’une façon ou d’une autre, il faudra bien qu’une partie de l’élite se saississe du problème je suppose.
Et si l’on n’introduit pas le SMT, il est clair pour moi que rien d’autre ne changera le capitalisme et sa mécanique perverse.
Merci pour votre persévérance dans l’échange, jf
@ JF.
brève réponse à la votre , et , mon sentiment de ne pas bien me faire comprendre ,hélas !!
pour pouvoir appliquer une mesure « désagréable au sens où cela serait une mauvaise nouvelle » ,comme vous le dites ,( pour certains surement , je rajoute )
le problème à régler en premier lieu est Politique++++
comme le montre l’histoire (merci de nous transmettre vos connaissances) :
mesure « …étouffé après 15 mois par les tribunaux autrichiens sur pression de la Banque Centrale d’Autriche avec l’argument du monopole d’émission…. »
et à : « …..Lignières-en-Berry en 1958, finalement interdit par de Gaulle sur pression de la Banque de France… »
donc , ++++jamais++++ pour des raisons techniques .
vous êtes vous posé la question de savoir pourquoi ces expériences ont été aussi courte ?
et , si oui , merci de m’éclairer .
On peut noter que dans le cas de l’Autriche,(banque centrale contrôlée par qui?) , et de la France (DeGaulle) , l’arret est d’origine politique , non ?
il s’agit donc de réfléchir d’abord aux solutions politiques , qui permettront aprés de « pouvoir » appliquer des mesures économico-financiéro-monétaires adéquates , non ?
mais , bon , je regrette de ne pas arriver à me faire comprendre.
cordialement
Je suis d’accord avec vous, et c’est bien pourquoi j’aimerais que, déjà, les experts économistes se penchent sur le problème! Il me semble que répète cela sans cesse!
On ne peut obtenir le SMT sans un consensus politique et économique éclairé, voire majoritaire, je le pense aussi bien!
En attendant, je ne peux rien faire d’autre que de le dire et le redire encore, espéront que le fait de le dire un jour suffisamment « bien », c’est cela l’éthique du bien-dire, pour emporter l’adhésion du plus grand nombre!
Poupées russes, poupées gigognes
Quand une entreprise a de la trésorerie, qu’elle soit en espèces ou scripturale, ses comptes de trésorerie sont débiteurs. Plus ils sont débiteurs, plus elle a d’argent… à la banque pour ce qui est de l’argent scriptural.
Autrement dit, une entreprise, pas plus qu’un particulier, ne peut conserver d’argent scriptural « chez soi ». L’argent scriptural est nécessairement « à la banque ».
Or une banque est exactement dans le même cas : elle ne peut conserver aucune trésorerie scripturale, aucun argent scriptural chez elle. Son argent scriptural est… à la banque centrale. Quand une banque a de la trésorerie son compte Banque de France est débiteur. Plus elle a de trésorerie scripturale, plus son compte Banque de France est débiteur.
Conclusion : tout l’argent scriptural de France est dans les machines de la Banque de France. Le vôtre notamment, enfin ce qu’il en reste. Il n’y a aucun argent dans les soldes créditeurs de comptes courants et la prétendue masse monétaire M1-M0 n’est pas une masse monétaire.
JPV
Excellent résumé !
@JPV
Désolé de ne pas vous répondre plus vite, la « modération » prend un certain temps, sur un blog si fréquenté.
Plusieurs points:
a) « M1 – M0 » n’existe pas, car une partie de M0, la monnaie scripturale centrale (qui regroupe les comptes des banques commerciales auprès de la banque centrale) ne fait pas partie de M1
Seules les espèces en circulation, qui représentent environ 15% de M1, font partie de M1
Donc M1 – M0 n’est pas une masse monétaire, puisqu’elle n’a pas de sens.
b) Il ne faut pas confondre crédit mutuel entre entreprises et particuliers, et prêt d’une banque à une entreprise ou à un particulier. De la même façon qu’il ne faut pas confondre épargne reprêtée et création monétaire. Mais j’ai bien compris que nous n’étions pas d’accord sur ce point.
c) Pour les découverts, ce ne sont pas des prêts, mais – si je reprends la terminologie de Paul dans son livre – ce sont plutôt des lignes de crédit (et un crédit n’est pas un prêt, de la même façon que la monnaie n’est pas seulement de l’argent, des espèces). Ils peuvent bien sûr affecter la comptabilité des banques, mais il n’y a pas création monétaire pour autant.
Cordialement, B.L.
Erreur de manip de ma part, pardonnez-moi. La réponse est un peu plus bas.
JPV
excellent!
L’argent n’est pas une dette, l’argent n’est pas issu d’une dette
Quand une banque se refinance auprès de la Banque de France, c’est cette banque emprunteuse qui s’endette, et elle seule. La Banque de France ne s’endette pas. Que fait elle ? Elle tire sur elle-même (c’était avant l’Europe. Il y a seulement une poupée gigogne de plus). La Banque de France crédite le compte de la banque emprunteuse par le débit de son propre compte de trésorerie. Elle se doit donc à elle-même. Voilà une chouette dette. Elle ne se la réclamera jamais. Elle ne s’enverra pas l’huissier à elle-même. Elle est infaillible.
JPV
En ce qui concerne la Banque Centrale, personne n’a jamais dit le contraire, je pense: lorsqu’une banque se refinance auprès de la Banque Centrale, elle s’endette auprès d’elle. La banque centrale ne s’enverra effectivement pas d’huissier.
Je ne conteste pas non plus le fait que « l’argent n’est pas une dette », je dis simplement « la monnaie (dans sa partie scripturale, est une dette). Ainsi, lorsque je m’endette auprès d’une banque commerciale, je m’endette auprès de cette banque, et cette banque commerciale crée ainsi de la monnaie, de la monnaie dette, de la monnaie scripturale, un composant de M1. Ce qui explique que, dans M1, il y a 85% de monnaie scripturale, de « monnaie-dette », et seulement 15% d’espèces (ce que l’on appelle habituellement « argent »). Les banques ne créent pas d’argent, elles créent de la monnaie.
Cordialement, B.L.
La trésorerie des banques n’est pas en monnaie, mais en argent, en argent central. C’est cet argent central qui permet aux banques d’acheter des espèces. Cet argent central mérite pleinement son nom d’ »argent » car il remplace parfaitement… l’or. La banque de France est de l’or en barre.
JPV
Personnellement, je ne vois aucune différence entre monnaie et argent. À l’origine, la monnaie (moneta, nomisma) s’opposait, en tant que numéraire, aux lingots, aux talents et aux mines. Cette distinction n’a plus lieu d’être.
JPV
La FED tire sur elle-même
Bank Deposits – How They Expand or Contract
Let us assume that expansion in the money stock is desired by the Federal Reserve to achieve its policy objectives. One way the central bank can initiate such an expansion is through purchases of securities in the open market. Payment for the securities adds to bank reserves. Such purchases (and sales) are called « open market operations. »
How do open market purchases add to bank reserves and deposits? Suppose the Federal Reserve System, through its trading desk at the Federal Reserve Bank of New York, buys $10,000 of Treasury bills from a dealer in U. S. government securities. (3) In today’s world of computerized financial transactions, the Federal Reserve Bank pays for the securities with an « telectronic » check drawn on itself. (4) Via its « Fedwire » transfer network, the Federal Reserve notifies the dealer’s designated bank (Bank A) that payment for the securities should be credited to (deposited in) the dealer’s account at Bank A. At the same time, Bank A’s reserve account at the Federal Reserve is credited for the amount of the securities purchase. The Federal Reserve System has added $10,000 of securities to its assets, which it has paid for, in effect, by creating a liability on itself in the form of bank reserve balances. These reserves on Bank A’s books are matched by $10,000 of the dealer’s deposits that did not exist before. See illustration 1.
How the Multiple Expansion Process Works
If the process ended here, there would be no « multiple » expansion, i.e., deposits and bank reserves would have changed by the same amount. However, banks are required to maintain reserves equal to only a fraction of their deposits. Reserves in excess of this amount may be used to increase earning assets – loans and investments. Unused or excess reserves earn no interest. Under current regulations, the reserve requirement against most transaction accounts is 10 percent. (5) Assuming, for simplicity, a uniform 10 percent reserve requirement against all transaction deposits, and further assuming that all banks attempt to remain fully invested, we can now trace the process of expansion in deposits which can take place on the basis of the additional reserves provided by the Federal Reserve System’s purchase of U. S. government securities.
The expansion process may or may not begin with Bank A, depending on what the dealer does with the money received from the sale of securities. If the dealer immediately writes checks for $10,000 and all of them are deposited in other banks, Bank A loses both deposits and reserves and shows no net change as a result of the System’s open market purchase. However, other banks have received them. Most likely, a part of the initial deposit will remain with Bank A, and a part will be shifted to other banks as the dealer’s checks clear.
It does not really matter where this money is at any given time. The important fact is that these deposits do not disappear. They are in some deposit accounts at all times. All banks together have $10,000 of deposits and reserves that they did not have before. However, they are not required to keep $10,000 of reserves against the $10,000 of deposits. All they need to retain, under a 10 percent reserve requirement, is $1000. The remaining $9,000 is « excess reserves. » This amount can be loaned or invested.
If business is active, the banks with excess reserves probably will have opportunities to loan the $9,000. Of course, they do not really pay out loans from the money they receive as deposits. If they did this, no additional money would be created. What they do when they make loans is to accept promissory notes in exchange for credits to the borrowers’ transaction accounts. Loans (assets) and deposits (liabilities) both rise by $9,000. Reserves are unchanged by the loan transactions. But the deposit credits constitute new additions to the total deposits of the banking system.
3 Dollar amounts used in the various illustrations do not necessarily bear any resemblance to actual transactions. For example, open market operations typically are conducted with many dealers and in amounts totaling several billion dollars.
4 Indeed, many transactions today are accomplished through an electronic transfer of funds between accounts rather than through issuance of a paper check. Apart from the time of posting, the accounting entries are the same whether a transfer is made with a paper check or electronically. The term « check, » therefore, is used for both types of transfers
5 For each bank, the reserve requirement is 3 percent on a specified base amount of transaction accounts and 10 percent on the amount above this base. Initially, the Monetary Control Act set this base amount – called the « low reserve tranche » – at $25 million, and provided for it to change annually in line with the growth in transaction deposits nationally. The low reserve tranche was $41.1 million in 1991 and $42.2 million in 1992. The Garn-St. Germain Act of 1982 further modified these requirements by exempting the first $2 million of reservable liabilities from reserve requirements. Like the low reserve tranche, the exempt level is adjusted each year to reflect growth in reservable liabilities. The exempt level was $3.4 million in 1991 and $3.6 million in 1992.
Federal Reserve Bank of Chicago
La réponse : « il n’y a pas de création monétaire parce qu’une ligne de crédit n’est pas un prêt » n’est pas une explication. Je constate qu’une ligne de crédit et un prêt ont le même effet : les ordres de paiement qui en résultent sont indistinguables en chambre de compensation et ils sont les uns et les autres pour la majeure partie… détruits.
JPV
Si vous permettez, je vais poser ma question autrement : qu’il s’agisse d’un chèque tiré grâce à une ligne de crédit ou d’un chèque tiré grâce à un prêt, après compensation, dans les livres de la banque du tireur, le compte courant du tireur est débité par le crédit du compte d’attente que j’ai nommé « Compensation ».
Il n’y a pas la moindre différence dans l’un et l’autre cas. Pourquoi y aurait-il création de monnaie dans un cas et pas dans l’autre. Dans les deux cas des paiements ont été réellement effectués. Les créanciers sont contents, il ne voient aucune différence.
JPV
@ JF.
pour poursuivre encore si vous le voulez bien….:
« …..serait plutôt simple….pourrait le faire du jour au lendemain si elle le voulait…il suffit que les banquiers centraux soient convaincus de la pertinence de la chose… »
manifestement , ce n’est pas suffisant , manifestement ils ne le veulent pas (mais qui sont ces « ils » auxquels vous faites allusion?), manifestement ils semblent incapable d’évaluer la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons.
« …il ne saurait être question de violence, cela va de soi…. » , quelle naïveté
vous n’êtes pas sans savoir que certains considèreraient comme une extrême violence de perdre les acquis ainsi remis en question par le caractère « fondant » de tout capital.
que vous ne souhaitiez pas de processus violent , j’en suis convaincu.
ce que je craint , c’est la réaction de l’animal blessé.
cordialement
Oui, mais vous oubliez que les très riches sont très peu nombreux, quoique très puissants sans doute, mais si une mouvement politique pouvait, grâce au changement de discours des experts économistes entre autres, promouvoir le SMT, je crains bien moins les « réactions de l’animal blessé », car il ne s’agit, avec le SMT, surtout pas de « confisquer » quoi que ce soit mais d’obtenir que la rente du capital aille le plus possible vers zéro. A ce moment-là, le milliardaire pourra rester très riche encore assez longtemps pour n’être pas inconsolable. Par contre, il ne s’enrichira plus davantage. Par contre, avec des débiteurs qui redeviennent plus solvables (l’intérêt aura disparu avec le SMT), les créanciers seront peut-être même rassurés de pouvoir plus aisément récuperer les fonds avancés, même sans intérêts.
Pour quoi veut-on que la solution du SMT serait plus violente que la continuation du capitalisme? Je rappelle que le capitalisme a toujours fini très mal, comme par exemple les grandes guerres mondiales ainsi que tous les effondrements d’empires du passé!
Alors, la « violence » du SMT, c’est du pipi de chat à côté de ce que le capitalisme nous prépare autrement!
Je vous ai demandé : pourquoi n’y a-t-il pas création monétaire dans ce cas? Vous me répondez : parce qu’il n’y a pas de création monétaire dans ce cas. Intéressant.
JPV
Désolé si je n’ai pas été clair, et merci de relever qu’une tautologie n’est pas une explication.
Le point essentiel qui nous sépare – car je pense que nous sommes tous deux de bonne foi – est sur la création monétaire, et, plus précisément, sur la différence éventuelle entre l’émission de monnaie fiduciaire (les espèces) et l’émission de monnaie scripturale.
Ce que j’essaye de dire s’articule en deux points
a) Les crédits qui proviennent de l’épargne ne correspondent pas à une création monétaire, mais simplement à une intermédiation financière: sur ce point, je pense que nous sommes d’accord, il n’y a aucun « mystère ». M1 n’augmente pas, que cette épargne prenne la forme d’espèces, de monnaie scripturale, ou d’un mélange des deux.
Ce type de crédits – simple transfert entre agents à capacité de financement et agents à besoins de financements – n’a pas besoin de transiter par une banque: une simple institution financière, voire une transmission directe, suffit
b) Lorsque je m’adresse à une banque pour un prêt, à partir du moment où cette banque vérifie les ratios de solvabilité (cf Bale) et de liquidité nécessaire – et si je lui parais solvable – cette banque va me prêter de l’argent: elle va créer de la monnaie scripturale, il va y avoir augmentation de M1 (et, plus précisément, il va y avoir, à l’intérieur de M1, augmentation de la part de monnaie scripturale par rapport au montant d’espèces).Bien entendu, lorsque les ratios de liquidité de la banque sont voisins du maximu, cette abnque peut avoir besoin de se refinancer, un des moyens an sa possession étant de s’adresser auprès de la banque centrale. C’est ce qui explique que depuis 20 ans, le ratio M1/espèces soit resté compris entre 4 et 6 en France, avec quelques fluctuations en fonction des ajustements relatifs des banques commerciales et de la Banque Centrale. Le pouvoir de création monétaire des banques existe, mais il n’est pas infini. La Banque Centrale pourrait limiter ce pouvoir un peu plus, même si elle en a rarement montré des velléités.
En ce qui concerne maintenant les découverts bancaires, sommes-nous dans le premier cas, ou dans le second? Comme je vous l’ai déjà indiqué – peut être maladroitement – pour moi le découvert se range dans la première catégorie (pas de création monétaire), parce que je l’assimile à une ligne de crédit. Si la pratique bancaire – ou la jurisprudence – le range dans la deuxième catégorie, cela ne me gêne pas, bien entendu, et il faudra alors ranger les découverts dans la seconde catégorie, celle de la création monétaire. Pour moi, les découverts sont surtout pénalisants pour le « tireur » du fait des intérêts importants correspondants.
Enfin, pour finir sur la question des compensations, que ce soit des espèces ou de la monnaie scripturale, il faudra, bien entendu, que les soldes nets soient gérés, votre tableau l’a fort bien expliqué.
Cordialement, B.L.
Bonjour M Voyer
« Vous ne répondez pas à ma question qui est : pourquoi cette autorisation qui fait exactement le même effet, dans le monde, que la ligne d’écriture magique, ne figure dans aucune masse monétaire. Suis-je assez clair ? »
Vous avez raison moi aussi je trouve la réponse de Bruno Lemaire pas très satisfaisante voilà pourquoi il me faut intervenir j’espère que ça sera mieux.
M1 scripturale c’est une dette qui correspond à la monnaie fiduciaire que doivent les banques à leurs clients déposant.
Si les banques autorisent des découverts à leurs clients et que ces découverts sont utilisés, ils finissent en dépôt sur d’autres DAVs il y a donc globalement augmentation de M1 cad augmentation de la dette des banques mais dans le même temps, les DAVs (des clients à découvert) ont maintenant un solde négatif ce qui signifie que inversement ces clients doivent de la monnaie fiduciaire à leur banque il y a donc globalement diminution de ce que doivent les banques aux déposants et donc diminution de M1.
M1 augmente d’un coté et diminue de l’autre donc M1 ne bouge pas.
@Bruno Lemaire
Pourriez-vous expliquer plus précisément ce mécanisme ?
1) Quel est en particulier le rapport entre le ratio de solvabilité et les montants que la banque peut prêter par « simple jeu d’écritures » ? Si cet argent est fictif pourquoi aurait-il un impact sur le ratio de solvabilité ?
2) Si je vous comprends bien, une banque qui se contente de prêter l’argent de ses déposants n’a pas à se préoccuper de son ratio de solvabilité. Correct ?
@ JF.
« …j’ai rédigé un ouvrage de 90 pages (ordi en caractères 12) que j’essaye de faire publier, j’attends la réaction d’un éditeur contacté. Si le texte vos intéresse, je vous l’envoie en l’état, vous y trouverez une analyse plus complètede ce que nous échangeons ici. »
bien sûr que je suis intéressé , vous trouverez mon email sur votre site dans une « remarques » au dernier fil (du 24/12) (même alias)
nombreux se passionnent pour cette approche des échanges économiques
http://fragments-diffusion.chez-alice.fr/prospective.html
cordialement
M Voyer
Sur les flux bruts et les flux nets vous tirez la conclusion:
« Ainsi beaucoup de créances son anéanties sur place, ce qui explique que l’on puisse faire autant d’achat avec si peu d’argent dans les trésoreries des banques sans exiger aucun supplément de monnaie. »
Je crois qu’il faut aller jusqu’au bout du système de la compensation à savoir que certains de ces achats sont fait avec les crédits accordés par les banques, crédits qui génèrent des flux bruts et se compensent aussi, les banques n’ont donc pas besoin de les financer complètement, en fait elles ne les financent en moyenne qu’à 20% (ratio de liquidité ) donc les 80% restant n’ont nécessité aucune monnaie centrale, c’est de la création ex-nihilo temporaire puisque les crédits par la suite seront remboursés par les dépôts qu’ils auront généré (avec l’intérêt correspondant).
Tout ceci n’est valable que si le marché interbancaire reste équilibré dans la durée.
c’est débile d’évoquer une « création ex nihilo temporaire » simplement parce qu’une bonne partie du revenu disponible est rapidement transféré de compte en compte sans nécessiter de la monnaie centrale!
Je rappelle que ce qui achète et fonctionne donc comme « monnaie », c’est le revenu disponible, autrement dit les sommes qui « reviennent » et seront toujours remises en circulation, directement ou via l’épargne, par le béneficiaire du revenu. Et quand ce circuit monétaire est mal bouclé, c’est alors que nous verrons apparaître des thésaurisations liquides, une açon de soustraire à la circulation autant de povoir d’achat que ce liquide peut représenter. La banque centrale peut alors, ou pas, compenser par une création de monnaiecentrale, elle seule, ex nihilo!
Je rappelle que les paiements non liquides via les banques ne peuvent jamais créer de la monnaie, car ce que l’un achète en plus (en empruntant) l’autre, l’épargnant le dépense en moins. Et si par hasard la majorité des comptes courants étaient positifs, cela veut simplement dire qu’une partie de l’épargne y est entreposé, et les banques ne se gêneront pas de les proposer sous forme de crédits, moyennant quoi, il se vérifie à nouveau que les emprunteurs ont vocation d’acheter ce que les prêteurs n’achètent pas eux-mêmes et la fonction des bnques est bien de boucler la boucle du circuit monétaire.
@johannes finckh
Je comprends que cela soit débile pour vous puisque vous êtes fixé à vos propres postulats.
J’ai un esprit ouvert et je peux changer d’avis sans problème si on me démontre de manière logique et claire que j’ai tort.
Mais je vais vous faire une confidence, je ne comprends absolument rien à ce que vous écrivez, attention je ne dis pas que ce que vous écrivez est faux mais c’est incompréhensible pour moi, on doit être câblé différemment!
Cordialement
@J.P. Voyer et @Paul Jorion.
Ma réponse précédente à J.P. Voyer ayant disparu, je ne suis pas sûr d’avoir envie de continuer.
Je vais quand même répondre à Paul, sur le ratio de solvabilité.
Le ratio de solvabilité dépend à la fois des fonds propres de la banque, et de l’encours de prêts.
Si cet encours ne change pas, le ratio de solvabilité non plus.
Si cet encours augmente, le ratio de solvabilité diminue.
Je n’ai jamais parlé d’argent fictif. Pour moi, les prêts ne sont pas de simples jeux d’écriture.
Dans M1 – qui n’est pas, contrairement à ce que CHR écrit – réduit à la monnaie scripturale [M1 est la somme « monnaie scripturale » plus « espèces »] – les dépôts bancaires ne sont pas de simples jeux d’écriture: ils représentent 85% de M1, et sont utilisés dans 95% des transactions. Je rappelle simplement un fait.
Cordialement, B.L.
Qu’est-ce que vous voulez dire : « Ma réponse précédente à J.P. Voyer ayant disparu » ?
Cela m’est arrivé aussi une ou deux fois qu’un de mes messages disparaisse (ces deux dernières semaines, pas avant). Ces messages étaient parfaitement anodins, je n’y ai donc vu aucune volonté de censure (j’en ai eu qui ont sans doute été censurés, mais ils le méritaient au nom du bon goût). Il doit y avoir un bug quelque part.
Attention à la paranoïa, c’est un signe de trollitude (comme dirait Ségolène).
@moi. Vous avez raison, le « moi » est haissable, – pas dans votre cas ;-), et la parano encore plus.
PS. J’aime bien la nouvelle présentation du blog. L’idéal serait d’avoir 2 niveaux de réponse, et pas un seul.
Effectivement, la réponse de Bruno Lemaire a disparu avant l’adresse http://www.pauljorion.com/blog/?p=7821#comment-57275 et ma réponse ne répond à rien.
JPV
@Paul et à CHR.
Je dois une excuse à CHR, que j’accusais, à tort, d’avoir confondu M1 et « monnaie scripturale », alors qu’il avait simplement forgé un concept nouveau, ce qui est tout à fait son droit, « M1 scriptural » mis pour « monnaie scripturale ».
Bien sûr, l’erreur éventuelle de CHR n’est pas là, mais dans le fait qu’il semble écrire que les possesseurs de DAV sont des « déposants ». Ce qui n’est pas le cas, d’après mon analyse du moins. On peut avoir des dépôts à vue (DAV) sans avoir rien déposé, c’est cela un des fondements de la monnaie scripturale.
Cordialement, B.L.
Bruno Lemaire
vous cherchez des poils sur les œufs mais c’est votre droit.
M1 est un agrégat monétaire qui regroupe la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale des DAVs mais comme mon raisonnement est bâti sur la monnaie scripturale je parle pour simplifier de M1 scripturale.
Vous écrivez: « Bien sûr, l’erreur éventuelle de CHR n’est pas là, mais dans le fait qu’il semble écrire que les possesseurs de DAV sont des « déposants » »
Ben oui désolé, d’où l’expression déposer un chèque sur son compte DAV par exemple.
Monsieur Lemaire tout ça ce n’est que de la très mauvaise dialectique qui n’apporte rien. Si j’ai faux il faut le démontrer de manière logique et claire sinon c’est que vous n’avez rien à dire.
@ JP Voyer
Un de vos commentaires est passionnant
« une entreprise, pas plus qu’un particulier, ne peut conserver d’argent scriptural « chez soi ». L’argent scriptural est nécessairement « à la banque ».
Plus loin …
« Or une banque est exactement dans le même cas : elle ne peut conserver aucune trésorerie scripturale, aucun argent scriptural chez elle. Son argent scriptural est… à la banque centrale. »
Enfin
« Conclusion : tout l’argent scriptural de France est dans les machines de la Banque de France. Le vôtre notamment, enfin ce qu’il en reste. Il n’y a aucun argent dans les soldes créditeurs de comptes courants et la prétendue masse monétaire M1-M0 n’est pas une masse monétaire »
Je vais essayer d’articuler ce que vous dites avec l’idée que je me suis modestement fait peu à peu.
Je pense que vous pourrez être d’accord avec moi, même avec votre conception de la monnaie , que c’est bien la banque qui crée la monnaie scripturale , et ceci à la demande par l’économie de monnaie, pour lancer la ronde des échanges.
Bien sûr un besoin de monnaie peut éventuellement être satisfait par un prêt réel (un agent qui prête sa monnaie et accepte donc de s’en priver) ou bien un crédit (personne ne s’en prive, ou bien même , cela ne gênera pas mon raisonnement, personne n’a l’impression de s’en priver) .
Mais dans les deux cas, le système accorde à un agent le droit de prendre dans le stock de biens et services .
S’il a pris, il doit rendre.
La monnaie est ce système génial qui brise le troc dans ses termes, dans l’espace et dans le temps et dans son objet (C’est un échange où les agents ne se connaissent pas, ne se rencontrent pas, qui ne se réalise plus dans l’instant, et dont l’objet est en fait devenu une simple ‘valeur’) …. MAIS … la règle FONDAMENTALE est le respect, au bout du compte de la RECIPROCITE.
Celui qui a pris à la société doit rendre à la société (il n’est plus question ici de Pierre ou Paul , mais de Société et de Valeur)
Lorsqu’un demande de monnaie est faite et réalisée, la banque va tenir la comptabilité de cette simple exigence.
Dans le fond, la banque, le système bancaire, c’est d’abord fondamentalement cela : c’est cette comptabilité là qu’elles tiennent , au départ.
D’ailleurs, au départ les banques prêtent en espèce ou en ‘représentants’ -peu importe qu’ils soient couverts ou non- de ces espèces , puis ne s’occupent plus du trajet effectué : l’important est qu’il y ait remboursement.
Cette créance de Paul envers le système bancaire (quelle qu’en soit l’origine , prêt/crédit), va circuler. Que ce soit de porte monnaie en porte monnaie ou de Dav en Dav importe peu.
Peut on appeler cette créance une promesse de payer ?
Oui , mais si on regarde bien l’essence de la situation, il apparaît clairement que la promesse de payer , ce n’est pas la banque qui l’a faite , mais Paul.
Les choses s’éclairent alors : le seul qui à a « payer » quelque chose , c’est Paul . Et Paul doit payer d’abord et fondamentalement, non pas pour rembourser tel ou tel, ou la banque (suivant qu’il y a eu prêt ou crédit) , mais parce qu’en payant il a automatiquement remis dans le stock des biens et services , quelque chose de valeur équivalente à ce qu’il avait pris.
La banque est l’institution au travers de laquelle, la société fait respecter le principe de réciprocité.
Ce qui a circulé était bien la promesse de payer de Paul. Cette promesse qui circulait devait se réaliser, sans quoi la monnaie aurait été fausse. Et à la limite,la question de savoir si c’est Pierre qui sera remboursé parce qu’il était le prêteur initial, ou bien si c’est la monnaie-créance qui s’autodétruira puisque Paul ne doit plus rien , est secondaire.
Puis vint l’invention du dépôt.
Les banques deviennent , en plus de leur rôle fondamental, nos portes-monnaies, avec l’invention du Dav.
La logique est la même. Sauf que la banque tient la comptabilité du trajet de l’ancienne monnaie sonnante et trébuchante. La banque n’a pas particulièrement à « payer »quoique ce soit à qui que ce soit , elle fait circuler, elle note et rend compte.
Circulent donc toujours des promesses de payer. Mais cette promesse de payer n’est pas celle de la banque , mais celle de Paul.
Le paiement c’est la réciprocité respecté qui va le réaliser !!!
La monnaie scripturale tient donc bien sur ses jambes, toute seule.
Le système bancaire n’est qu’une énorme machine à faire tenir aux agents économiques la règle de réciprocité , et à tenir notre comptabilité.
Du point de vue de la banque, de son point de vue , il n’y a rien dans sa caisse , rien . Sa monnaie ne vaut que du dehors, que pour les agents économiques. Sa monnaie ne vaut rien pour elle-même.
Il n’y a que le vertigineux vide d’une comptabilité qui tend vers son néant, et n’existe que l’espace d’un instant, le temps de rembourser, donc de rendre à la société , et l’espace de cet instant quelques misérables billets , un presque faux trésor pour quelques opérations de trésorerie .
Mais bien sûr, le cours forcé de la monnaie BC fiduciaire et l’obligation théorique faite aux banques de convertir les dépôts en espèce peuvent donner l’illusion que « payer » c’est sortir des billets et des espèces ! Non, « payer » c’est respecter la réciprocité . Et donc une Unité monétaire, une Monnaie souveraine « vaut », non pas sur sa base fiduciaire ou B.C. , mais sur sa qualité à respecter l’échange.
PS/ Bon j’ai dû rater l’articulation avec votre texte … parce que je ne vois plus le rapport , bon, j’ai toujours eu la pensée buissonnière … pourtant ça m’inspirait 😉
oppossum écrit ceci:
« Les choses s’éclairent alors : le seul qui a à « payer » quelque chose , c’est Paul . Et Paul doit payer d’abord et fondamentalement, non pas pour rembourser tel ou tel, ou la banque (suivant qu’il y a eu prêt ou crédit) , mais parce qu’en payant il a automatiquement remis dans le stock des biens et services , quelque chose de valeur équivalente à ce qu’il avait pris. »
Je comprends mal cette phrase: ce que l’on constate est que Paul (pardon monsieur Jorion!), en payant, a retiré de la marchandise (biens ou services) du marché et qu’il a confié autant d’argent à son vendeur qui, lui, dispose dès lors du pouvoir d’achat pour acquérir d’autres biens ou services, et ainsi de suite. Paul a laissé, comme cela se fait toujours, l’argent sur le marché et retiré de la marchandise. L’argent ne se trouve pas « dans le stock des biens et services! », cela ne fait pas sens de l’écrire ainsi! Dans le contexte ici, la monnaie fait demande et la marchandise l’offre.
Dans mon esprit et mon raisonnement, lorsque j’écris
« mais parce qu’en payant il a automatiquement remis dans le stock des biens et services » …
… je ne m’occupe pas du paiement et des signes monétaires , mais du fait que le remoboursement est la preuve qu’il a remis un bien ou service concret à la disposition de Tous.
(Puisque pour rendre la somme emprunté, il a dû travailler -fournir un bien/service aux autres- pour regagner les jetons-monnaie.
Donc, du point de vue de l’exigence de réciprocité , peu importe à qui il rembourse et même si cet argent existe réellement ou pas etc etc … l’important quand on a pris (à Tous) de rendre (à Tous) : et « payer » c’est satisfaire à cette exigence, la seule qui éteigne vraiment -quant au fond- la dette, la promesse de payer.
Et ce n’est pas la banque qui est chargé d’assurer cette promesse de payer.
Bien sûr d’un point de vue juridique , la promesse de payer n’est éteinte que lorsque le remboursement en monnaie (fidiciaire ou scripturale) est constaté : personne n’ira vérifier comment a été acquis cet monnaie , et si elle respecte vraiment le réciprocité.
Mais la vie est comme cela , le monde est ainsi : on n’a jamais la preuve totale que la réalité est vraiment réelle , on le suppose au travers d’un certain nombre d’indices.
à oppossum (suite) qui écrit encore ceci:
« Ce qui a circulé était bien la promesse de payer de Paul. Cette promesse qui circulait devait se réaliser, sans quoi la monnaie aurait été fausse. Et à la limite,la question de savoir si c’est Pierre qui sera remboursé parce qu’il était le prêteur initial, ou bien si c’est la monnaie-créance qui s’autodétruira puisque Paul ne doit plus rien , est secondaire. »
Une créance « s’autodétruit » comme vous écrivez quand elle n’est pas remboursée, car dans ce cas, le prêteur est de sa poche… Quand elle s’éteint parce que remboursée, c’est le débiteur qui a payé son dû. En tout cas, la créance ne circule aucunement, mais l’emprunteur dépense l’argent (en valeur) à la place du créancier pour rendre plus tard ce qu’il doit, souvent par mensualités. Car le réancier ne dépense pas lui-même la somme prêtée, sinon, il ne l’aurait pas prêtée! Elémentaire, non?
Autrement dit, et encore une fois, cessez d’affirmer que le crédit, même bancaire, créerait ne serait-un centime. Si c’était le cas, ce serait un cas pour la brigade financière!
pour la fin du texte d’oppossum, cela devient plus clair, et je suis pratiquement d’accord avec ses formulations quelque peu alambiquées:
« Mais bien sûr, le cours forcé de la monnaie BC fiduciaire et l’obligation théorique faite aux banques de convertir les dépôts en espèce peuvent donner l’illusion que « payer » c’est sortir des billets et des espèces ! Non, « payer » c’est respecter la réciprocité . Et donc une Unité monétaire, une Monnaie souveraine « vaut », non pas sur sa base fiduciaire ou B.C. , mais sur sa qualité à respecter l’échange. »
Non, cette promesse est ferme est bien la clé de voûte du système! Et tant qu’elle est crédible, elle ne se réalise que peu, évidemment. « Payer », c’est donner de l’argent (ou transférer une créance) pour obenir un bien ou pour éteindre une dette. La « réciprocité que j’y vois, c’est cela!
Il reste que le moyen de paiement reste dans le circuit, alors que les biens et servives sortent continuellement du marché pour être, via la production, remplacés par de nouveaux. L’échange, la « réciprocité » est donc l’instantané du changement de main de la monnaie et de la marchandise, c’est tout.
Une partie d’une réponse possible est plus bas !
Je rajoute juste ceci à votre remarque suivante
Payer », c’est donner de l’argent (ou transférer une créance) pour obenir un bien ou pour éteindre une dette » …
… utiliser de la monnaie quoi …
@johannes, qui écrit:
« ce qui achète et fonctionne donc comme « monnaie », c’est le revenu disponible ».
Ah, si cela pouvait être vrai, il n’y aurait plus de problème monétaire: une parfaite adéquation de la « monnaie » aux richesses réelles, c’est cela que tout le monde recherche, ou devrait rechercher. B.L.
« Non, cette promesse est ferme est bien la clé de voûte du système! Et tant qu’elle est crédible, elle ne se réalise que peu, évidemment. « Payer », c’est donner de l’argent (ou transférer une créance) pour obenir un bien ou pour éteindre une dette »
Oui juridiquement, payer c’est donner de la monnaie , mais je vous parle de la réalité , de celle que le système lui même cherche , par un ensemble d’institutions et d’indices , à atteindre.
Ce n’est pas la banque qui paie à votre place , presque jamais, et même lorsqu’elle vous accorde un crédit , des promesses de payer, elle se contente de faire tourner la dette , quelque soit le support symbolique ou même dématérialisé de cette dette.
Transformer de la monnaie scripturale en monnaie fiduciaire , ce n’est pas payer réellement, c’est changer une dette de forme. C’est tout.
Vous écrivez : « Non, cette promesse est ferme est bien la clé de voûte du système! Et tant qu’elle est crédible, elle ne se réalise que peu, évidemment. »
Je pense que votre esprit confond le « payer » fondamental et le cas particulier d’ « endosser la perte » : cette dernière est la seule obligation à laquelle s’engage la banque .
Mais si vous réduisez la réalité du paiement à un cas particulier (si essentiel soit-il) , on ne sait plus trop de quoi on parle , et il faut inventer un nouveau mot pour désigner le cas général.
Vous écrivez « la « réciprocité » est donc l’instantané du changement de main de la monnaie et de la marchandise, c’est tout »
Mais c’est la petite réciprocité celle là, celle de surface, celle qu’il faut bien accepter comme le signe que la grande s’est probablement réalisée !
Ce n’est pas faux , mais c’est cela qui vous fait croire que la promesse de payer est celle de la banque: alors que la banque tient une comptabilité d’un côté , et de l’ autre fait respecter la règle de qui à pris doit rendre (sans préjuger de la source ayant permis de prendre dépôt ou crédit pur)
PS/
« et je suis pratiquement d’accord avec ses formulations quelque peu alambiquées: » : nous n’aurons pas profité de ce plaisir bien lontemps 😉 !
@Paul,
je m’aperçois que je n’ai pas répondu entièrement (sur la liquidité, en fait) à l’une de vos questions. J’ai tenté de répondre sur la solvabilité, mais je pense que la liquidité, elle aussi, est intéressante.
B.L. écrivait: Bien entendu, lorsque les ratios de liquidité de la banque sont voisins du maximum, cette banque peut avoir besoin de se refinancer, un des moyens en sa possession étant de s’adresser auprès de la banque centrale.
Paul écrivait: Pourriez-vous expliquer plus précisément ce mécanisme ?
Je commence, donc. Ce n’est pas pour revenir sur un débat, mais juste pour préciser les mécanismes tels que je les comprends, avec des mots aussi neutres que possible.
La liquidité, pour moi, dans ce commentaire, dépendra du montant d’espèces dont la banque concernée dispose, que ce soit en fonds propres ou en dépôts (oui, il peut aussi y avoir des espèces dans les dépôts ;-)).
Le ratio de liquidité sera le rapport entre « en-cours de crédits » et « espèces ».
Supposons que pour diverses raisons, certaines liées à la politique de la Banque Centrale, ou à des réglements divers, d’autres à l’état d’esprit plus ou moins prudent des dirigeants de la banque, d’autres enfin au contexte économique, la banque concernée, disons la banque Duchmol, veuille que ce ratio ne dépasse jamais 6 (ou le ratio inverse, 1/6, soit de l’ordre de 16,66%).
Si un client spécialement intéressant, disons André, vient solliciter un prêt, alors que le ratio de liquidité est déjà atteint, trois solutions classiques s’offrent à la banque (en dehors de refuser d’accorder un nouveau prêt, bien sûr).
a) Duchmol peut essayer d’obtenir des liquidités(=espèces) supplémentaires (la locution « se refinancer » si elle est souvent employée, est sujette à caution dans ce contexte) auprès de ses collègues, sur le marché interbancaire (voire passer directement des accords avec une banque amie)
b) Duchmol peut essayer de trouver des liquidités (=espèces =monnaie fiduciaire) sur le marché monétaire
c) Duchmol va solliciter un emprunt auprès de la Banque Centrale (ce qu’avait évoqué J.P. Voyer dans un commentaire précédent, je crois): le compte de Duchmol auprès de la Banque Centrale sera ainsi modifié (compte en monnaie scripturale, mais bancaire celle-ci) et Duchmol pourra ainsi récupérer des espèces, lui permettant de prêter à André de la monnaie scripturale bancaire. Ainsi, dans ce cas c), on aura eu d’abord une augmentation de M0 (monnaie centrale), puis de M1 (au moment de l’octroi du prêt).
En espérant avoir été suffisamment clair, cordialement, B.L.
L’idée qui me vient , JF est que votre conception de la monnaie a non seulement le désavantage d’être fausse , ce qui dans d’autres cas peut n’être pas très grave, voire être même réjouissant car l’erreur a les attraits de la fantaisie et de la liberté parfois, mais qu’elle a le gros désavantage de vous boucher la vue.
Ainsi , si la monnaie scripturale , celle par laquelle toute la crise est en train de se jouer actuellement, ne doit son essence , sa réalité, son début et sa fin, que par, pour, à cause , grâce à etc … la monnaie B.C, alors la « solution » se trouve (ou a de grande chance de se trouver) dans la monnaie B.C.
A la limite, il suffit d’ émettre. Et d’empiler des reconnaissances de dettes qu’on remboursera à la St Glinglin. On regonfle la monnaie, certes , mais en aggravant ou déplaçant le problème.
[Bien sûr, il y aura toujours une solution qui consistera à supprimer les marchés , puis à tout étatiser. Mais même après cela, la monnaie s’effondrera fatalement puisqu’elle ne peut-être , au bout du compte , que le reflet des richesses. A moins qu’une loi n’instaure, en plus du cours forcé de la monnaie d’Etat , celui de la richesse automatique par voie légale et réglementaire ! . Mais je sais que ne penchez pas de ce côté là 😉 ]
Mais si l’on considère la base réelle de la monnaie actuellement, alors le problème devient celui de la qualité de la créance sur Paul, que la société fait circuler comme monnaie! Et la solution est de réfléchir à une meilleure qualité des créances ou des dettes (suivant l’angle d’où l’on se place).
C’est à dire qu’il faut réfléchir sur l’idée de crédit dans son ensemble à la limite , qu’il soit ‘financé’ par le prêt (un recyclage temporaire de crédits ) ou bien du ‘crédit pur’ .
Bref, il faut réfléchir à la Dette et à sa qualité !
Mais attention , il y a Dette et Dette ! … même si les choses sont liées et si une dette reste une dette.
Si la monnaie a pour fondement la dette , il faut distinguer la dette qui génère du signe monétaire de celle qui ne fait que déplacer des signes monétaires. Et là , on doit ré-introduire la question du ex-nihilo (épargne ex-post) et de l’épargne pré-existante (ex-ante).
Dans mes analyse précédente pour aller à l’essentiel je les ai un peu confondues, mais leur solidité n’est pas du tout la même, or l’idée étant à présent d’analyser la qualité de la dette, il faut un peu s’y pencher.
Tout emprunt (donc dette) est un pari sur le futur comportant un risque.
Si la solidité de la monnaie et donc du système repose sur la qualité de la dette , cela revient à dire que la monnaie dépend de la qualité des paris de production faits sur le futur et donc du risque.
Et une partie de la question devient : qui supporte le risque ? et comment est-il supporté ?
Si Pierre a prêté à Paul , et s’il n’honore pas son remboursement , le perdant est Pierre , la chose est claire : on peut dire que Pierre a « payé » la dette de Paul … à lui même . La (dette/)créance-monnaie qui courait voit sa qualité se dégrader mais cette dégradation est contre-balancée par le fait que Pierre ‘paie’ la dette de Paul en endossant la perte. Bruno dirait M1 ne bouge pas.
L’activité bancaire n’est pas mise en cause dans son ensemble : les dégâts sont cantonnés à un segment précis . La réciprocité sera assurée par une punition à Pierre.
Si l’emprunt provient plutôt du ex-nihilo, donc d’un pur crédit, la chose est plus compliquée !
La Banque doit assumer c’est à dire que , bien qu’elle ait créé (plus ou moins) cet argent (en tout cas sans spécifier comptablement et clairement d’où il venait) de nulle part, elle doit alors le trouver tout à fait concrètement pour le faire d’ailleurs disparaître ! Elle doit assumer la perte sur ses fonds. Car il n’y a pas Pierre derrière ce prêt non remboursé.
Bon, ma foi , la aussi le système , impitoyable cherche a assurer coûte que coûte la règle de réciprocité : le puni sera le système bancaire.
Or , léger détail qui a son importance, l’organisateur et le générateur de la monnaie de Tous , c’est la banque !
C’est à dire que ce système de crédit , en cas de défaillance sur les remboursements , punit l’institution qui , précisément organise la monnaie.
Notre monnaie est à la merci de la moindre défaillance de non remboursement des vrais-crédits .
Cependant, mais il faut que j’arrête là, d’autres éléments peuvent miner la monnaie au travers d’une dégradation de la qualité d’une dette : par expl , tout simplement le nombre ou bien l’échéance trop lointaine ou trop irréaliste , sans que théoriquement la possibilité du non-remboursement soit vraiment actée !
Je résume (en fait c’est pour moi que pour vous) : la constatation ou la supposition ou le doute sur un non-remboursement affecte automatiquement la monnaie. Et le système du crédit pur est encore plus dangereux systémiquement que le système laborieux de l’épargne ex-ante qui a le double avantage de faire des victimes moins dangereuses et de brider la quantité des dettes (on s’arrête de prêter quand il n’y a plus d’épargne !)
De plus l’épargne ne va plus s’égayer dans les joies des spéculations bulliques !
Bon mais c’est un peu triste comme système, l’épargne ex-ante, je sais.
PS/ … la monnaie fondante … ? oui , je sais … 😉
@Oppossum et Johannes,
je pense que le billet d’Oppossum peut nous inciter à réfléchir sur un problème majeur, celui de la qualité des créances – ou des dettes, si vous préférez. Cela faisant, cele peut permettre de dépasser le débat apparemment stérile entre « créationnistes » et « anti-créationnistes », et aborder la véritable question.
Comment faire en sorte que les mécanismes monétaires, actuels ou futurs, soient mieux adaptés au « bien commun » – en laissant de moins de gens possible à l’extérieur de ce « bien commun »?
Comment faire en sorte que les capacités potentielles de production ne soient pas tellement sous-utilisées, avec tant de besoins tant matériels que « culturels » non satisfaits? Il s’agit bien ici, et ansi, de qualité au moins autant que de quantités.
Cordialement, B.L.
J’avoue que les choses deviennent un peu trop compliquées tant que nous sommes à ce point en désaccord sur la définition de ce qui est monnaie.
Je recommence. Le billet émis par la banque centrale n’est en aucune façon une dette. C’est une dotation régalienne émise en fonction d’un rapport de prix aussi stable que possible. Le fait que la BC perçoit un intérêt auprès des banques peut induire en erreur en croyant que ce taux, le REFI essentiellement, influencerait le taux monétaire interbancaire ou celui du crédit ou de l’épargne. Cela n’est pas le cas comme nous le voyons bien actuellement où le REFI est très bas sans que les autres taux baissent autant. Le REFI es un instrumen de politique monétaire qui permet d’émettre plus ou moins de monnaie centrale, tout comme par exemple l’achat d’or ou de devises qui conduisent aussi à augmenter la masse de numéraire circulante.
La BC émet les billets en les faisant imprimer avec de l’encre spécial sur du papier spécial. Formellement, le billet reste propriété de la BC, par contre, le pouvoir d’achat appartient pleinement au détenteur à tout moment. Le détenteur n’a aucune dette qui résulte de la détention du billet. Quant à la banque, elle veut récupérer le billet pour moins se refinancer au niveau central, ce qui lui coûte (un peu).
Evidemment, les banques cherchent à limiter l’usage du numéraire qui n’est pas toujours pratique et leur génère des coûts. C’est pourquoi les comptes courants trouvent un attrait, car les services bancaires peuvent, pour le compte de leurs clients opérer un grand nombre de transactions tout en limitant l’usage du billet. Tous y trouvent un avantage. On peut dire que plus l’usage des comptes courants s’étend, moins le numéraire circule.
Et si on définit légitimement, comme je le fais souvent, comme « monnaie » ce qui achète réellement les biens, services et biens d’équipement offerts sur le marché, je maintiens que ce sont les revenus des ménages, par leurs achats, qui représentent cette monnaie effective.
Il reste que le numéraire reste le moyen légal, la clé de voûte, au sens où, quand je « réalise » mes revenus en billets, personne ne me doit plus rien et je ne dois rien à personne.
Il en va autrement pour les comptes courants. La banque me doit à tout moment la somme créditée sur mon compte, et en transférant ces créances sur d’autres clients de la même banque ou d’une autre banque, ce que la banque me doit diminue et ce qu’elle doit au bénéficiaire du transfert augmente. En principe, j’aurai obtenu en échange une marchandise ou un service.
Il reste que l’on ne peut acheter que ce qui existe réellement à tout moment, et les fameuses anticipations ne sont que des orientations des achats vers une production et impliquent automatiquement que d’autres productions cessent ou se font moins. C’est en ce sens que je soutiens que le crédit n’est en rien une anticipation du futur au niveau des transactions, mais seulement une orientation plus ou moins péculative.
Par ailleurs, quand je prête à la banque en tant qu’épargnant et que la banque me rémunère cela, cela implique tout aussi automatiquement que la banque prête ce que l’on lui prête ainsi. En accordant un crédit, la banque doit trouver simultanément des fonds que d’autres lui prêtent, sinon, elle n’accordera pas ce crédit. Et ceux qui prêtent, par la force des choses, n’achètent pas ce que l’emprunteur achète à sa place en empruntant.
Macroéconomiquement, il est totalement impossible que la banque crée de la monnaie via le crédit, car cela voudrait dire que les revenus monétaires disponibles auraient augmenté avec un stock de marchandises et de services et de biens d’équipement donné au présent. Nous aurions dès lors de violents mouvements inflationnistes, ce qui n’est manifestement pas le cas. Une inflation ne se déclenche que quand s’ajoute à la circulation monétaire bancaire un pouvoir d’achat supplémentaire, par exemple du numéraire nouveau ou déthésaurisé. De même une accélération de la circulation accompagne toujours un démarrage d’inflation, car la hausse des prix à venir pousse à acheter plus maintenant pour un stock de marchandises donné pour avoir plus de marchandises pour son argent aujourd’hi que demain. En réduisant le numéraire en circulation, la BC a toujours les moyens de juguler une inflation, mais cela peut se révéler coûteuse pour l’économie, c’est pourquoi elle laisse parfois faire pendant un temps.
Pour les mouvements déflationnistes liés à un ralentissement de le circulation monétaire, les moyens d la BC peuvent s’avérer insuffisants, car une émission supplémentaire de numéraire n’irrigue pas nécessairement l’économie du fait que ce numéraire peut être aussitôt thésaurisé, et il l’est de plus en plus actuellement. Nous aurons dès lors du pouvoir d’achat gelé et des produits invendus.
Il reste, dans tout ce mécanisme, le constat que les fonds collectés par les banques auprès du public représentent ce que les banques s’efforcent de placer sous forme de crédits, sinon, elles ne se donneraient pas la pein de les collecter.
Et la monnaie obtenue de la BC sous forme de réserves obligatoire par exemple ou en échange de prises en pension n’est utilisée que très marginalement pour les crédits, car les banques doivent les garantir avec leurs fonds propres, quelques milliards, qand le volume des crédits dépasse aisémement les milliers de milliards. Rien que ces ordres de grandeur indiquent que ces deux circuits sont en fait de nature très différente. Le circuit BC -Banques d’une part et le circuit Banques – clients d’autre parts, et ces deux circuits ne se mélangent qu’à la marge pour des raisons techniques basiques.
Le circuit BC-Banques alimente le système en numéraire, et le circuit Banque-clients fait circuler la « monnaie-revenus »
Je ne sais pas maintenant si ces rappels vont faire avancer le débat, je suis fatigué.
D’où vient l’intérêt, la rente du capital?
Là, dans le circuit décrit, cela n’apparaît guère. Pour le déceler, il faut bien s’intéresser au numéraire au plus près et au fait particulier que le numéraire, le signe monétaire, peut circuler ou pas circuler à la guise de son détenteur. Pourqu’il circule, il exige et otient un intérêt, sinon, il réalise tous ses avoirs en banque en numéraire quand cela lui chante. L’intérêt de la monnaie, l’intérêt monétaire net résulte de ce chantage. D’où ma proposition de faire circuler le signe monétaire inconditionnellement en lui imprimant la marque du temps. Le signe monétaire marqué par le temps, le SMT (anciennement appelé aussi « monnaie fondante » improprement), obtiendrait que le circuit monétaire resterait toujours bouclé et pleinement efficace sans intérêts, moyennant quoi, les phénomènes des intérêts et des intérêts des intérêts disparaîtraient, et les écarts de fortune s’équilibreraient peu à peu. Nous aurions dès lors une circulation monétaire constante, ni chômage ni inflation ou déflation. C’est pourquoi j’abandonne le terme de « monnaie fondante », car il prête toujours à confusion en pensant que a masse « fondrait », ce qui n’es pas le cas avec le SMT, car la part disparaissant par le marquage du temps serait automatiquement restituée par la BC, et le fait que les thésaurisations auraient disparu, ce marquage se révèlerait être d’un coût tout à fait marginal et négligeable,surtout si on le rapporte à la grande puissance transaction désormais de l’unité monétaire et si on le compare au coût de la rente du capital actuelle, c’est-à-dire 40% du PIB.
Je m’arrête là pour ette fois-ci.
Opposum et Johannès,
Vous êtes bien gentils, et somme toutes assez intéressants, mais, en même temps que ces principes de transformations monétaires que vous cherchez très légitimement, quoiqu’un peu « byzantinement », à épurer, il y a les intérêts bancaires qui courrent et qui faussent, inéxorablement, les résultats jusqu’à devenir, cette fois, des intérêts composés, et qui faussent, encore plus inéxorablement, avec le temps, les résultats – qui deviennent tout faux – « de la parfaite adéquation de la « monnaie » aux richesses réelles, c’est cela que tout le monde recherche, ou devrait rechercher », ainsi que le souligne si bien Bruno Lemaire, ci-dessus, 16 février à 10:34.
Car l’urgence et la priorité entre toutes est, effectivement ici ci-dessous. Nombreux se passionnent pour cette approche des échanges économiques, ainsi l’écrit ici sentier 198, le 15 février 2010 à 18:58et qui transmet très opportunément le site qui suit ci-dessous. Je connaissais déjà Janpier Dutrieux et reconnais mon tort ne pas avoir assez « exploité » et répercuté ses études passionnantes et fournies, car elles sont, dans la suite logique de Clifford Hugh DOUGLAS, celui qui est le dénomminateur commun d’un nombre croissant d’investigateurs (qui connaissent ou pas Douglas d’ailleurs) pour le Justice économique et monétaire:
http://fragments-diffusion.chez-alice.fr/prospective.html
Oui merci quand même, mais je suis un peu laborieux et pour l’instant je mets l’intérêt … de côté 😉
Je pars du principe que même en système de monnaie 100% qui a déjà été testé puisque c’est le système qui fonctionne jusqu’au XVIe siècle, l’intérêt existait déjà.
Or dans pas mal de schémas on nous explique que la spécificité du dysfonctionnement actuel c’est l’intérêt : le système nous forcerait à rembourser plus qu’il n’émet de monnaie … (argent-dette patati-patata) .
Mais je note pourtant ce fait que l’intérêt existait et fonctionnait avant dans un système à monnaie fixe en quantité, et j’en conclus donc que donc l’intérêt ne suppose pas forcément une augmentation des signes monétaires)
Car alors , si cela était vraiment vrai , comment l’intérêt a-t-il pu fonctionner avant ?
Ok je simplifie un peu, mais il y a bien un bug dans le raisonnement qui pose que l’intérêt est la cause de tout.
Bref je ne dit pas que l’intérêt n’est pas un concentrateur de richesse , donc je ne dis pas qu’il n’est pas un déstabilisateur , mais je me dis que même s’il contient une contradiction , d’autres mécanisme la lèvent probablement , qu’il y a autre chose de plus profond pour expliquer la (les) crises(s)
Une incise en passant : l’intérêt est concentrateur de richesse , mais pas forcément destructeur de la valeur de la monnaie, qui peut tout a fait « refléter » la richesse réelle globale sur le marché (avant une révolution , ok ! ) .
Il n’y a pas à dire. Le blog y gagne en lisibilité et en netteté. Au diable le marron. Au diable les nègres marrons. Auriez-vous préféré le Feldgrau (vert de gris, vert des champs, camouflage de triste mémoire).
JPV
Un petit mot rapide pour vous remercier de tous vos efforts.
Je pensais bien avoir compris pourquoi il n y avait pas de création monetaire, mais désormais, ce savoir est consolidé. Puissent les comptes des banques – et des États européens ? – en faire autant.
Amicalement,
David
C’est bien beau tout cela mais où voulez vous en venir à la fin ?
Parce que j’ai l’impression qu’on tourne en rond.
Quand bien même toutes les dettes seraient dans le bilan de la banque centrale, si j’ai bien compris JP VOYER, et auraient été de ce fait convertit en « argent » as good as gold.
Est ce que c’est la banque centrale qui va annuler les impayés des prêts en mettant la main à la poche puisque c’est as good as gold ?
J’avoue que je ne vous suis plus, je comprends de moins en moins ce que vous voulez démontrer ???
L’intérêt de la monnaie prend sa source dans le signe monétaire conçu comme durable. Car c’est sa fonction « réserve de valeur » qui en fait un bien stockable et thésaurisable. Thésaurisé, ou menaçant d’être thésaurisé, le signe monétaire durable (le SMD) ne revient circuler via les banques que moyennant intérêt. C’est pourquoi, pour supprimer l’intérêt, cause même du capitalisme, je préconise le signe monétaire marque par le temps ou SMT.
L’obscénité du capitalisme est causé par la perversité du SMD, véritable objet fétiche qui finit par bloquer les échanges économiques en creusant toujours davantage les écarts de richesse.
@Oppossum sur l’intérêt et l’augmentation des signes monétaires.
Vous avez raison, si on emprunte 100 millions à 6%, par exemple, on peut rembourser l’intérêt en « richesses réelles », par exemple en se séparant d’un bien qui serait évalué à 6 millions, tout en remboursant le principal avec les 100 millions de signes monétaires initiaux (ou leur équivalent)
Mais cela ne change pas vraiment le principe, je pense. Il n’y a certes pas nécessité d’augmentation des signes monétaires, mais il y a enrichissement du prêteur, « injustifié » si ce taux de 6% dépasse le taux « éthique » (taux de croissance corrigé de l’inflation). Cordialement, B.L.
Attention Bruno, !!!!,
si vous confirmez cela vous réduisez à néant toute une partie des analyses qui font de l’intérêt un principe anxiogène monétaire ! … et de tout ceux qui basent leurs critiques monétaires sur cette course folle genre mission impossible, que nous mènerions tous , consistant à à donner 100+6 alors que seulement 100 ont été crée.
Je pense qu’en fait le système peut fonctionner à M1 constant, en ce que la contradiction est levé par une vente d’un bien de 6 : cette vente se fait en réalité avec la monnaie des 100 en cours de route .
Si notre raisonnement est exact, c’est effrayant ! (Comme on peut se tromper facilement)
(Rendons à Paul ce qui est à Paul : il a toujours parlé de ‘déplacement de bloc de richesse’ pour penser l’intérêt)
Néanmoins probablement que , même si l’intérêt peut fonctionner sans augmentation de M1, l’augmentation de M1 constaté a certainement a voir dans la constitution de l’intérêt. Probablement qu’elle atténue les rigueur de la concentration de richesse, dans un début de schéma à la Ponzi (?)
Je vais prendre un peu de temps (beaucoup boulot) et vous laisse la charge et la gloire (mais aussi souci, car là il y aura beaucoup d’opposants , même ici, et surtout ailleurs! ) de prolonger notre ‘invention’ (puisque nous ‘découvrons’ ce que d’autres ont déjà pensé : ‘réaliser’ -consciemment- la vérité est un éternel recommencement ) !!!
@Oppossum, qui me prédit beaucoup (trop) d’honneur et beaucoup (trop) de contradicteurs.
Je ne pense pas avoir écrit des choses bouleversantes, de plus personne n’est infaillible, surtout pas moi.
Vous faisiez référence à un contexte ancien pour lequel nombre de transactions ne se dénouaient pas monétairement: les faits sont têtus, et il faut bien rendre compte aussi de ces situations, même si notre « théorie » semble mise en défaut.
Pour en revenir à mon « éventuelle » trouvaille, je dis simplement que, pour rembourser des intérêts, en plus du principal, à un prêteur, soit vous remboursez en monnaie, soit vous remboursez autrement (« en nature »)
Il serait excessif, je crois, d’affirmer que c’est soit l’un, soit l’autre, mais jamais une combinaison des deux.
Si c’était SEULEMENT en monnaie, il faudrait, pour cela, s’appuyer sur une augmentation monétaire (relative) de 6%.
Si c’était SEULEMENT en nature, la masse monétaire pourrait rester constante.
Si, maintenant, nous regardons les faits, nous voyons que la masse monétaire M1 est passée – pour la France – en 20 ou 25 ans, de 26% du PIB à 46%. Chacun jugera donc de la proportion « remboursement en nature » vs. « remboursement monétaire ».
Deux remarques pour finir:
a) Je maintiens ma « loi » – presque évidente: si le taux d’intérêt est supérieur au taux « éthique » (taux de croissance corrigé de l’inflation) le prêteur s’enrichit aux dépens de l’emprunteur
b) Pour rembourser leurs dettes, les états peuvent, effectivement, abandonner leurs « bijoux de famille » (cela n’aura qu’un temps). On peut imaginer que de nombreuses usines grecques, par exemple, soient ainis rachetées par la Chine, ou que le Parthenon tombe sous tutelle saoudienne. Je crois cependant que la Grèce fera tout pour ne pas en arriver là, quitte à refuser de rembourser sa dette.
Merci en tout cas pour cet échange, merci aussi à Paul pour l’avoir permis.
Cordialement, B.L.
Il n’est pas nécessaire d’introduire de « richesse réelle » dans le raisonnement. Il suffit que vous réussissiez à convaincre qqn de vous donner les 6 millions (que ce soit en contrepartie de richesse « réelle » ou non; après tout ce qui constitue une « richesse » est éminemment subjectif)
Sur la monnaie fondante (ou « biodégradable ») et l’inflation.
L’un des avantages de la monnaie « à la Gesell » c’est qu’elle correspond, entre autres, à une inflation « contrôlée », affichée, sur laquelle on peut faire des calculs économiques précis. Si cette monnaie perd 1% de valeur par trimestre, c’est une forte incitation pour ceux qui ont quelques « économies » à les dépenser rapidement, bien sûr.
Au contraire, dans le cadre d’une inflation non maîtrisée, même si, dit-on, l’inflation est l’euthanasie des rentiers, les gagnants seront ceux qui maitrisent le mieux l’évolution des signes monétaires et des taux d’intérêt, et les calculs économiques seront plus délicats.
B.L.
« Monnaie biodégradable » : pas mal ! (Allons plus loin et parlons de « monnaie durable » (tant qu’on y est 😉 ) )
Ceci dit, nous utiliserons alors une autre monnaie pour stocker la valeur.
– Faire perdre à la monnaie sa fonction ou plutôt qualité fondamentale de réserve risque d’entraîner des phénomènes de protection et de comportement non maîtrisables …
– Pourquoi toujours cette fixation sur la ‘consommation’ : on voit bien que qu’une fois les besoins fondamentaux d’un groupe assurés, on passe frénétiquement à la production de l’inutile : c’est une façon de partager et d’occuper les gens , un peu mieux que les ateliers nationaux certes …
(Attention toutefois de ne pas confondre l’inutile-inutile , de l’inutile-utile ) … et qu’on ne s’occupe que très peu des besoins de ceux dont l’éco-système économique et culturel a été pulvérisé par le nôtre, de système !
justement le signe monétaire n’est pas « fait » pour stocker de la valeur. Quand il le fait, il n’est plus signe monétaire, car ne circulant plus, il est dès lors thésaurisé.
La monnaie, elle, devient justement durable quand elle devient « biodégradable » comme vous écrivez. Car, comme le rappelle Gesell, la part « fondue » est bien à reémettre par la BC. Cela n’empêche en rien l’épargne, car le pouvoir d’achat de l’épargne serait toujours stable avec la « monnaie biodégradable », mais pour comprendre cela, apprenez enfin à distinguer épargne et thésaurisation. Ce sont deux choses très différentes et s’excluant mutuellement.
Car l’épargne est le retour en banque du revneu non utilisé par le titulaire, alors que la somme thésaurisée est le non-retour de cet argent, mais la disparition sous le matelas et la mise hors circulation.
Mais il fautdrait que vous révisiez l’économie de fond en comble et que vous oubliiez à peu près tout ce que vous avez pu enseigner depuis trente ans! C’est alors seulement que vous auriez une chance de saisir un peu quelque chose.
@ JF !
1) « Le billet émis par la banque centrale n’est en aucune façon une dette »
–> Oui, je crois qu’on peut imaginer les choses ainsi, mais -et vous ne serez pas d’accord- parce que ce billet n’est qu’une conversion de la monnaie scripturale en une autre monnaie disposant d’attributs plus puissants reposant sur la force de l’Etat. Réfléchisez à la façon dont sont introduit la monnaie B.C.
De plus l’Etat peut également décider de faire fonctionner de fait, par de multiples moyens, ce qu’on peut appeler la planche à billet. Derrière cette inondation pas de dette (ou des moyens de la faire disparaître).
Néanmoins quelqu’un devra endosser la perte que représente un signe monétaire n en fin de compte n’est pas dette, c’est à dire qui ne sera pas détruit par un remboursement : et ce sera la collectivité elle même de façon ‘non douloureuse’ .
La B.C. peut donc s’affranchir de la règle de la réciprocité puisque son geste est assimilé comme relevant du bien pour la collectivité . Et je trouve cela normal, mais il n’empêche que la perte existera nécéssairement par une destruction de valeur portant sur la billet lui même, donc la monnaie.
2) « Et si on définit légitimement, comme je le fais souvent, comme « monnaie » ce qui achète réellement les biens, services »
–> nous sommes donc bien d’accord avec une définition fonctionnaliste de la monnaie (Ca va être triste d’être d’accord 😉 )
3) « je maintiens que ce sont les revenus des ménages, par leurs achats, qui représentent cette monnaie effective »
-> Oui mais d’où vient le revenu ?
« Quand je « réalise » mes revenus en billets, personne ne me doit plus rien et je ne dois rien à personne. »
–> Quand vos revenus sont en monnaie scripturale également.
Je veux bien admettre qu’il y a un doute supplémentaire qui porte sur le fait que vous n’avez pas de façon concrète un support physique de cette valeur, dans votre poche. Cependant n’oubliez pas qu’à la banque, en monnaie scripturale , la sécurité est plus élevée.
Et, à contrario, si en cas de crise, vous devez rapidement changer de support de valeur pour conserver votre pouvoir d’achat, la monnaie scripturale est bien plus performante que la fiduciaire. (Par contre dans le petit illégal, la fiduciaire est plus pratique, en mallette !)
En gros, la nature du support monétaire, donc du support de la valeur répond à des risques différents. La monnaie B.C. représente l’avantage d’une reconnaissance et d’une force légale , personne n’a jamais contesté ce fait de nature juridique avant d’être économique.
4) « Il reste que le numéraire reste le moyen légal, la clé de voûte »
-> Tout à fait. Actuellement . Cela découle du fait qu’il a toujours été considéré comme normal que l’extériorité de l’institution ‘Etat’, protège la monnaie considérée comme un bien commun .
Suivant les époques , cette protection (qui peut être aussi très … intéressée …) prend des formes différentes. (Et on peut imaginer la monnaie sans B.C. et même sans Etat)
Autrefois Rois ou Princes pouvaient battre monnaie (C’est à dire pouvoir , uniquement, de frapper une matière précieuse qui ne lui appartenait pas forcément) , mais il ne fabriquait pas la monnaie à partir de rien. L’or était le garant qu’aucun tripotage n’était possible (enfin … on pouvait toujours ‘corrompre’ le % métal précieux … et ils en ont abusé ! )
AUjourd’hui, si vous aimez les comparaisons , le cours légal de la monnaie BC et les exigences et possibilités de conversion, avec le système des rations etc , sont des façon de ‘battre’ la monnaie scripturale ! Mais ce n’est qu’une image.
Mais donc si l’Etat ne peut se désintéresser de la monnaie, elle ne peut s’affranchir de la règle d’airain que la réciprocité doit être, ou alors destruction de valeur de la monnaie !
5) « ll reste que l’on ne peut acheter que ce qui existe réellement à tout moment, »
–> Je vois les choses ainsi, comme vous (et ca me parait nécessaire de ne jamais l’oublier !). Mais comme tout le monde , car c’est d’une logique imparable. Ce qu’il faut bien mesurer et là les opinions divergent, ce sont les conséquences réelles de ce principe.
6) « En accordant un crédit, la banque doit trouver simultanément des fonds que d’autres lui prêtent, sinon, elle n’accordera pas ce crédit. »
–> NON. Le pur crédit n’est pas assis sur le débit d’un quelconque autre compte.
IL ne vous est pas interdit de penser que peut être ce mécanisme vient pour lever une contradiction du système, par expl celle qui fait que les dépôts sont, comme l’a montré J Bayard, du signe monétaire stocké dans des parking, mais il n’empêche qu’il ne s’agit que d’une vue de l’esprit .
Et si vous acceptez ce principe, au contraire vous vous bouchez la vue, puisque vous ne voyez pas que précisément, ce crédit sans contrainte libère une masse monétaire (qui devrait financer la production dans un système sain), qui s’oriente vers des activité purement spéculatives (préemption de valeur par des aller-retour rapides sur des actifs = fabrication de valeur sans réciprocité : qui financera cette fausse ‘valeur’ à terme ? -> le secteur économico-civil)
7) « Et ceux qui prêtent, par la force des choses, n’achètent pas ce que l’emprunteur achète à sa place en empruntant. »
–> Bien entendu, mais c’est une vision statique que vous avez là. Une vision de l’économie du XIXe. Le multiplicateur keynésien est une catastrophe conceptuelle mais il existe et il fonctionne.
L’injonction de crédit va automatiquement entraîner une augmentation de la production , ne serait-ce que dans la partie inutilisée des forces productives existantes.
De plus je vous rappelle que le crédit lorsqu’il est accordé passe d’abord, en très grande partie, par l’investissement , c’est à dire la demande de consommation n’a lieu que dans un second temps, lorsque la production de biens et services a déjà eu lieu.
Par contre on peut accepter le raisonnement pour le crédit à la consommation , encore que cela ne se joue pas comme vous le décrivez : le pouvoir d’achat supplémentaire opère une pression sur les stocks, les délais de livraisons s’allongent etc … et personne n’est subitement privé d’un bien (Bastiat c’est bien mais il faut intégrer les acquis plus récents)
La conclusion étant que votre raisonnement ne peut en aucun justifier l’idée que les dépôts ‘feraient’ ou contingenteraient , par restriction de l’offre des produits/service , le pur crédit.
Ceci dit personne n’a jamais dit que le pouvoir des banques de faire du crédit pur était illimité, mais la contrainte ne vient pas des dépôt (et s’il y a un lien entre crédit et dépôt, il n’est pas de nature causale , ni de l’ordre du principe) .
8) « Macroéconomiquement, il est totalement impossible que la banque crée de la monnaie via le crédit, car cela voudrait dire que les revenus monétaires disponibles auraient augmenté avec un stock de marchandises et de services et de biens d’équipement donné au présent. Nous aurions dès lors de violents mouvements inflationnistes, ce qui n’est manifestement pas le cas. »
–> Effectivement pas d’inflation , car on fait tout pour la juguler … mais vous oubliez la spéculation qui s’auto-entretient en fascinant les détenteurs de monnaie , par ses rendements mirobolants, depuis une trentaine d’année.
Je crains que votre conception de l’inflation ne date, elle aussi 😉
9) « Par une émission supplémentaire de numéraire n’irrigue pas nécessairement l’économie du fait que ce numéraire peut être aussitôt thésaurisé, et il l’est de plus en plus actuellement »
–> Non , il n’y a plus de thésaurisation : une partie de la monnaie trouve sa justification aujourd’hui dans la spéculation. Et la thésaurisation inévitable (il fat bien avoir un fond de roulement) est gommé par les facilités du crédit. Largement. La thésaurisation est un vieux concept , je le crains …
10) « Il reste, dans tout ce mécanisme, le constat que les fonds collectés par les banques auprès du public représentent ce que les banques s’efforcent de placer sous forme de crédits, sinon, elles ne se donneraient pas la pein de les collecter. »
–> Si vous parlez des dépôts c’est encore non. Mais vous avez raison, les banques aiment nos dépôts, pas parce qu’elles les replacent mais parce que c’est une source de revenu extraordinaire, par petites ponctions de ceci et cela … et que donc cela en vaut largement la peine (sans parler du fait que cela colmate les fuites après solde des compensations , vers les autres banques !)
[Au fait vous écrivez « représentent » … , c’est un peu flou , c’est un peu comme le ‘considèrent’ de Allais que Paul aime à critiquer … 🙂 ]
11) « Je suis fatigué »
–> forcément vous êtes parti de travers dès le départ 😉 … faire rentrer la réalité observée dans une mauvaise grille, c’est fatiguant.
12) « D’où vient l’intérêt, la rente du capital? »
Je me pose la question aussi et surtout celle de sa justification.
Je crois que l’idée d’une monnaie totalement gratuite ne tient pas la route. Je pars du principe que si l’intérêt existe c’est qu’il y a une raison spécifiquement économique. Mais , bien sûr, il me parait certain que cet intérêt est instrumentalisé à des fins de répartition de revenus et de concentration des richesse par les uns, contre les autres.
13) « On peut dire que plus l’usage des comptes courants s’étend, moins le numéraire circule. »
–> On pourrait débattre de cela aussi … mais là je serais d’accord avec vous . C’est presque dommage 😉 .
14) « ’où ma proposition de faire circuler le signe monétaire inconditionnellement en lui imprimant la marque du temps »
–> En détruisant la fonction de réserve de valeur à cette monnaie, vous en ôtez toute envie de l’utiliser. D’où préférence pour les autres monnaies étrangères, d’où intervention de l’Etat pour forcer les gens à l’utiliser , ou bien instauration d’une monnaie mondiale.
Et encore, de plus, instauration probable de marché noir et/ou d’une nouvelle monnaie au travers d’un actif probablement financier, dont la valeur ne se dégrade pas, et qui servira , à un niveau supérieur, à stocker la valeur pour ce l’échanger en toute sécurité , face au temps.
La monnaie fondante pourrait bien aller à un système de dictature. D’ailleurs Keynes, très intéressé par Gesell, a toujours admis que sa conception monétaire se mariait au mieux avec les régimes dictatoriaux !
Je n’en conclus rien sur Keynes , puisque je sais qu’il était, au fond, plutôt un libéral croyant au marché, et qu’il boursicotait de temps à autres ! (Les gens ne sont pas comme tout le monde, c’est bien connu ! 😉 )
PS/ Pas le temps de me relire, j’offre mes fautes à défaut de mes erreurs !
oppossum affirme:
« –> Quand vos revenus sont en monnaie scripturale également. »
Et c’est faux!, car la banque me doit bien formellement ce qui est crédité sur mon compte!
Existe-t-il des indices de la création monétaire des banques ?
Le sydrome de la Monnaie, Helmut Creutz, p. 175
La recherche empirique de preuves de la création monétaire n’aboutit à rien. La recherche d’indices allant dans ce même sens est tout aussi vaine. Par contre, beaucoup d’indices tendent à démontrer le contraire. Par exemple le fait que les pays industrialisés, où les portefeuilles de crédit sont énormes, enregistrent généralement des taux d’inflation inférieurs à ceux des pays où les banques traitent des volumes inférieurs. Si le volume énorme de crédits octroyés dans les pays industrialisés s’accompagnait de création monétaire, les résultats devraient plutôt aller dans le sens inverse.
Un autre indice contredisant la théorie en question est que les calculs des bénéfices des banques ne laissent aucunement supposer qu’il existe des créations monétaires. En effet, de tels accroissements du crédit et de la monnaie « à partir de rien » devraient avoir des retombées sur les bénéfices des banques, étant donné que les intérêts sur les crédits créés resteraient dans leur totalité chez ces banques. Pour vérifier les faits, prenons les résultats d’exploitation de l’ensemble des banques allemandes publiées régulièrement par la Deutsche Bundesbank. Voici ce qu’on y lit au titre de l’année 2001
Les banques ont donc versé en gros quatre cinquièmes des intérêts perçus aux épargnants et aux bailleurs de fonds et en ont gardé un cinquième. En moyenne à long terme, cette fraction conservée par les banques se rapproche d’ailleurs plutôt du quart. /176/ Cela signifie donc que la marge des banques s’est même détériorée au cours des dernières années, bien que le volume des opérations ait augmenté. Les bénéfices des banques résultant de ce cinquième empoché se calculent comme suit :
Après impôts, il ne reste aux banques allemandes que 10 milliards, soit 2,6 % des produits financiers, malgré les produits nets de commission qui viennent s’y ajouter. Si l’on compare ce bénéfice aux capitaux propres des banques, qui se montaient à 319 milliards d’euros en 2001, on obtient un rendement des capitaux propres de 4,4 % avant impôts et de 3,1 % après impôts. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit là d’un rendement très faible, révélateur de la situation des banques devenue précaire. Il ne permet aucunement d’en déduire quelconques bénéfices bancaires qui ne s’expliqueraient que par des créations monétaires, et même si ces bénéfices atteignaient le double, comme cela a été le cas lors des années de vaches grasses, cela n’y changerait rien.
Un autre argument contredisant la théorie de la création monétaire est que même des variations significatives des réserves bancaires obligatoires, par rapport auxquelles les créations monétaires évoluent soit-disant réciproquement, n’ont aucun impact sur les octrois de crédits. Ainsi, par exemple, la réserve obligatoire de la République fédérale d’Allemagne a été divisée par deux entre 1973 et 1982, de 18 à 9 %, et diminuée encore une fois à deux pour cent dans les années 90 sans que l’on assiste à l’explosion des crédits, sur laquelle se fonde la théorie de la création monétaire (cf. figure 8 du chapitre 4). En Suisse, ces réserves obligatoires ont même été entièrement supprimées il y a quelques dizaines d’années sans conséquences constatables.
Un autre indice est que les banques ne feraient certainement pas autant d’efforts pour attirer les épargnants si elles n’avaient pas besoin de leur argent pour élargir leurs portefeuilles de crédit. Et enfin, il faudrait aussi se demander pourquoi le gouvernement américain et d’autres gouvernements iraient chercher des crédits fort onéreux sur toute la planète pour combler leurs déficits bien qu’en théorie, leurs banques nationales soient en mesure de combler ces trous dans les budgets par leurs propres créations monétaires. Et cela surtout sans perdre de vue le fait que la conséquence de ces endettements à l’étranger est que non seulement ce sont les banques étrangères qui encaissent des bénéfices mais surtout que les énormes montants d’intérêts à payer pénalisent la balance des paiements. Or, ces opérations ne cachent rien de mystérieux non plus. Citons encore une fois Otmar Issing, entre-temps chef des Études économiques à la BCE, qui en témoigne dans une déclaration publiée en 1995 par le premier des quotidiens allemands, le Frankfurter Allgemeine Zeitung :
On pourrait continuer la liste des contre-indices. Par exemple en Allemagne, dans les années cinquante, il fallait souvent attendre des semaines, quand ce n’était pas des mois, le versement de prêts hypothécaires de premier rang accordés, même si le reste du financement était assuré et si des garanties étaient produites sous forme de terrain et de gros-œuvre. Les banques se justifiaient en déclarant qu’elles manquaient alors de fonds. En clair : elles étaient obligées d’attendre de nouveaux dépôts, le remboursement d’autres crédits ou que d’autres banques leurs transfèrent leurs réserves excédentaires. De nos jours, les banques ont plutôt tendance à « nager » dans l’argent et ont des problèmes pour trouver des emprunteurs sérieux. Toutefois, cela n’est pas non plus le résultat de « créations monétaires » mais celui du surdéveloppement des dépôts essentiellement dû aux intérêts composés. Les problèmes qui s’ensuivent sur lesquels nous nous pencherons plus en détail dans la partie suivante du livre, n’ont aucun rapport avec la question de la création monétaire et réclament une solution qui n’a rien à voir avec celle-ci.
_________________________________________
Fin de citation. La somme des soldes créditeurs des comptes à vue semble être indépendante du taux de réserve additionnelles si ce que dit Creutz est vrai : qu’en Suisse ce taux est nul depuis plusieurs dizaines d’années. JPV.
Le Syndrome de la monnaie, Helmut Creutz, chapitre 12 →
Le Swiss Interbank
Clearing
En Suisse, les avoirs des banques dans les livres de la banque Nationale ont le même effet libératoire que les billets de
banques. Que vous disais-je ? Pourquoi n’en serait-il pas de même en France ?
JPV
Définition des agrégats monétaires
Masses monétaires M1, M2 et M3
Le seul renseignement qui m’intéresse, l’encaisse effective des banques sur leur CC à la BNS (M0 – Billets) ne figure pas. C’est un secret ?
JPV
Bilan au 31 décembre 2008
Je trouve pour 2008 : Créances en francs résultant de pensions de titres : 50 milliards de Francs suisses.
Ça fait beaucoup pour des banques qui ne sont pas tenues à des réserves obligatoire.
JPV
Passif 2008
Billets de banque en circulation………………………………49 160,8
Comptes de virement des banques en Suisse………….37 186,2
37 milliards de francs suisses, pour quoi faire ?
JPV
Fonds de roulement ? Les banques suisses roulent sur l’or.
Un chose dont 2 personnes ‘considèrent’ qu’elle est à leur disposition en même temps ? …
Paul ne va pas aimer cela et n’ira donc jamais vivre en Suisse ! 😉
(Si je comprends bien …)
Tant que le passage du cygne noir n’a pas levé une contradiction, elle peut prospérer dans l’ambiguïté. (Proverbe d’une tribu amazonnienne sans monnaie)
Les « considérations » n’ont pas d’impact sur les flux monétaires. C’est tout.
M Voyer
Ce que vous faites est intéressant, les chiffres plutôt que les longs discours il n’y a pas mieux.
Pour ma part pour l’instant rien ne me choque, attendons la fin de votre démonstration et les enseignements qu‘il faut en tirer.
Merci de votre observation, Paul !
Il me semblait que, il y a plusieurs mois, dans votre optique de nier le ex-nihilo, donc de recherche d’une origine précise au crédit pur, vous aviez émis que la source en était le dépôt, en réalité.
Ce faisant vous vous trouviez donc en phase avec Allais , qui lui aussi fait un lien entre dépôt et crédit , sauf que lui pose un lien de l’ordre de ce qui devrait être irrémédiablement en toute logique théorique.
Allais va subtilement jusqu’au bout de la logique qu’il s’est imposée : le ex-nihilo existe bien , mais c’est une escroquerie !
Car il constate bien la contradiction réelle qui , si le crédit devrait être l’expression des dépôts (là je fais une faute grammaticale obligatoire pour exprimer sa subtile pensée !) , existe réellement par la pose de deux droits concomitant sur un même objet, en même temps.
Et donc, allant jusqu’au bout , il en conclut à cette conclusion presque extravagante de la malhonnêteté consistant à prêter un objet tout en le laissant à la disposition d’un autre.
C’est ce qu’il exprime par la formulation que 2 agents ‘considèrent’ en toute bonne foi qu’une somme est à leur disposition éventuelle , en même temps !
Vous avez opposé l’argument que ‘considérer’ est une chose mais que la réalité est autre et donc qu’en réalité la somme est soit ici soit là , mais pas a deux endroits à la fois.
Au fond j’ai toujours été d’accord avec cet argument de bon sens (pas du tout pour la fausse raison qui n’a rien à voir, que la banque ne serait pas en mesure de tout transformer en monnaie fiduciaire)
Mais je n’en conclus pas que la monnaie de l’un a été prêtée inconsciemment en cachette en tout bonne foi , à l’autre , mais qu’il y a bien création d’un surplus de pouvoir d’achat par monétisation de l’actif reconnaissance de dette de Johannes à la Banque Voyez.
Et pour moi vous, comme Allais (mais selon des modalités différentes) raisonnez en même temps que ce qui devrait , peut-être, être , et sur des pratiques humaines et leurs représentations comptable.
Et comme je reçois donc très bien votre argument qu’une chose ne peut être à deux endroit à la fois , que je comprends pas le système suisse , ou plutôt que je trouve illogique parce que là, effectivement il y a collision possible si le cygne noir passe.
C’est tout ce que je dis.
Vous me dites alors « Les « considérations » n’ont pas d’impact sur les flux monétaires. C’est tout »
Bon , je veux bien recevoir l’argument (quoique le flux monétaire étant lui-même une sorte de modélisation, donc de ‘considération’ , il n’a de réalité que ce qu’on en a décidé, et que donc, il peut y avoir quelque chose d’illogique quant au fond, ou en tout cas de non-traduisible d’un point de vue juridique) , mais alors je l’oppose tout simplement en vous demandant de bien vouloir admettre qu’il n’y a AUCUN FLUX monétaire constatable , dans tous les autres pays que la Suisse , entre le dépôt et le crédit pur.
Et ceci malgré toutes les ‘considérations’ des uns et des autres.
Bon ce raisonnement m’a presque épuisé . Je vais commencer à être fatigué -comme Johannes-
Jean-Pierre,
J ai une question naïve de béotien. Dans une perspective comptable, est-il possible de consolider les comptes d États ayant une monnaie unique, de façon à éliminer les dettes consanguines, comme cela se fait pour des entreprises ? En somme, est-il possible d agréger les dettes de la zone Euro, est-ce que cela existe ?
Cela ne donnerait-il pas un autre aperçu des niveaux d endettement public en zone euro et de l impact de la monnaie unique pour ceux-ci ?
Merci.
JP Voyer dit
« Si le volume énorme de crédits octroyés dans les pays industrialisés s’accompagnait de création monétaire, les résultats devraient plutôt aller dans le sens inverse. » … des « … des taux d’inflation inférieurs à ceux des pays où les banques traitent des volumes inférieurs. »
De même qu’on a pu observer l’étrange phénomène , à l’époque, de la stagflation , de même il existe des situations où l’abondance et l’excès de crédit , ne crée pas d’inflation précisément.
Si vous créez de la monnaie supplémentaire sans qu’elle alimente la demande (en ‘libérant l’épargne de l’exigence de financer la production’) , mais plutôt la spéculation , je ne vois pas pourquoi il y aurait inflation.
Une mauvaise répartition de richesse au départ , même petite et même si elle n’est pas la base réelle de toute la spéculation, peut, par cumul et par le temps alimenter de gros volume.
A terme , à la fois elle crée de la valeur artificiellement , mais elle en pompe également de la réelle, et asphyxie en tout cas , à coup sûr , lentement l’économie réelle.
A mon avis , les indices » contredisant la théorie de la création monétaire » , peuvent être trouvés effectivement , car la monnaie est précisément dans son mouvement quelque chose qui tend à sa propre destruction , de façon ontologique .
Et il doit y avoir pas de trace de cela dans la compta, forcément, mais sous forme de traces parce que la compta ne sais penser le temps précisément.
Mais faire de cette impuissance une preuve ou même un indice , est surtout la preuve d’un esprit formaliste au mauvais sens du terme.
(Éternel problème de la représentation de la chose , et de la chose elle même qui se complique car parfois la représentation des choses est la chose elle même ! )