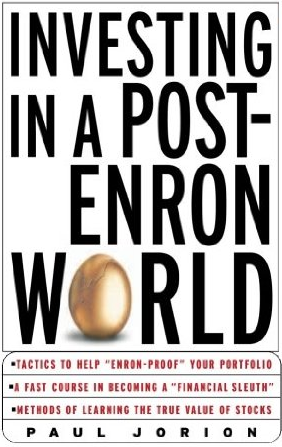 ENRON REVISITÉ (I) « IL Y A NOUS, D’UN CÔTÉ… ET PUIS TOUS LES AUTRES… »
ENRON REVISITÉ (I) « IL Y A NOUS, D’UN CÔTÉ… ET PUIS TOUS LES AUTRES… »
ENRON REVISITÉ (II) L’ARROGANCE, MÈRE DE LA FRAGILITÉ
ENRON REVISITÉ (III) « TOUT IRA TOUJOURS POUR LE MIEUX ! »
ENRON REVISITÉ (IV) PIRATES DE LEUR PROPRE NAVIRE
Il existe une remarquable ironie dans la saga Enron, c’est le fait que Jeffrey Skilling, son P-DG et âme damnée, encore en prison au moment où j’écris, avait fait ses armes au sein du cabinet McKinsey & Co, dont il fut l’un des partenaires, parce que ce sont deux des innovations, authentiques traits de génie, de ce consultant en gestion, qui furent responsables de la disparition-éclair de la compagnie une fois qu’un accident mineur l’eut déstabilisée : le concept d’« asset-light corporation » et le système des stock-options.
À une époque pas si lointaine, on considérait qu’un bébé se devait d’être « dodu ». Puis l’on considéra qu’un bébé « dodu » était en réalité « gras », ce qui n’était pas une bonne chose, et la norme se déplaça vers le bébé « svelte ». Un bébé atteint de dysenterie s’étiole très rapidement et d’être dodu au moment où la maladie le touche s’avère avec le recul ce qui lui aura sauvé la vie. Dans les régions où la dysenterie ne sévit pas de manière endémique, la chose est moins importante, jusqu’au jour où intervient l’accident individuel…
McKinsey & Co fut le promoteur de la compagnie « asset-light » : svelte quant à ses actifs, et Enron fut le fleuron du concept. Mais il en est de ces compagnies comme des bébés sveltes : d’apparence plus saine que les autres mais seulement tant qu’ils ne sont pas malades, la transition de svelte à émacié s’opérant alors rapidement.
Les stock-options furent une autre innovation géniale dont McKinsey fut l’inventeur. Traditionnellement, les intérêts des créanciers d’une compagnie et de ses dirigeants étaient antagonistes. Le taux d’intérêt auquel les émissions de créances par la firme s’établit reflète le rapport de force entre les deux parties : ce que les uns auront, les autres en effet, n’y auront pas droit. Le cas des actionnaires, autre type d’investisseurs, est à peine différent : les dividendes représentent (du moins en principe !) une « part » de la richesse créée par l’entreprise et ce que les actionnaires recevront, les dirigeants de l’entreprise ne le recevront pas.
Pourquoi tolérer plus longtemps, se dit-on au début des années 1970, que des agents économiques qui, face aux salariés, se situent « du même côté », doivent s’affronter ? Après tout, Marx ne les confondait-il pas dans la catégorie des « capitalistes », alors que les dirigeants de l’entreprise n’ont a priori rien à voir avec le « capital » ? Pourquoi ne pas aligner leurs intérêts ?
Or, dans un pays comme les États-Unis où les dividendes sont imposés davantage que l’appréciation du prix des actions – pour l’une de ces raisons mystérieuses qui font douter de l’intelligence humaine – une fois les intérêts des actionnaires et des dirigeants d’entreprise « alignés » par l’opération des stock-options, la finalité ancienne de l’entreprise de satisfaire ses clients et de rendre heureux ses employés put rapidement être rangée au magasin des accessoires puisque les choses qui importaient se limitaient désormais à une seule : faire grimper le cours de l’action de trimestre en trimestre.
Et en cela, les dirigeants d’Enron se montrèrent maîtres. Au point d’ailleurs de vendre leur expertise dans ce domaine à tous ceux qui étaient prêts à les entendre, qui s’avérèrent être extrêmement nombreux.
Si une part majeure de la rémunération de chacun provient de stock-options (un dirigeant d’entreprise américaine n’en vint-il pas à ne plus réclamer comme salaire qu’un dollar symbolique ?), alors chacun se désintéresse de tout autre objectif qu’un bilan en hausse constante faisant grimper imperturbablement le prix de l’action, tout objectif à long terme qui ne pourra se traduire par le miracle du « mark-to market », de la cote-au-marché, en manne immédiate, étant lui ignoré.
Lorsque les chiffres financiers n’étaient pas suffisamment alléchants, alors, comme on l’a vu, les sommes manquantes en fin de trimestre étaient sollicitées des « amis d’Enron » au taux défiant toute concurrence de 15%, pour les quinze jours nécessaires à ce que le bébé retrouve son aspect joufflu. Si des dettes prenaient un air douteux, elles étaient refilées à des « partenariats » qui les glisseraient sous la carpette pour une durée que l’on espérait courte.
Malheureusement, comme on avait par ailleurs mis tous ses œufs dans le même panier d’une mine éblouissante due à un bronzage artificiel, en promettant de régler rubis sur l’ongle tout problème financier qui pourrait apparaître, le moindre aléa menaçait alors de faire s’écrouler tout l’édifice.
Enron survécut aux pertes essuyées sur un contrat britannique de gaz naturel et sur un additif de carburant qui ne remplirent pas leurs promesses, elle survécut aux déboires de la compagnie des eaux Azurix en Angleterre, et à ceux de la centrale électrique de Dabhol en Inde qui ne voulut jamais décoller, elle survécut à la maladie de Zayed ben Sultan Al Nahyane, émir d’Abou Dabi et premier président des Émirats Unis, qui l’avait empêché de racheter certaines opérations d’Enron, elle survécut au fait d’avoir été visionnaire prématurée de l’Internet en créant de la bande passante sur fibre optique en quantité telle que le marché s’avéra incapable de l’absorber.
Mais il suffit alors que la firme d’audit Arthur Andersen découvre que l’un de ces « partenariats » provisoirement salvateurs avait été insuffisamment financé en fonds extérieurs (en raison d’un calcul complexe mal maîtrisé portant sur le collatéral) pour qu’Enron – dont la notation n’avait jamais décollé du « BBB » – s’effondre en 46 jours seulement dans un processus catastrophique similaire, comme l’affirma à juste titre Jeffrey Skilling devant une commission du Congrès le 7 février 2002, à une panique bancaire. Il ne restait plus ensuite pour les uns et les autres qu’à se traiter mutuellement de noms d’oiseaux.
C’était il y a exactement onze ans. Les choses ont-elles changé depuis ? Oui : le Sarbanes-Oxley Act de 2002 a responsabilisé aux États-Unis les dirigeants d’entreprise quant aux chiffres financiers publiés au bilan de leur firme. Pour tout le reste, et comme nul ne l’ignore : c’est aujourd’hui bien pire.
2 réponses à “ENRON REVISITÉ (V) UNE BONNE SANTÉ TRÈS TROMPEUSE”
[…] Blog de Paul Jorion » ENRON REVISITÉ (V) UNE BONNE SANTÉ TRÈS TROMPEUSE. […]
[…] […]